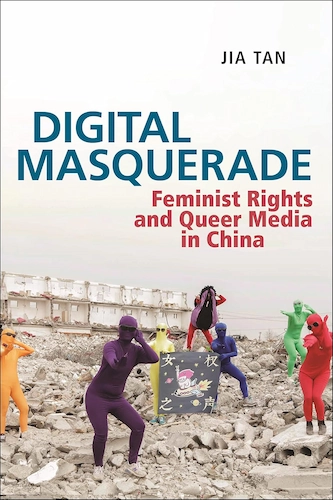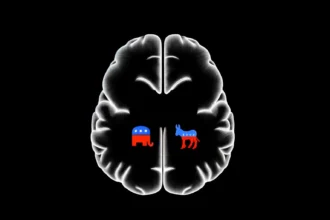À propos de Digital Masquerade: Feminist Rights and Queer Media in China, de Jia Tan, publié par New York University Press en 2023.
Les cinq féministes et l'attention mondiale
En 2015, Li Maizi, Wei Tingting et trois autres féministes ont été arrêtées et détenues pendant trente-sept jours en Chine après avoir prévu de diffuser des messages contre le harcèlement sexuel dans les espaces publics.
Avant leur détention, les cinq féministes et leurs camarades avaient recours à une série d’activités médiatiques pour défendre ce qu'elles appelaient nüquan, signifiant littéralement droits ou pouvoir des femmes.
Une question centrale dans mon livre est de savoir comment nous pouvons théoriser l'activisme médiatique dans un contexte à la fois antilibéral et néolibéralisé.
La détention de ces militantes, qui sont devenues connues sous le nom des Cinq Féministes, a suscité une attention considérable tant au niveau national qu’international. Cela a inclus des manifestations à Hong Kong en soutien aux Cinq Féministes, des féministes indiennes signant des pétitions en ligne et un tweet de Hillary Clinton en leur faveur.
Activisme pour le mariage et plaidoyer numérique
Le 2 juillet 2015, quelques jours après que la Cour suprême des États-Unis a légalisé le mariage entre personnes de même sexe, une cérémonie de mariage entre Li Maizi et sa partenaire a eu lieu à Pékin. C'était l'une des premières apparitions publiques de Li après sa libération. Wei Tingting, une autre membre des Cinq Féministes, a animé la cérémonie.
Li considérait le mariage comme une occasion de plaider pour l’égalité des droits des couples de même sexe. Elle a appelé à des réformes juridiques sur les droits au mariage, à l’adoption et à la reproduction, afin que ces droits puissent être accessibles aux couples de même sexe en Chine. Le slogan utilisé lors du mariage était : « le féminisme exige la liberté, les femmes exigent le mariage entre personnes de même sexe. » 女權要自由,女女要結婚. Plus important encore, les féministes ont activement invité des journalistes à la cérémonie et utilisé les réseaux sociaux pour promouvoir cet événement et différentes conceptions des droits auprès du public.
Ceci est l'un des exemples que j'examine dans mon livre, où le discours sur les droits croise les médias numériques et les articulations féministes et queer. Les Cinq Féministes et leurs camarades forment une communauté de féministes diverses à l’échelle nationale, aujourd’hui connue sous le nom de Youth Feminist Action School. J’explore également comment des féministes ont publié des images modifiées de leurs corps en ligne pour sensibiliser à la violence conjugale, et comment les ONG et les militants mobilisent et mettent en scène différentes conceptions des droits selon les contextes et les plateformes médiatiques.
Historiquement, l’activisme féministe en Chine a été étroitement lié à l’État, comme l’illustre la Fédération des femmes de toute la Chine (ACWF). En comparaison, la nouvelle vague d’activisme féministe que j’explore dans mon livre est davantage liée aux ONG, dont beaucoup ont été fondées après la Quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes à Pékin en 1995. Cette nouvelle vague implique également diverses formes de médias commercialisés et numériques, nécessitant ainsi un nouveau cadre de recherche.
Féminisme des droits
Ce qui m’a poussé à écrire ce livre, c’est l’existence de deux récits médiatiques distincts sur les vies féministes et queer en Chine. L’un met l’accent sur l’oppression répressive de l’État et le contrôle des individus et des groupes, tandis que l’autre met en lumière les tendances néolibérales émergentes du féminisme libéral et des pratiques homonormatives.

D’un côté, la Chine est présentée comme un pays antilibéral et oppressif, avec des descentes fréquentes dans les établissements commerciaux LGBT (comme les bars et clubs), l’annulation de festivals de cinéma LGBT et d’événements communautaires, une surveillance accrue des militants féministes et queer, et la censure de l’homosexualité dans le cinéma, la télévision et sur Internet.
La Chine “antilibérale” est souvent comparée aux gouvernements “libéraux démocratiques” des États-Unis, de l’Europe ou, plus récemment, de Taïwan et de la Corée du Sud, en particulier après la légalisation du mariage entre personnes de même sexe à Taïwan en 2019. D’un autre côté, l’économie rose a prospéré dans la Chine néolibéralisée, et les discours libéraux sur l’égalité des droits pour les femmes et les personnes LGBT se sont multipliés. Une mascarade peut être à la fois soumise et perturbatrice face aux codes sociaux dominants.
Une mascarade peut être à la fois soumise et perturbatrice face aux codes sociaux dominants.
Par exemple, le parrainage par Alibaba Taobao de couples gays et lesbiens voyageant aux États-Unis pour se marier. Bien que ces initiatives puissent être critiquées pour perpétuer l’homonormativité néolibérale ou l’homo-nationalisme, ces critiques ne saisissent peut-être pas toute la complexité de l’activisme féministe et queer en Chine.
Une caractéristique majeure de cette nouvelle vague de féminisme des droits et d’activisme queer est le rôle crucial des médias numériques—tels que la production et la distribution de films numériques, les réseaux sociaux et les revues électroniques—en tant que plateformes essentielles pour l’expression féministe et queer. J’entends utiliser le terme ‘mascarade numérique’ pour théoriser l’activisme médiatique comme des assemblages d’expériences incarnées et de possibilités technologiques dans des contextes historiques spécifiques. Ce faisant, j’espère éviter un sentiment d’impuissance face à la censure et aux autres formes de contrôle dans un monde de plus en plus antilibéral.
Mascarade numérique : Entre censure et créativité
J’introduis le concept de ‘mascarade numérique’ pour examiner l’interaction entre les possibilités technologiques, la censure et l’énergie créative au sein de l’activisme médiatique féministe et queer. Une mascarade peut être à la fois soumise et perturbatrice face aux codes sociaux dominants. J’emploie le terme mascarade pour décrire de nombreuses tactiques utilisées dans l’activisme féministe numérique, comme le port de masques et de costumes pour dissimuler les identités, ou l’altération d’images en ligne à des fins de plaidoyer.
J’élargis la compréhension de la mascarade au-delà de la subjectivité individuelle dans la théorie féministe et queer pour inclure sa matérialité à l’ère numérique. Mon utilisation du terme mascarade s’éloigne des théories psychanalytiques et se concentre sur les assemblages d’expériences incarnées et les possibilités technologiques dans des contextes historiques spécifiques. La ‘mascarade numérique’ englobe les diverses manières dont les individus agissent et interagissent avec la technologie dans des contextes donnés, nous permettant de dépasser l’opposition binaire entre conformité et résistance en matière d’activisme.
J’élargis la compréhension de la mascarade au-delà de la subjectivité individuelle dans la théorie féministe et queer pour inclure sa matérialité à l’ère numérique. Mon utilisation du terme mascarade s’éloigne des théories psychanalytiques et se concentre sur les assemblages d’expériences incarnées et les possibilités technologiques dans des contextes historiques spécifiques. La ‘mascarade numérique’ englobe les diverses manières dont les individus agissent et interagissent avec la technologie dans des contextes donnés, nous permettant de dépasser l’opposition binaire entre conformité et résistance en matière d’activisme.
Un activisme en mutation : Des manifestations de rue à la résistance en ligne
Le travail de terrain que j’ai réalisé pour ce livre s’est achevé en 2019, puis la COVID est arrivée, m’empêchant de me rendre en Chine continentale. Au cours des cinq dernières années, l’activisme des ONG, les rassemblements de rue et l’expression directe des droits de genre et sexuels que j’ai abordés dans mon livre ont diminué, et de nombreuses personnes que j’ai interviewées vivent désormais à l’étranger.

Pourtant, de manière paradoxale, l’expression et l’organisation féministes en ligne, ainsi que la visibilité gay, se développent à une échelle sans précédent. Si nous ne considérons l’activisme féministe et queer en Chine que sous un prisme non conflictuel, nous risquons de ne pas saisir ces dynamiques et parfois ces contradictions. Par exemple, les performances de rue des Cinq Féministes et de leurs camarades, que j’évoque dans mon livre, n’étaient pas perçues comme conflictuelles dans les années 2010, mais elles ont peu de chances de se reproduire aujourd’hui.
Dans un autre article récent, je développe le concept de résistance lente pour analyser l’activisme féministe et queer dans des contextes antilibéraux. Ce concept remet en question l’idée que le pouvoir se limite au pouvoir de l’État et que la résistance se définit uniquement comme une opposition à celui-ci. Développer cette notion dans l’activisme féministe met également en lumière l’importance des politiques de genre et de sexualité dans la compréhension du changement social et politique, où « le personnel est politique ».