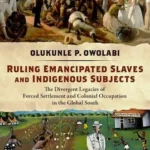Karima Bennoune, ancienne Rapporteuse spéciale des Nations Unies dans le domaine des droits culturels, a déclaré avec justesse que «le patrimoine culturel est significatif dans le présent, à la fois comme un message du passé et comme un chemin vers l’avenir. D’un point de vue des droits humains, il est important non seulement en lui-même, mais aussi en lien avec sa dimension humaine». Guidé par ces mots, le projet Patrimoine en guerre et en paix a célébré son quatrième anniversaire en décembre 2024.
- Comment tout a commencé ? Nouveaux débuts
- Le premier séminaire : Combler le fossé
- La deuxième conférence : Construire une plateforme de dialogue sur le patrimoine
- Le livre : Ouvrir le projet au grand public
- La troisième conférence : L’arrivée de l’Institut International du Patrimoine
- La quatrième conférence : Construire l’héritage
- Découvrez les livres écrits par nos collaborateurs
- Conclusion : Le travail continue
Comment tout a commencé ? Nouveaux débuts
Les débuts du projet Patrimoine en guerre et en paix trouvent leur origine dans la conférence Droit et la Ville, organisée par le GLSA à la Faculté de droit de l’Université McGill en mai 2021. Alors que les réalités de la pandémie pesaient encore, le président du comité organisateur, Mirosław M. Sadowski, fut approché en mars 2021 par deux des participants du panel sur le patrimoine culturel, Gianluigi Mastandrea Bonaviri et Hani El Debuch.
Dans un monde de conflits croissants, ce n’est qu’en travaillant ensemble que nous pourrons préserver notre patrimoine pour les générations futures.
Sans s’être rencontrés en personne, ils trouvèrent un terrain d’entente dans les mots de Renold et Chechi, qui postulaient que «la culture est comprise, protégée et promue non seulement pour ses manifestations physiques, mais aussi pour la relation de la culture avec les individus ou les groupes, ainsi que pour la diversité des relations qui doivent être protégées et encouragées». Ainsi, ils décidèrent d’organiser une conférence exclusivement consacrée aux questions du patrimoine, réunissant différentes perspectives, tant du domaine de la paix que de celui de la guerre.
Le premier séminaire : Combler le fossé
Prévue pour décembre 2021 à l’Université Sapienza de Rome, la première conférence avait la tâche délicate de réunir des spécialistes du patrimoine issus de domaines qui sont restés traditionnellement séparés : ceux qui travaillent sur le patrimoine en conflit et ceux qui travaillent sur le patrimoine en temps de paix.

Le projet a reçu un soutien inestimable du ministère italien des Affaires étrangères, qui a parrainé le sous-projet Musée Virtuel, une expérience de réalité alternative en 3D permettant d’explorer des espaces italiens sélectionnés. Présenté pour la première fois à Rome en 2021, le Musée est depuis devenu un élément clé de toutes les conférences du projet, avec des objets du patrimoine égyptien et écossais ajoutés à l’expérience virtuelle.
Malgré une bataille partiellement perdue contre les mandats pandémiques en constante évolution, la conférence, qui allait bientôt devenir hybride, a réussi à attirer plus de 50 intervenants du monde entier, dont la majorité participait à distance. Avec des sessions divisées en groupes distincts « paix » et « guerre », une image claire s’est rapidement dégagée : compte tenu des particularités de la protection du patrimoine au XXIᵉ siècle, qui implique souvent des conflits communautaires à petite échelle en temps de paix, les spécialistes des deux domaines devraient être en dialogue constant.
La deuxième conférence : Construire une plateforme de dialogue sur le patrimoine
Ce besoin évident de dialogue entre les experts du patrimoine en temps de paix et ceux du patrimoine en temps de guerre a conduit les organisateurs du projet à réaliser qu’une seule conférence ne suffirait pas à combler le fossé entre ces deux perspectives ; au contraire, un dialogue continu devait s’instaurer autour de la conférence.

La deuxième édition de Patrimoine en guerre et en paix, organisée en novembre 2022 à l’Université McGill sous le thème Espaces de conflit, espaces de justice : entre paysages naturels et paysages urbains, a précisément permis cela. Avec un nombre significatif de personnes impliquées dans le projet se rencontrant en personne pour la première fois, la conférence a rassemblé plus de 70 participants de tous les continents à Montréal.
Alors que les perspectives de conflit et de paix étaient réunies pour la première fois dans les mêmes sessions, plusieurs réflexions essentielles sur la protection de notre patrimoine ont émergé. Ainsi, les organisateurs ont pris conscience que ces connaissances devaient être préservées et partagées de manière plus durable avec le public mondial. En plus de poursuivre les éditions de la conférence, deux idées ont vu le jour : celle d’une publication réunissant les intervenants des deux éditions de la conférence et celle d’une plateforme plus concrète dédiée au discours sur le patrimoine.
Le livre : Ouvrir le projet au grand public
Le premier élément du plan à se concrétiser fut le livre, publié au début de l’année 2024 par Springer ; il rassemble plus de 50 auteurs à travers plus de 35 chapitres. Divisé en quatre parties, la première, «Le patrimoine culturel entre théorie, passé et avenir», regroupe des chapitres portant sur les différentes approches théoriques et historiques des questions patrimoniales.
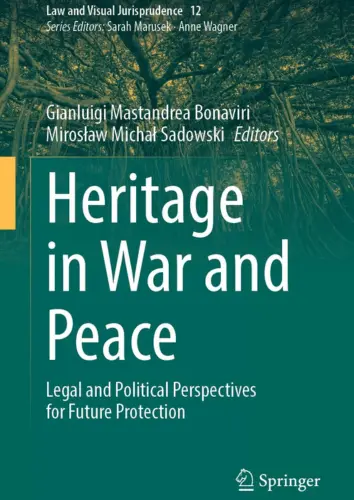
La deuxième partie, «Les enjeux du patrimoine en temps de guerre et de conflit», rassemble des articles traitant des problématiques du patrimoine en période de guerre. La troisième, «Les enjeux du patrimoine en temps de paix et de stabilité», se concentre sur la question du patrimoine en temps de paix.
Enfin, la quatrième partie, «Le patrimoine comme un droit : de la lutte pour préserver le passé aux questions de restitution», explore les relations entre patrimoine, droits humains et problématiques de restitution.
Publié dans la série Droit et Jurisprudence Visuelle, dirigée par Anne Wagner et Sarah Marusek, le livre, aux côtés du musée virtuel, constitue le premier résultat concret du projet, offrant au grand public un accès aux discussions stimulantes et aux débats novateurs qui se déroulent lors des conférences du projet.
Cependant, les organisateurs du projet savaient que le livre, à lui seul, ne suffirait pas à diffuser le message sur les meilleures pratiques de protection du patrimoine disponibles dans le monde moderne.
La troisième conférence : L’arrivée de l’Institut International du Patrimoine
Organisée à l’Université de Bologne en janvier 2024, la troisième conférence s’est tenue sous le thème «Patrimoine culturel tangible et intangible à travers le passé, le présent et le futur». Rassemblant environ 80 spécialistes et professionnels du patrimoine du monde entier, elle a suivi un format similaire à la précédente ; toutefois, les modérateurs-responsables des panels spécifiques étaient des experts dans leurs domaines, impliqués dans la sélection des communications pour chaque panel.
Le principal changement fut cependant l’établissement officiel de l’Institut International du Patrimoine, un organisme permanent chargé de préserver et de diffuser les connaissances issues des conférences successives tout au long de l’année. Rassemblant de façon permanente le réseau d’experts des différentes éditions du séminaire, désormais organisés en départements spécialisés, l’Institut organise divers événements plus restreints tout au long de l’année, permettant de répondre rapidement aux événements mondiaux, comme ce fut le cas pour le patrimoine culturel syrien à la fin de 2024 et au début de 2025, avec l’organisation d’une Semaine du Patrimoine Syrien au début de l’année 2025.
La quatrième conférence : Construire l’héritage
Le quatrième séminaire s’est tenu sous le thème «Patrimoine et Droits Humains. Perspectives à travers le passé, le présent et le futur» à l’Université de Strathclyde en décembre 2024. Rassemblant un nombre record de près de 100 experts en patrimoine, il a consolidé la conférence comme l’un des événements mondiaux majeurs dans le domaine du patrimoine.
Découvrez les livres écrits par nos collaborateurs
Cette reconnaissance fut encore renforcée lors de cette édition de la conférence par l’organisation d’une exposition d’un artiste résident, ajoutant un nouvel élément au réseau en constante expansion du projet. Cette approche permet aux chercheurs du monde entier de se réunir, garantissant que les solutions politiques soient partagées et connues par ceux qui sont en première ligne de la lutte pour la préservation de notre passé pour l’avenir de l’humanité.
Conclusion : Le travail continue
Interdisciplinaire—avec des experts issus du droit, des sciences politiques, de l’archéologie, de l’architecture et de l’art—intergénérationnel—réunissant des chercheurs établis, des praticiens, des jeunes chercheurs et des étudiants—international—avec des intervenants de tous les continents—et tourné vers l’avenir—intégrant les nouvelles technologies—le projet est bien préparé pour poursuivre son travail et relever les défis évolutifs auxquels le patrimoine est confronté aujourd’hui.
La prochaine conférence, prévue pour décembre 2025 à l’Université Vytautas Magnus à Kaunas, sera organisée sous le thème « Patrimoine et Technologie ». De plus, l’Université de Strathclyde et l’Université du Mississippi, en collaboration avec l’Institut International du Patrimoine, organiseront une École d’été en juin 2025 sur les questions de patrimoine, de droits humains et de droit spatial. Dans un monde de conflits croissants, ce n’est qu’en travaillant ensemble que nous pourrons préserver notre patrimoine pour les générations futures.