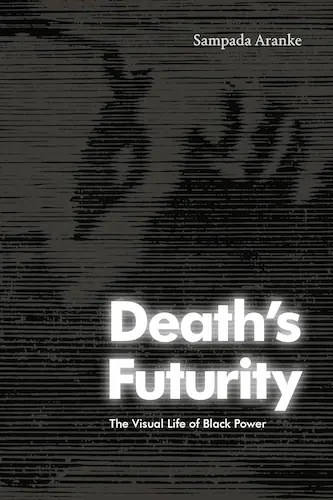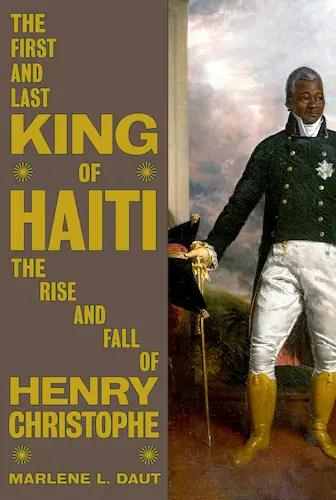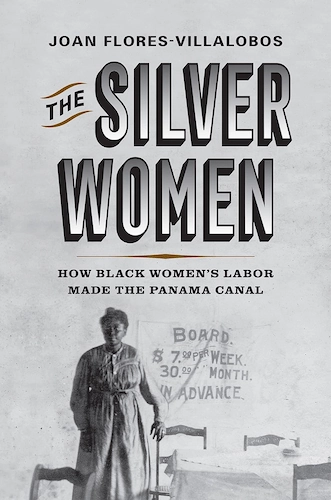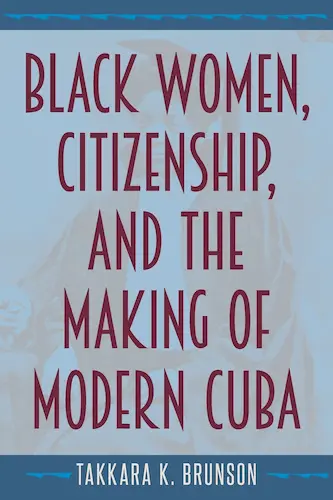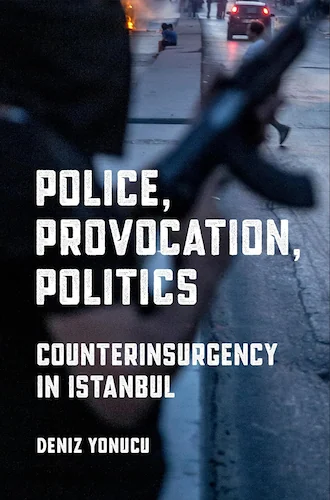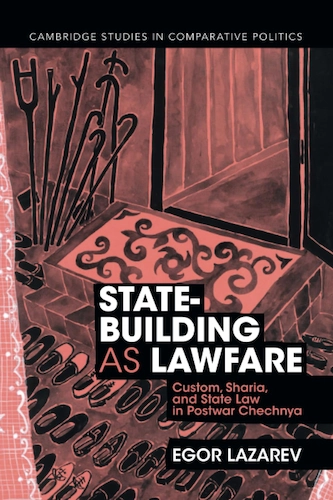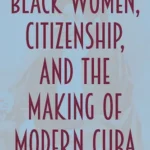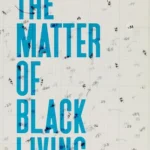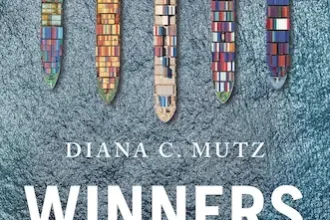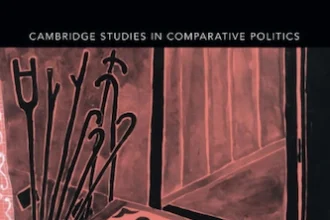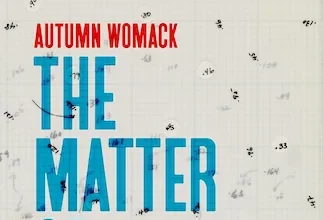Death’s Futurity, lauréat du Prix William Sanders Scarborough 2024 de la Modern Language Association, analyse la manière dont les mouvements radicaux noirs ont répondu à la violence étatique par la culture visuelle, transformant les images de la mort noire en outils politiques de mobilisation.
En se concentrant sur les assassinats de Bobby Hutton, Fred Hampton et George Jackson, le livre soutient que ces morts n’étaient pas seulement des actes de répression, mais aussi des catalyseurs de la résistance. Par une analyse approfondie d’affiches politiques, de médias journalistiques et de films documentaires, l’auteur retrace comment l’imagerie révolutionnaire a été mobilisée pour remettre en question les récits dominants et affirmer des histoires alternatives de lutte.
Fugacité photographique et la politique de la mort noire
L’un des arguments centraux du livre est le concept de « fugacité photographique », qui met en lumière la tension entre visibilité et effacement dans les représentations de la mort noire. La violence étatique cherche à rendre la résistance noire invisible ou criminelle, mais les artistes et militants radicaux ont répondu par une politique visuelle qui réappropriait ces morts en tant qu’actes révolutionnaires.
Le Black Panther Party, par exemple, a utilisé son journal et d’autres médias pour construire une contre-histoire qui défiait les tentatives de l’État de contrôler le récit. L’auteur examine comment les images de Hutton, Hampton et Jackson ont été reproduites, manipulées et diffusées pour maintenir leur présence politique même après leur mort.
L’ouvrage explore également la manière dont le cinéma documentaire a servi de lieu de résistance. The Murder of Fred Hampton constitue une étude de cas essentielle, illustrant comment le film a été utilisé pour documenter et dénoncer la violence étatique. En juxtaposant des images de l’activisme de Hampton avec des preuves de son assassinat, le documentaire élabore un argument visuel qui contredit les récits officiels de l’État.
Selon l’ouvrage, cette stratégie dépasse le cadre du cinéma et s’étend aux affiches politiques, qui représentaient souvent les révolutionnaires noirs comme des martyrs, s’appuyant sur l’iconographie historique et religieuse pour inscrire leur mort dans une logique de sacrifice pour la libération.
Intervention artistique et absence de la mort noire
Une discussion particulièrement marquante porte sur l’assassinat de George Jackson à la prison de San Quentin. Contrairement à Hampton et Hutton, la mort de Jackson n’a pas été largement photographiée, entraînant une autre forme de politique visuelle. L’absence de preuves photographiques directes a conduit des artistes radicaux à réimaginer son image, créant des représentations spéculatives et symboliques pour combler les lacunes laissées par la censure étatique.
L’ouvrage suggère que ces interventions artistiques entrent en résonance avec les premières formes d’activisme contre le lynchage, où refuser de laisser la violence sombrer dans le silence constituait en soi un acte de défiance. En reliant les décès de militants noirs radicaux à une généalogie plus large de la résistance, le livre met en lumière la continuité entre les luttes historiques contre la terreur raciale et les mouvements abolitionnistes contemporains.
Au-delà de son analyse historique, Death’s Futurity aborde des questions théoriques plus larges sur la politique du regard. Il interroge la manière dont la mort noire a été à la fois spectacularisée et réprimée, et comment la culture visuelle radicale a cherché à reprendre le contrôle de ces représentations. L’auteur inscrit ces discussions dans les débats sur la race, la surveillance et le complexe carcéral-industriel, faisant de cet ouvrage non seulement une étude historique, mais aussi une intervention critique dans les discussions contemporaines sur la violence pénitentiaire.
Cet ouvrage constitue une contribution essentielle aux études sur le radicalisme noir, les médias et la pensée abolitionniste. Il propose une exploration nuancée et rigoureusement documentée de la manière dont les images façonnent la mémoire politique et la résistance. Pour ceux qui s’intéressent au radicalisme noir et à la culture visuelle, le livre est disponible ici.