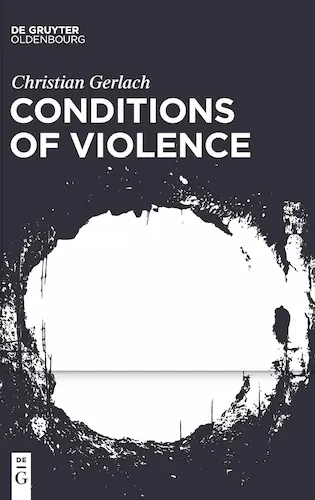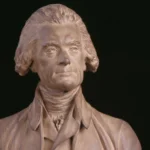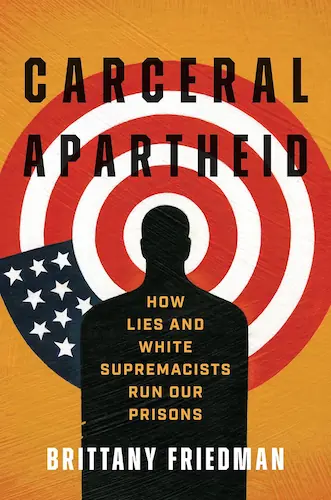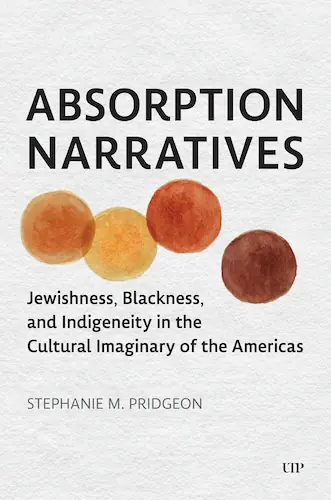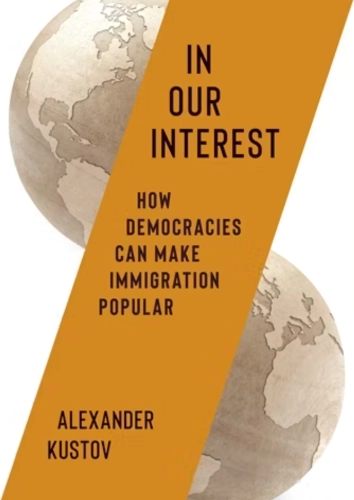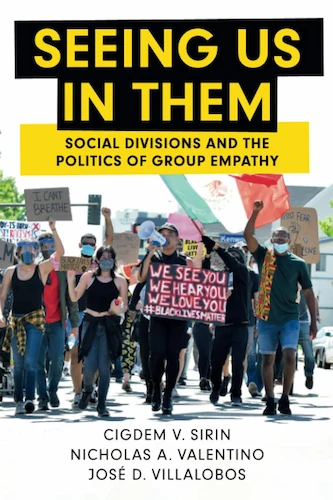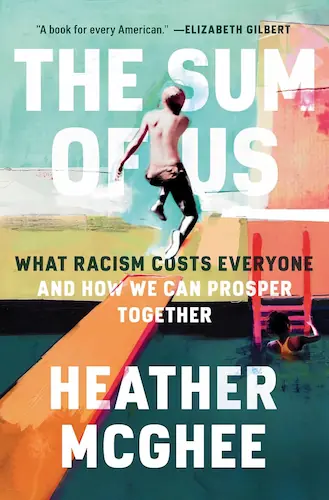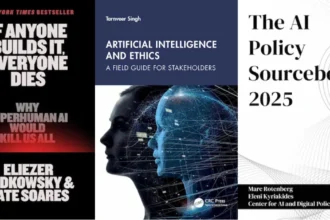Comprendre les « conditions de la violence »
Cet article décrit le concept de conditions de la violence que j’ai récemment introduit dans un ouvrage portant le même titre.[1] Les conditions de la violence désignent les circonstances créées par certains groupes et individus, dans une quête imprudente et implacable de leurs intérêts et de leurs idées, où de nombreuses personnes souffrent et meurent de manière prévisible en quelques semaines, mois ou années.
- Comprendre les « conditions de la violence »
- La Seconde Guerre mondiale et le bilan caché des morts causées par la famine
- Mécanismes d’extraction et de perturbation économique
- Raisonnements, responsabilité et sacrifice racialisé
- Le cas du COVID-19 en tant que violence de masse
- Pratiques sociales et justifications quotidiennes
- Conclusions
La violence de masse n’est pas uniquement le produit de systèmes politiques, d’organisations ou même de structures sociales : elle est créée par des individus. Le livre, dans son ensemble, est une exploration des racines sociales de la violence de masse. Il le fait en examinant la violence comme un processus participatif fondé sur l’interaction sociale. Dans certains chapitres, l’histoire du son sert d’outil pour cette analyse : c’est-à-dire quels bruits étaient audibles lors de certaines persécutions et ce qu’ils révèlent sur le pouvoir politique, les relations et hiérarchies sociales, les conflits, les émotions en jeu, l’action collective, les rôles de genre, les pratiques religieuses et le rôle de la technologie.
L’une de mes conclusions est qu’il faudrait accorder davantage d’attention, dans l’analyse de la violence de masse, aux revendications de la liberté de tuer en tant que droit politique.
Bien que certains chapitres du livre abordent la violence directe sous différentes formes, les sections consacrées aux conditions de la violence visent plutôt à approfondir la compréhension de la violence indirecte. L’une des raisons pour lesquelles cela est important tient au grand nombre de personnes qu’elle tue, tout en suscitant généralement une attention largement insuffisante. Le point commun entre les deux parties du livre réside dans l’intérêt porté aux pratiques.
Les conditions de la violence se distinguent du concept bien connu de violence structurelle. Les deux notions désignent une violence indirecte et un préjudice évitable. Mais alors que la violence structurelle est statique (à long terme), anonyme et abstraite, les conditions de la violence sont dynamiques (à court et moyen terme), impliquent des agents identifiables et sont imposées à certains groupes de population.
La Seconde Guerre mondiale et le bilan caché des morts causées par la famine
Comment cela est-il illustré dans le livre ? Un exemple est la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup savent qu’il s’agissait d’une période de pénuries, mais il est moins connu qu’environ une victime sur trois de la Seconde Guerre mondiale — soit quelque 20 millions de personnes — est morte de faim ou de maladies liées. Des dizaines de famines ont eu lieu en Europe, en Asie, en Afrique et dans le Pacifique.
Parmi les régions les plus durement touchées figuraient Leningrad sous le siège allemand, les camps de prisonniers de guerre allemands pour soldats soviétiques, la Grèce urbaine et rurale sous occupation de l’Axe, les camps soviétiques pour prisonniers de guerre de l’Axe, le Goulag et les lieux où furent envoyées des minorités déportées collectivement en Union soviétique, le Bengale rural sous le colonialisme britannique, l’Iran neutre sous occupation alliée (notamment britannique), l’île de Java rurale, le nord du Vietnam et le Timor oriental sous occupation japonaise, le Henan et d’autres provinces chinoises sous le contrôle du gouvernement nationaliste chinois, mais aussi les colonies belges du Rwanda et du Burundi, les îles du Cap-Vert — colonie portugaise — ainsi que l’Allemagne sous occupation alliée et le Japon sous occupation américaine.
Le fait est que la plupart des famines ont eu lieu dans des pays occupés et des colonies, non seulement dans des zones contrôlées par l’Axe, mais aussi dans de nombreuses régions sous contrôle allié.
Cela s’inscrit dans une histoire plus vaste : entre 1937 et 1947, la majorité de l’humanité — près de 1,4 milliard de personnes — vivait sous occupation étrangère ou sous colonialisme, et cette domination étrangère réduisait les chances de survie.
En y regardant de plus près, les causes des décès massifs par faim durant la Seconde Guerre mondiale ne différaient pas beaucoup entre les pays aux systèmes politiques différents, contrairement à ce que l’on pourrait croire.
Mécanismes d’extraction et de perturbation économique
L’extraction de nourriture n’a été qu’un aspect de cette histoire sombre. Le manque d’intrants agricoles comme les engrais et les machines, la destruction liée à la guerre, la culture forcée de plantes industrielles au lieu de cultures vivrières et la réquisition de nourriture pour nourrir les armées d’occupation et les populations des puissances occupantes ont également joué un rôle. Il en va de même pour les perturbations économiques causées par de nouvelles frontières, des flux commerciaux détournés, des sièges, des embargos et des systèmes de rationnement alimentaire inégalitaires selon des critères raciaux ou ethniques.
Le fait qu’une hégémonie de la violence soit en train de s’établir joue un rôle important dans de nombreux cas de violence de masse.
Cependant, l’extraction de main-d’œuvre sous-payée a probablement eu des effets encore plus graves, souvent prévisibles.
Les colonisateurs et les puissances occupantes rémunéraient les populations locales avec de la monnaie imprimée sans aucune couverture financière, et pratiquement sans leur fournir de biens de consommation.
Inévitablement, cela entraînait de l’inflation, et en cas de catastrophe naturelle ou d’événements militaires défavorables, les prix des denrées alimentaires augmentaient au point que les populations pauvres ne pouvaient plus les acheter (en Europe, surtout les citadins ; en Asie et en Afrique, les ruraux pauvres).
De plus, non seulement l’Allemagne et le Japon avaient mis en place de vastes programmes de travail forcé, mais toutes les puissances coloniales en Afrique ont également élargi leurs dispositifs de travail contraint, y compris la Grande-Bretagne, la Belgique et la « France libre ». Les restrictions au commerce extérieur des colonies et des zones occupées, ainsi que le démantèlement et le transfert des machines, faisaient aussi partie intégrante de ces conditions de violence.
Raisonnements, responsabilité et sacrifice racialisé
À l’époque, tout cela était justifié par des récits (des deux camps) affirmant qu’il s’agissait d’un combat entre le bien et le mal, et que la victoire du « bien » exigeait des sacrifices et la priorité donnée aux intérêts militaires et à certaines populations. En pratique, pourtant, la majorité des sacrifices furent imposés aux populations occupées et colonisées d’une manière profondément raciste, à travers des systèmes complexes d’extraction de valeur capitaliste.
Prenons le cas des Alliés. Au nom de la « sauvegarde de la civilisation », ils ont tué environ 10 millions de personnes non combattantes, souvent par la faim. Fait remarquable, la majorité de ces 10 millions ne venait pas du camp ennemi (Hiroshima était une exception), mais plutôt de leurs propres citoyens, comme dans le Henan et d’autres régions de la Chine républicaine, des minorités ethniques discriminées en Union soviétique, des sujets coloniaux comme en Inde britannique, ou des populations du pays neutre occupé qu’était l’Iran. En d’autres termes, le principal problème qui a entraîné des morts de ce côté n’était pas que l’Axe était prétendument maléfique ; le vrai problème était que les Alliés étaient « bons ».
Découvrez les livres écrits par nos collaborateurs
Les auteurs de ces conditions de violence n’étaient pas seulement des politiciens, des fonctionnaires, des soldats ou un système abstrait. Des intérêts privés et des pratiques sociales y ont aussi participé. Des colons-agriculteurs blancs poursuivaient leurs profits en sachant que les Africains qu’ils employaient — et surtout les familles privées de main-d’œuvre — souffraient. Des soldats allemands et américains achetaient des produits locaux à bas prix dans les pays occupés, au détriment des populations locales, grâce à leurs monnaies artificiellement surévaluées.
Des commerçants allemands, japonais et coloniaux tentaient de faire fortune alors que d’autres mouraient de faim ; des trafiquants du marché noir dans de nombreux pays occupés rivalisaient sans pitié ; et des industriels indiens cherchaient à s’enrichir au milieu de la misère. Et puis, il y avait ces millions de personnes qui acceptaient facilement — et parfois avec enthousiasme — que d’autres reçoivent des rations alimentaires bien inférieures, voire réclamaient activement cette discrimination.
Le bilan des famines de la Seconde Guerre mondiale révèle que les sacrifices ont été principalement imposés à des personnes à la peau plus foncée ou, au sein même des pays concernés, à celles qui étaient méprisées et privées de droits, comme les populations rurales jugées arriérées ou mentalement limitées, ou encore les minorités ethniques. Cela résultait de conditions de violence reflétant des hiérarchies sociopolitiques.
Le cas du COVID-19 en tant que violence de masse
Il est peut-être surprenant — et probablement controversé — que le COVID-19 soit présenté dans le livre comme une autre étude de cas des conditions de la violence. Les pratiques adoptées pendant la pandémie semblaient normales, mais selon moi, c’est justement cette normalité qui posait problème. Les personnes décédées étaient en majorité des personnes âgées, un groupe trop souvent négligé comme victime de la violence de masse de manière générale.
Parmi les pratiques qui ont entraîné des millions d’infections évitables — et donc, indirectement, des décès — on trouve l’affluence dans les bars, restaurants et fêtes, les shopping et voyages non essentiels, ainsi que l’utilisation non protégée (ou plutôt non protectrice) des transports publics. L’attitude la plus caractéristique fut le refus de porter un masque. Ce type de comportement était particulièrement fréquent en Europe et sur le continent américain.
L’exploitation par des entrepreneurs imprudents fut également un facteur important, notamment à travers des logements surpeuplés pour travailleurs migrants sous-payés, que ce soit dans l’agriculture européenne, à Singapour ou dans les pays du Golfe Persique ; ou par la recherche de profits dans des maisons de retraite devenues des pièges mortels, sans parler des hôpitaux inefficaces parce qu’orientés vers la rentabilité. Certains hôtels et commerces ont violé les règles publiques imposant le port du masque obligatoire afin de satisfaire leurs clients.
Pratiques sociales et justifications quotidiennes
Même si cela permet d’incriminer les entreprises (et le capitalisme), des personnes de tous les milieux ont participé à la création de ces pratiques sociales dans les domaines de la consommation et de la reproduction. Et des foules issues de toutes les couches de la société justifiaient ce qu’elles faisaient, y compris des femmes agressives. Loin d’être irréfléchies, les discussions en ligne et les conversations privées étaient remplies de tels raisonnements, dont l’argument central était la défense de la liberté individuelle. Or, dans ces circonstances, il s’agissait en réalité de la liberté d’infecter les autres et donc, souvent, de les tuer.

L’une de mes conclusions est qu’il faut accorder plus d’attention, dans l’analyse de la violence de masse, aux revendications de la liberté de tuer comme un droit politique. Dans le cas du COVID-19, les comportements irresponsables étaient motivés par l’hédonisme, un individualisme agressif et le refus de toute contrainte. Certaines personnes affirmaient aussi vouloir préserver leur dignité et leur qualité de vie (au détriment des autres). La violence est devenue une pratique sociale dominante. Comme je le montre dans le livre, l’établissement d’une hégémonie de la violence joue un rôle important dans de nombreux cas de violence de masse.
Cela implique aussi que de nombreuses personnes issues des classes populaires ont agi de leur propre initiative dans les pratiques mettant la vie en danger durant la pandémie de COVID-19. (Le livre montre une image comparable dans des formes de violence plus directes, comme lors des massacres de 1994 au Rwanda ou dans les violences de foule pendant la guerre d’indépendance du Bangladesh en 1971-1972.) Cela ne signifie pas que les classes populaires ne sont pas, ou ne peuvent pas être, une force progressiste dans l’histoire. Mais cela signifie que, dans le système capitaliste, les classes populaires peuvent devenir une force autonome majeure dans la création de conditions de violence, et pas seulement des marionnettes manipulées par les classes supérieures.
Conclusions
Le concept de conditions de la violence pourrait être utile pour analyser d’autres formes de violence non abordées dans le livre. En particulier, il pourrait s’avérer pertinent pour comprendre la violence libérale soigneusement dissimulée. Parmi ces cas figurent les « sanctions » et les embargos, utilisés massivement et avec férocité contre de nombreuses sociétés aux systèmes politiques variés à travers le monde. Sans aucun doute, en causant la mort de très nombreuses personnes (comme ce fut le cas pendant la Seconde Guerre mondiale), les « sanctions » ont des initiateurs et des partisans implacables au sein de la « société civile » — probablement aussi dans votre pays —, dont l’implication et les motivations méritent d’être examinées.
Les aspects plus indirects du massacre israélien de masse à Gaza, soutenu par un grand nombre de partisans aux profils variés, stupéfiants par leur brutalité, constituent un autre exemple qui pourrait être mieux compris à travers l’idée de conditions de la violence. Un autre exemple, plus banal mais tout aussi révélateur, est la brutalité humaine envers les animaux et la nature dans son ensemble.
Rechercher les conditions de la violence est un outil permettant d’analyser des formes de violence qui ne proviennent ni de massacres directs perpétrés par des régimes ouvertement violents, ni de structures sociales générales. Cet instrument peut être utilisé de diverses manières. On peut poser des questions telles que : qui crée ces conditions ? à travers quels systèmes fonctionnent-elles ? quels sont les groupes ciblés ? qui justifie la création de ces conditions et comment ?
Les pratiques sociales peuvent être interrogées. Les réponses seront complexes, étant donné le caractère participatif des processus en jeu. L’usage de cet outil permettra souvent de dévoiler et de comprendre des violences dissimulées — y compris dans leurs variantes bourgeoises et impérialistes —, fréquemment dissimulées de manière délibérée derrière des larmes de crocodile versées au sujet d’autres formes et acteurs de violence, servant ainsi de diversion.
[1] Cet article s’appuie sur Christian Gerlach, Conditions of Violence (Berlin et Boston : DeGruyter Oldenbourg, 2024), en libre accès sur https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/9783111568737/html