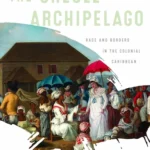Introduction
Pendant que j’écrivais mon livre sur l’innovation, je retrouvais le langage de l’innovation partout. Mon université a construit un nouveau bâtiment : le Frost Center for Research and Innovation. J’ai postulé à des subventions académiques évaluées selon leur caractère innovant. L’école primaire de ma fille a créé un Laboratoire d’Innovation et a envoyé à la maison des boîtes de défis “iInnovate”. J’ai visité le Bezos Center for Innovation au Musée d’Histoire et de l’Industrie de Seattle.
Le terme innovation est si omniprésent que nous risquons de l’ignorer ou d’en minimiser l’importance. Il est tentant de le considérer comme un simple mot à la mode, dénué de sens. Pourtant, mon livre, Reproductive Labor and Innovation: Against the Tech Fix in an Era of Hype, soutient que l’essor soudain du discours sur l’innovation aux États-Unis au cours des dernières décennies est en réalité un phénomène politique et économique majeur qui mérite une attention académique sérieuse.
Le choix ne peut être compris comme équivalent à la liberté, car les structures politiques, économiques et sociales façonnent les options dont nous disposons et influencent la manière dont nous prenons nos décisions.
Mon livre analyse différentes manifestations de l’innovation, comme son utilisation au Bezos Center for Innovation et dans les boîtes iInnovate de ma fille. Ce faisant, il explore la logique de l’innovation et ses implications pour la justice sociale. L’un des arguments clés du livre est qu’aux États-Unis, la surévaluation de l’innovation est liée à l’essor de politiques et de croyances qui ont encore davantage dévalorisé le travail du care.
Politique d’innovation contre politique reproductive
Pendant une grande partie de son histoire, qui remonte à la Grèce antique, l’innovation avait une connotation négative, perçue comme une menace pour le statu quo. Cependant, dans les années 1970, elle a acquis ses connotations contemporaines de résolution de problèmes, de nouveauté et de rentabilité. C’est à cette époque que les États-Unis ont mis en place des politiques visant à stimuler l’innovation.
Ces politiques d’innovation comprenaient tout, de la déréglementation à l’incitation à utiliser la recherche financée par des fonds publics comme base pour des brevets et l’accumulation de richesse privée. L’idée que les innovations résolvent toutes sortes de problèmes et constituent le fondement de la prospérité et de la domination économique des États-Unis a servi à justifier ces politiques. Selon cette logique, les politiques publiques devaient encourager les entreprises privées à innover, car l’innovation profitait au bien commun.
Au même moment où les politiques d’innovation se développaient, les États-Unis réduisaient le soutien public au travail du care, ou ce que j’appelle le travail reproductif. Ce travail, majoritairement effectué par des femmes, consiste à prendre soin des autres et de nos communautés à travers des activités telles que l’éducation des enfants et le soin des personnes malades, en situation de handicap ou âgées. Bien que ce travail ait toujours été sous-évalué et mal rémunéré, il a subi plusieurs transformations à la fin du XXᵉ siècle.
Non seulement l’État a réduit l’aide sociale, sous l’effet du racisme anti-Noir et de la diabolisation des femmes noires, mais davantage de femmes ont intégré le marché du travail professionnel. Ces femmes, majoritairement blanches, avaient tendance à employer des femmes racisées pour effectuer un travail de care précaire et mal rémunéré.
À mesure que l’industrie des services de care s’est développée, le travail du care est resté stratifié selon des critères raciaux. Seules certaines personnes pouvaient accéder aux soins sur le marché. Le fait de porter et d’élever des enfants était perçu davantage comme une responsabilité individuelle que comme un bien collectif devant bénéficier d’un soutien public. Cela a conduit à l’émergence de la fracture du care : le besoin non satisfait en travail de care.
Surestimer l’innovation, dévaloriser la reproduction
Cette analyse met en évidence les différentes manières dont les politiques et les acteurs publics ont conçu l’innovation par opposition à la reproduction. Selon la vision dominante, les ressources publiques et les réglementations doivent être utilisées pour inciter les entreprises à innover car l’innovation est bénéfique pour tous. Or, cette approche masque le fait que ces prétendues solutions technologiques favorisent souvent l’accumulation de richesses et l’influence politique et économique excessive d’une minorité, accentuant ainsi les inégalités de richesse et de pouvoir politique.
La justice reproductive et la justice pour les personnes en situation de handicap ouvrent ainsi la voie à un autre monde, un monde où le care prime sur l’innovation.
À l’inverse, les politiques ont considéré le travail reproductif comme un bien et une responsabilité individuels. Selon cette perspective, le soutien public au travail reproductif est injustifié, voire injuste. Pourtant, cette vision occulte le fait que le travail reproductif constitue le fondement de nos communautés, de nos économies et de nos sociétés. Le travail du care est ainsi à la base de toute véritable innovation.
Dans Reproductive Labor and Innovation, j’examine comment la surestimation de l’innovation technologique est liée à la dévalorisation du travail reproductif aux États-Unis. Je soutiens qu’il existe des liens matériels et symboliques entre ces deux phénomènes. Par exemple, les baisses d’impôts pour les entreprises, supposément destinées à favoriser l’innovation, ont contribué à justifier la réduction du soutien à l’aide sociale et au travail d’éducation des enfants.
De plus, lorsque les acteurs étatiques et économiques présentent les innovations technologiques comme la réponse à tous les problèmes sociaux, ils minimisent implicitement, et parfois explicitement, l’importance du travail du care pour le bien-être de la société. Ainsi, la tendance à investir dans les innovations technoscientifiques et à les promouvoir comme des solutions contribue souvent à la dévalorisation du travail reproductif.
Innovations reproductives numériques
Les acteurs corporatifs et étatiques présentent souvent l’innovation technologique comme la solution à tous les problèmes, y compris ceux qui touchent la reproduction elle-même. Pourtant, comme pour d’autres innovations, les « solutions » technoscientifiques en matière de reproduction ont tendance à masquer et à aggraver les problèmes structurels. Ces prétendues solutions offrent l’illusion d’un plus grand contrôle individuel, tout en affaiblissant et en sapant les réponses collectives axées sur la justice reproductive.

L’une des « solutions » technologiques que j’examine dans le livre est l’essor des plateformes numériques permettant de trouver et d’embaucher des travailleurs du care. Des plateformes comme Care.com, sur lesquelles les parents et d’autres employeurs peuvent recruter des travailleurs domestiques comme des nourrices, prétendent combler le manque de services de care. Care.com a promu ses services en déclarant : « Nous utilisons la technologie et l’innovation pour résoudre l’un des plus grands défis de l’humanité. » Pourtant, cette « solution » masque les causes structurelles des problèmes et pourrait les aggraver.
De nombreuses biotechnologies reproductives émergentes transforment actuellement le paysage de la reproduction.
Par exemple, des recherches indiquent que les travailleurs qui trouvent un emploi via Care.com ne bénéficient ni de salaires plus élevés ni de conditions de travail moins précaires. Au contraire, ces plateformes encouragent les travailleurs à effectuer de nouvelles formes de travail non rémunéré. Les candidats doivent construire une image de fiabilité, de réactivité et d’em
Les entreprises elles-mêmes ne prennent aucune responsabilité en cas de problème dans la relation de travail. Pourtant, les plateformes tirent profit du travail des soignants et facturent des frais aux personnes recherchant des services de care. Elles véhiculent une idéologie entrepreneuriale qui encourage les travailleurs du care à percevoir leur activité comme une forme d’autonomisation plutôt que comme un travail générant de la richesse pour autrui.
Biotechnologies
D’autres « solutions » technologiques en matière de reproduction ciblent les processus biologiques. De nombreuses biotechnologies reproductives émergentes transforment actuellement le paysage de la reproduction. Ces avancées sont soutenues par d’importants investissements privés. Les capital-risqueurs et autres investisseurs prennent des décisions stratégiques sur les technologies à développer, misant sur des innovations qu’ils espèrent rentables. Ainsi, les financiers redéfinissent la biotechnologie de la reproduction, avec des conséquences majeures pour l’humanité.
À titre d’exemple, plusieurs start-ups en biotechnologie travaillent sur le développement d’un procédé appelé gamétogenèse in vitro (GIV). La GIV est une technique qui permet de produire des spermatozoïdes et des ovules à partir de cellules de la peau. Si elle est mise au point avec succès, cette technologie pourrait permettre la création d’un nombre pratiquement illimité d’embryons. Ces embryons pourraient ensuite être sélectionnés à l’aide des technologies actuelles de dépistage génétique afin que les futurs parents puissent choisir une descendance « optimale ».
La GIV pourrait être utilisée dans un but louable : permettre aux personnes qui ne peuvent pas procréer naturellement—comme celles souffrant d’infertilité ou les couples queer—d’avoir des enfants. Cependant, certains partisans de cette technologie et d’autres innovations génétiques reproductives la vantent pour sa capacité à « améliorer » l’humanité et à créer des humains « supérieurs ». Un tel raisonnement rappelle les croyances eugénistes du déterminisme génétique et le classement des êtres humains en fonction de leurs gènes.
L’un des partisans de l’ingénierie génétique appliquée aux humains, l’ancien philosophe d’Oxford et auteur à succès du New York Times Nick Bostrom, va jusqu’à affirmer que les humains génétiquement modifiés pour l’intelligence seraient plus innovants. Selon lui, ces individus seraient mieux placés pour résoudre un large éventail de problèmes mondiaux, du changement climatique aux inégalités, en passant par les politiques scientifiques et technologiques.
Responsabilité individuelle contre solutions collectives
La vision de Bostrom représente l’idéologie de l’innovation poussée à l’extrême. Plutôt que de considérer les problèmes mondiaux comme des enjeux politiques nécessitant des changements structurels, Bostrom fétichise les humains surintelligents comme la solution à nos problèmes. Il n’est pas irréaliste de penser que certains futurs parents choisiraient l’« amélioration » génétique si cette possibilité leur était offerte. Ils pourraient alors percevoir leurs enfants comme supérieurs et juger les parents refusant l’ingénierie génétique.
Cette prétendue solution technologique, comme d’autres, risque de dévaloriser encore davantage le travail reproductif et de renforcer l’idée qu’il s’agit avant tout d’une responsabilité individuelle. Dans un contexte où le soutien public à l’éducation des enfants est déjà réduit et diabolisé, les parents pourraient se raccrocher à l’illusion du contrôle individuel qu’offrent les technologies reproductives. Si vous pouviez avoir un enfant « amélioré », mieux préparé à affronter une économie précaire, pourquoi ne pas le faire ?
Cette approche technologique renforce l’idée que la procréation et l’éducation des enfants sont des préoccupations individuelles. Pourtant, cette vision est en contradiction avec la responsabilité collective et sociale du soin et du soutien de tous les enfants. Dès lors, que peut-on faire pour combattre ou inverser la surestimation des innovations technologiques ?
Conclusion
Tout au long du livre, je m’appuie sur les cadres de la justice pour les personnes en situation de handicap et de la justice reproductive. Ces approches ont été développées principalement par des personnes racisées pour critiquer les conceptions individualistes des droits, qui ignorent les rapports de pouvoir et les injustices intersectionnelles. Par exemple, le terme justice reproductive a été inventé par des militantes noires en réaction à l’accent mis sur le choix dans les organisations traditionnelles de défense des droits reproductifs.
Découvrez les livres écrits par nos collaborateurs
Applying these frameworks to reproductive technology shows us the importance of looking at things like the policies that underpin the development of technologies. Rather than focusing solely on the choices that confront caretakers and prospective parents, these frameworks ask us to interrogate how people come to be presented with a certain set of options in the first place. They call for structural economic change.
La justice reproductive et la justice pour les personnes en situation de handicap ouvrent ainsi la voie à un autre monde, un monde où le care prime sur l’innovation. Un concept clé de la justice pour les personnes en situation de handicap est la notion d’interdépendance. Cette idée remet en question le mythe de l’indépendance qui justifie de considérer le travail reproductif comme une responsabilité individuelle. L’interdépendance met aussi en lumière nos liens mutuels et notre dépendance fondamentale aux autres, soulignant la nécessité d’un soutien matériel pour le travail du care.