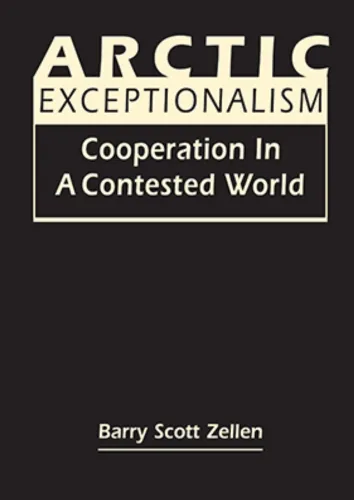De la neutralité nordique à la frontière arctique de l’OTAN
Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, on assiste à un bouleversement majeur de la diplomatie et de la sécurité dans l’Arctique, marqué par le boycott diplomatique du Conseil de l’Arctique (CA) en mars 2022, durant la présidence tournante de la Russie (2021-2023), suivi du revirement rapide de la Finlande et de la Suède, qui ont abandonné leurs politiques de neutralité bien établies pour devenir membres à part entière de l’OTAN. La Finlande a rejoint officiellement l’alliance il y a deux ans, le 4 avril 2023, et la Suède l’a suivie il y a seulement 13 mois, le 7 mars 2024.
- De la neutralité nordique à la frontière arctique de l’OTAN
- Un « Rideau de glace » freine la coopération dans l’Arctique
- Territoires autochtones divisés par un nouveau conflit arctique
- L’effondrement de la sécurité arctique à plusieurs niveaux
- Repenser l’isolement de la Russie et le risque pour la coopération circumpolaire
- Le long chemin du retour : restaurer une coopération arctique inclusive
- Les États-Unis envisagent une expansion dans l’Arctique, mettant la pression sur l’OTAN et le Conseil de l’Arctique
- Un revirement soudain : rapprochement entre les États-Unis et la Russie et fracture de l’OTAN
- Pourquoi l’expansion arctique de l’OTAN échoue
Avec la fin soudaine de la neutralité historique de la Finlande et de la Suède—si déterminante à bien des égards pour l’ouverture et la dynamique de coopération de la région nordique, longtemps encadrée par la Norvège (membre fondateur de l’OTAN depuis 1949) et la Russie (principal adversaire de l’OTAN à l’époque soviétique)—s’est renforcée l’unité de l’alliance et l’intégration militaire entre les sept États démocratiques membres du Conseil de l’Arctique (connus jusqu’à récemment sous le nom d’« Arctic 7 » ou « A7 »), laissant de côté la Russie, dont les territoires les plus septentrionaux couvrent la moitié de la région arctique, et dont l’économie et la population arctiques dépassent celles de tous les autres membres réunis.
Un « Rideau de glace » freine la coopération dans l’Arctique
Cela a entraîné un durcissement des frontières par des déploiements et des fortifications militaires, érigeant un nouveau « Rideau de glace » à travers l’Arctique, tout aussi clivant que le « Rideau de fer » établi au début de la dernière guerre froide, qui divisait physiquement l’Europe entre blocs militaires rivaux. L’expansion nordique de l’OTAN a d’abord été présentée comme une victoire pour l’Occident et une étape nécessaire pour protéger l’Arctique face à une Russie redevenue menaçante et expansionniste.

Bien que l’expansion de l’OTAN ait été déclenchée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, les tensions entre la Russie et l’Occident dans l’Arctique étaient déjà en hausse, comme en témoignent les nouvelles déclarations de politique arctique et les stratégies révisées dans les pays occidentaux au cours des années précédentes. Parce que la coopération dans l’Arctique repose non seulement sur une collaboration multilatérale est-ouest, mais aussi sur une coopération nord-sud entre États et peuples autochtones, cette nouvelle division en blocs arctiques renaissants menace l’unité transnationale et autochtone de l’Arctique, plusieurs territoires indigènes subissant une partition de facto, annulant les avancées réalisées depuis la fin de la guerre froide.
Territoires autochtones divisés par un nouveau conflit arctique
Cela a fragilisé l’unité transnationale du Conseil sami, dont les communautés membres s’étendent de part et d’autre de la nouvelle frontière entre la Russie et l’OTAN, ainsi que celle du Conseil circumpolaire inuit (CCI), dont les membres couvrent la frontière entre la Russie et l’Alaska. Comme les Samis, les Inuits voient désormais leurs terres ancestrales prises pour cible dans une lutte internationale.

L’Association internationale aléoute (AIA) est elle aussi divisée. Bien que, comme le CCI, la plupart de ses communautés membres se trouvent du côté de l’OTAN, le flux sortant de réfugiés depuis le début de la guerre—traversant les frontières terrestres entre la Russie et la Finlande ainsi que les frontières maritimes glacées entre la Sibérie et l’Alaska—indique un autre vecteur potentiel de confrontation susceptible d’englober l’Arctique, autrefois isolé, dans un conflit armé en pleine expansion.
Bien que la guerre en cours reste confinée à l’Europe centrale, le risque d’escalade au-delà de l’Ukraine est omniprésent, les attaques de drones ukrainiens atteignant déjà l’Arctique russe, tandis que les forces armées des deux camps renforcent leur présence dans la région. Les pressions exercées sur les dirigeants autochtones pour qu’ils soutiennent leur pays en temps de guerre, des deux côtés, ont déjà eu un effet dissuasif sur la liberté d’expression autochtone, principalement à travers une autocensure croissante de la part de leaders auparavant très engagés.
En Russie, les risques se sont révélés encore plus graves que la censure : l’exil, l’emprisonnement et l’assassinat sont des menaces croissantes pour les dirigeants autochtones qui s’expriment librement, et les déploiements disproportionnés de peuples non russes et isolés en première ligne ont vidé de nombreux villages arctiques de leurs hommes en âge de combattre, les pertes militaires non russes étant particulièrement élevées. Comme l’a décrit Miranda Bryant dans The Guardian : « En Russie, les Samis sont contraints de cacher leur identité et de vivre ‘hors la loi’ par crainte d’être emprisonnés ou persécutés, ont averti des membres éminents de la communauté, » après que « le ministère russe de la Justice a ajouté 55 organisations autochtones à une liste de terroristes et d’extrémistes. »
L’effondrement de la sécurité arctique à plusieurs niveaux
La guerre en Ukraine a transformé à la fois la pratique de la diplomatie arctique et la manière dont on conçoit la sécurité dans l’Arctique, laquelle, depuis la Stratégie de protection de l’environnement arctique (AEPS) de 1991 et son évolution en 1996 vers le Conseil de l’Arctique, se caractérisait par une coopération distinctive : multilatérale est-ouest (internationale) et multiniveau nord-sud (entre autochtones et États).
Ce « mosaïque de coopération », ainsi que l’a fameusement décrit Oran R. Young, pionnier des relations internationales dans l’Arctique, a offert à la région arctique une stabilité durable fondée sur cette collaboration exceptionnelle.
La nouvelle division de l’Arctique en blocs rivaux risque de faire taire la pluralité de voix qui, jusqu’à présent, définissait la région et renforçait sa coopération multilatérale et multiniveau.
Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la sécurité dans l’Arctique s’est durcie pour se concentrer presque exclusivement sur une nouvelle menace militaire perçue de la part de la Russie envers la région arctique, reléguant au second plan les anciens piliers d’une sécurité plus holistique (environnementale, humaine, culturelle et autochtone) qui prédominaient depuis la fin de la guerre froide, mais qui sont aujourd’hui presque oubliés alors que l’Arctique se remilitarise à un rythme effréné.
Repenser l’isolement de la Russie et le risque pour la coopération circumpolaire
Ironiquement, alors même que la Russie lançait sa guerre expansionniste dans le sud-ouest, Moscou restait engagée, au début de son mandat de présidence tournante du Conseil de l’Arctique (2021-2023), en faveur de la coopération avec ses voisins circumpolaires, quel que soit leur appartenance à une alliance.

L’idée selon laquelle la Russie pouvait et voulait continuer à entretenir une coopération arctique, même en étant impliquée dans des conflits régionaux aussi éloignés que la Syrie, la Libye ou l’Ukraine (à l’exception d’une brève interruption en 2014, lorsque les représentants des États-Unis et du Canada au Conseil de l’Arctique ont boycotté une réunion à Moscou en signe de protestation), était la vision dominante tant chez les États membres du Conseil que chez ses participants permanents autochtones, de 1996 jusqu’au début de l’année 2022.
En effet, la Russie représente toujours à elle seule la moitié du monde circumpolaire, et l’exclure de la coopération arctique ne punit pas seulement Moscou : cela met en péril les fondements mêmes de la coopération dans l’Arctique et la stabilité de la région. Gouverner efficacement et pacifiquement l’Arctique, et maintenir un engagement multilatéral en faveur de la protection de l’environnement arctique et de l’atténuation des dangers collectifs du changement climatique, nécessite toujours la participation de la Russie pour réussir. Les peuples autochtones de l’Arctique en sont conscients depuis le début de la guerre.
Comme l’a déclaré Edward Alexander, coprésident du Gwich’in Council International (GCI), un Participant Permanent du Conseil de l’Arctique, dans High North News : « Il n’y a pas de solution militaire aux problèmes du Nord. Nous voulons des solutions diplomatiques. Nous ne nous battons pas avec nos amis pour résoudre des problèmes. Nous discutons et faisons des compromis. »
Alors que les dirigeants du A7 mettaient en avant la menace croissante que représente la Russie pour l’Occident, les dirigeants autochtones de l’Arctique exprimaient leur empathie envers les peuples autochtones de Russie. Le chef Gary Harrison du Arctic Athabaskan Council (AAC), une autre organisation participante permanente au sein du Conseil, a déclaré qu’il « est profondément préoccupé par la population autochtone de Russie, qui vit derrière le nouveau rideau de fer. ‘Presque tous, nous avons de la famille dans l’Arctique russe. Nous avons besoin de savoir comment ils vont. Par exemple, avons-nous entendu dire que les autorités russes forcent les autochtones à rejoindre l’armée, et cela nous inquiète.’ »
Le long chemin du retour : restaurer une coopération arctique inclusive
Reprendre l’engagement avec la Russie et les peuples autochtones —comme l’a fait la Norvège durant sa présidence tournante du Conseil de l’Arctique (2023-2025)— en pleine guerre en Ukraine et face aux conséquences complexes à venir, contribuera à faire de l’Arctique cette zone de paix imaginée par Gorbatchev, dont le décès à une époque aussi troublée nous rappelle la fragilité de la paix arctique que nous avons longtemps connue.

La guerre menée par la Russie est désormais entrée dans sa quatrième année, se transformant en un conflit d’usure violent qui a ravagé à la fois l’est de l’Ukraine et l’ouest de la Russie, chaque pays occupant actuellement une partie du territoire de l’autre, et le risque d’une escalade au-delà du théâtre actuel restant toujours présent (le déploiement de troupes d’élite nord-coréennes pour défendre conjointement les frontières occidentales de la Russie en étant un signe inquiétant de ce qui pourrait advenir).
Les peuples autochtones de Russie ont été envoyés de manière disproportionnée en première ligne, alors que Moscou s’efforce de préserver les conscrits russes de tels dangers, vidant les villages du nord et laissant ses propres populations arctiques dans une grande détresse, soumises à une forte pression pour afficher leur soutien à la guerre.
L’Ukraine, dans ses efforts pour réduire les menaces posées par la puissance aérienne russe, a lancé des attaques de drones contre des bases aériennes russes dans l’Arctique, introduisant la guerre dans la région arctique pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Les peuples autochtones de l’Arctique se retrouvent véritablement pris au piège au cœur de ce chaudron de conflits, leurs terres ancestrales divisées par ce qui ressemble de plus en plus à une nouvelle guerre froide arctique. La réconciliation dans un tel contexte ne sera pas facile. Mais l’OTAN est, avant tout, une alliance de démocraties liées par des valeurs communes et des cultures politiques inclusives.
Les États-Unis envisagent une expansion dans l’Arctique, mettant la pression sur l’OTAN et le Conseil de l’Arctique
Cela semble avoir été oublié alors qu’un nouveau conflit régional, inattendu, embrase le Groenland, où les États-Unis ont remis en question la tutelle du Danemark sur l’île et exprimé un désir croissant de l’annexer pour en faire un territoire ou un État américain. Tout en ciblant Copenhague, la Maison-Blanche a tenté – jusqu’à présent sans succès – de rassurer la population groenlandaise, en affirmant pouvoir mieux répondre à ses besoins.
Bien que les différends internes à l’alliance ne soient pas nouveaux pour l’OTAN —les conflits passés entre la Grèce et la Turquie, ou entre l’Islande et le Royaume-Uni, ayant été surmontés sans faire éclater l’alliance— cette fois, c’est le garant militaire et chef de l’alliance lui-même qui menace la souveraineté d’un de ses membres et cherche à démanteler le Royaume du Danemark.
Un revirement soudain : rapprochement entre les États-Unis et la Russie et fracture de l’OTAN
Dans le même temps, la Maison-Blanche s’est empressée de rétablir les liens avec la Russie et de renouer une relation plus collaborative et mutuellement respectueuse. Un tel rapprochement pourrait rétablir la stabilité Est-Ouest dans l’Arctique ainsi qu’à l’échelle mondiale, offrant de nouvelles perspectives pour relancer la coopération arctique entre les États-Unis et la Russie. Le pivot de Washington vers Moscou bouleverse, à bien des égards, la dynamique en place dans l’Arctique depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, et ce rapprochement n’est pas universellement accueilli par les autres États arctiques démocratiques, qui restent inquiets vis-à-vis de la Russie et craignent que les États-Unis ne compromettent désormais leurs intérêts en matière de sécurité, comme ils le font actuellement avec l’Ukraine.
Dans les mois à venir, avec une OTAN en crise et les membres démocratiques du Conseil de l’Arctique —si récemment unis— désormais divisés par un conflit interne à l’alliance, les motifs d’inquiétude dans l’Arctique sont nombreux. Toutefois, le rétablissement d’une relation diplomatique positive entre les États-Unis et la Russie contribue à désamorcer l’un des risques de sécurité les plus pressants auxquels la région a été confrontée ces dernières années : l’agression continue de la Russie contre l’Occident, que la Maison-Blanche pourrait désormais être mieux placée pour dissuader, grâce à un rapprochement accru avec Moscou.
Reste à savoir si cela suffira à rassurer la Finlande et la Suède, qui s’étaient tournées vers l’Occident pour leur défense collective, pour finalement voir l’OTAN elle-même sombrer dans ce qui pourrait bien devenir une crise existentielle. Elles en viendront peut-être bientôt à regretter leur époque de neutralité, lorsqu’elles ne dépendaient pas entièrement des États-Unis ni de leurs partenaires de l’OTAN pour assurer leur survie.
Pourquoi l’expansion arctique de l’OTAN échoue
Ce qui avait commencé comme une démonstration d’unité face à l’agression russe révèle désormais ses contradictions internes. L’élargissement nordique de l’OTAN, autrefois présenté comme une mesure de stabilisation, a fracturé les alliances mêmes qu’il visait à renforcer—divisant les organisations autochtones, paralysant la diplomatie arctique et provoquant des tensions intra-alliées, de la Groenland au Baltique.
Au lieu de renforcer la coopération, l’élargissement a accéléré la militarisation, ravivé les divisions de la guerre froide et miné l’esprit multilatéral qui définissait autrefois la gouvernance de l’Arctique. En isolant totalement la Russie et en dépassant sa propre cohérence stratégique, l’OTAN a peut-être affaibli sa capacité à gérer la région qu’elle est désormais tenue de défendre.