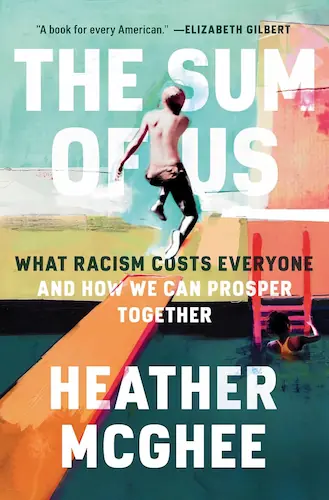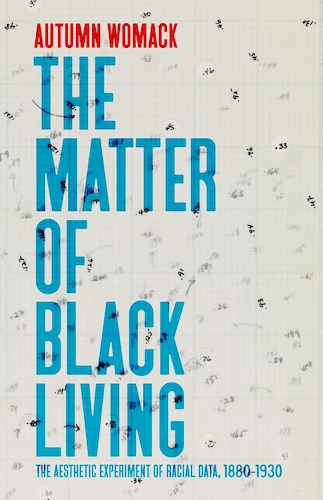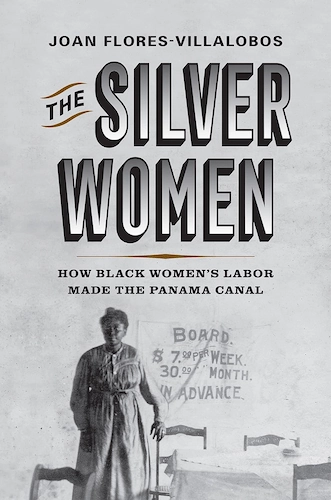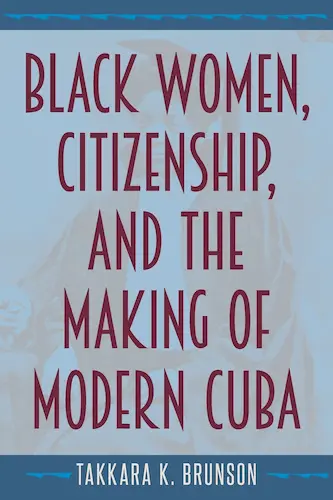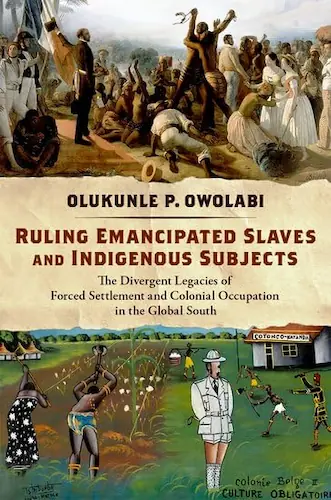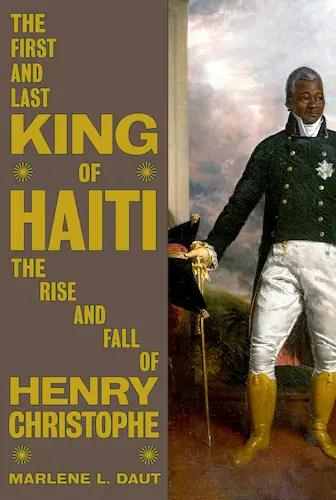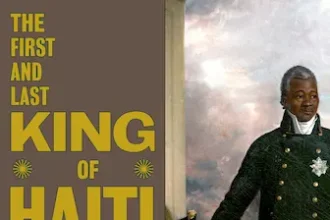Un ouvrage qui redéfinit le prix de l’inégalité
Lauréat du Prix Robert F. Kennedy des droits humains 2022, La somme de nous : le coût du racisme pour tous et comment prospérer ensemble de Heather McGhee est bien plus qu’une enquête percutante sur l’injustice raciale.
- Un ouvrage qui redéfinit le prix de l’inégalité
- Le leurre du jeu à somme nulle
- Biens publics et piège de la privatisation
- Les coûts cachés du racisme
- Race, économie et mythe américain de la méritocratie
- Un plan pour la prospérité collective
- Pourquoi ce livre est essentiel aujourd’hui
- Un appel à réimaginer ce que nous partageons
C’est un argument profondément humain et fondé sur des données, montrant que le racisme — en particulier la logique du « jeu à somme nulle » qu’il engendre — appauvrit tout le monde. McGhee, experte reconnue en politiques publiques et ancienne présidente du think tank Demos, parcourt les États-Unis pour recueillir des récits, des faits et des expériences qui dévoilent la logique structurelle de l’inégalité et, surtout, le potentiel de la solidarité pour bâtir une société plus équitable et prospère pour tous.
Le leurre du jeu à somme nulle
Au cœur de la thèse de McGhee se trouve la déconstruction du « paradigme à somme nulle » : la croyance selon laquelle les gains des uns entraînent inévitablement des pertes pour les autres.
Selon McGhee, cette idée a été instrumentalisée dans le discours politique et économique américain pour justifier des politiques qui nuisent de manière disproportionnée aux communautés racisées, tout en privant également les Américains blancs de certains avantages.
Son exemple le plus emblématique — la fermeture de piscines publiques dans plusieurs villes pour éviter l’intégration raciale — montre comment le racisme peut engendrer des pertes collectives plutôt que des gains individuels. De telles décisions illustrent comment la peur de l’équité raciale conduit à la destruction de biens publics profitant à l’ensemble de la population.
Biens publics et piège de la privatisation
À travers des récits de quartiers délaissés, d’écoles sous-financées et de droits du travail érodés, McGhee montre comment les systèmes publics ont été volontairement démantelés sous couvert de conservatisme budgétaire et de ressentiment racial.
Les programmes universels — comme l’éducation publique de qualité, les soins de santé ou l’aide au logement — sont trop souvent perçus comme des aides offertes à des personnes « non méritantes », plutôt que comme des investissements dans une société plus saine et productive.
En vérité, affirme McGhee, ces systèmes s’effondrent non pas parce qu’ils sont inefficaces, mais parce que leur association avec l’inclusion raciale suscite l’opposition d’une partie de l’électorat blanc. Ce paradoxe a permis à la privatisation de s’imposer, accentuant les inégalités et réduisant la qualité de vie pour tous.
Les coûts cachés du racisme
Ce que McGhee appelle le « dividende de la solidarité » constitue sa réponse à cette mentalité enracinée de somme nulle.
Elle montre comment des coalitions interraciales ont réussi à améliorer les conditions non seulement pour les minorités, mais aussi pour les Blancs de la classe ouvrière.
Des victoires syndicales aux campagnes environnementales, ces exemples montrent que des intérêts communs — air pur, salaires équitables, accès à la santé — transcendent les clivages raciaux lorsque les communautés s’unissent. Mais McGhee souligne aussi que la solidarité demande un véritable engagement : elle suppose de désapprendre les préjugés transmis et de déconstruire les mythes qui divisent.
Race, économie et mythe américain de la méritocratie
McGhee remet en question l’idée selon laquelle les États-Unis seraient un pays d’égalité des chances, en montrant comment le racisme systémique fausse les marchés, pénalise l’ambition et freine la mobilité sociale.
Découvrez les livres écrits par nos collaborateurs
Les pratiques de prêt discriminatoires, le zonage excluant et les politiques de justice pénale biaisées racialement ne visent pas seulement des individus : elles façonnent la structure économique de communautés entières.
Et les coûts se répercutent : les saisies immobilières et l’incarcération de masse ne sont pas des problèmes isolés. Leurs effets se propagent, compromettant la stabilité économique nationale et aggravant les crises de santé publique.
Un plan pour la prospérité collective
Plutôt que de s’enliser dans la critique, La somme de nous propose une vision positive : un pays où la prospérité partagée remplace les boucs émissaires raciaux. McGhee invite les lecteurs à adopter une politique de réciprocité, fondée sur la conviction que nous pouvons faire mieux—ensemble.
Ses entretiens avec des organisateurs, des innovateurs en politiques publiques et des citoyens ordinaires donnent un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler cet avenir.
De l’élargissement de l’accès au vote à une nouvelle approche de la justice climatique, McGhee dessine une voie vers un progrès collectif fondé sur la clarté morale et une solidarité concrète.
Pourquoi ce livre est essentiel aujourd’hui
Dans un contexte de polarisation croissante et de rejet des initiatives en faveur de la diversité, La somme de nous constitue un contrepoids essentiel. Elle plaide avec urgence que démanteler le racisme n’est pas seulement un impératif moral, mais aussi une nécessité pragmatique.
En montrant que l’exclusion affaiblit inévitablement le tissu social de tous, McGhee déplace le récit de la culpabilité vers celui de la possibilité. Son travail invite les lecteurs — en particulier ceux qui ne sont pas directement touchés par l’injustice raciale — à considérer l’équité comme un investissement commun plutôt qu’une œuvre de charité.
Un appel à réimaginer ce que nous partageons
La somme de nous n’est pas seulement un ouvrage de référence en matière d’analyse sociale, c’est aussi une feuille de route porteuse d’espoir vers une Amérique plus inclusive et équitable.
Heather McGhee nous rappelle que le racisme a un coût pour tous, et que les fruits de la solidarité sont à portée de main. À une époque où le cynisme domine souvent, son message est à la fois urgent et porteur d’espoir : nos destins sont liés, et ensemble, nous pouvons prospérer. Le livre est disponible ici.