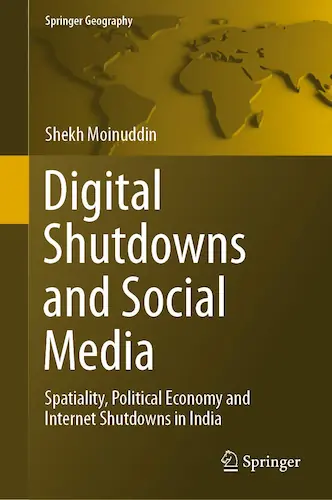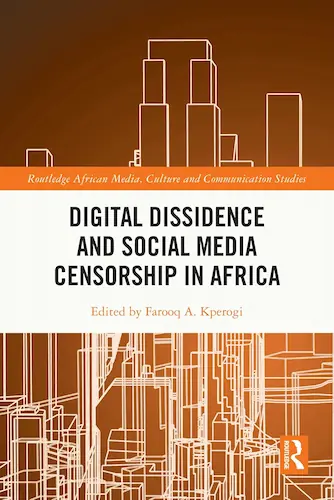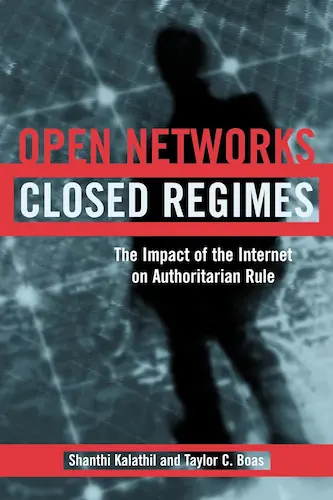Selon le rapport 2024 de Surfshark sur la censure d’Internet, les coupures d’Internet sont devenues une tactique clé du contrôle autoritaire au cours de la dernière décennie. Au cours des dix dernières années, plus de 650 interruptions ont été recensées en Asie, touchant plus de 4,3 milliards de personnes—soit environ 91 % de la population du continent.
- Coupures d’Internet : Une méthode de contrôle, pas une réponse au chaos
- De Téhéran à Cuba : études de cas sur la répression numérique
- Au-delà de la coupure : impacts à long terme sur la société civile
- Une zone grise juridique qui favorise les abus
- Le rôle des entreprises technologiques et des acteurs internationaux
- Coupures d’Internet et avenir des droits numériques
L’Inde et la région administrée de Jammu-et-Cachemire représentent plus de 72 % de toutes les coupures en Asie. Ces interruptions ont été massivement liées à des événements politiques : 226 en lien avec des manifestations, 34 avec des élections, et 377 avec des troubles politiques plus larges. Par ailleurs, 66 % des pays asiatiques ont connu au moins une coupure depuis 2015.
L’Afrique est la deuxième région la plus touchée, avec 134 coupures au cours de la même période. Ces événements ont affecté 83,6 % de la population du continent—soit plus de 1,2 milliard de personnes. La majorité de ces interruptions était également liée à des manifestations, à des élections ou à une instabilité politique. L’Éthiopie et le Soudan restent parmi les pires contrevenants.
Les coupures d’Internet sapent la confiance dans les institutions, paralysent l’activité économique et entravent le développement d’une culture démocratique.
Si l’Europe a connu relativement peu de coupures (seulement 17 cas), la Russie et la Biélorussie en représentent à elles seules près de 90 %. En revanche, l’Amérique du Nord a recensé 11 cas—dont neuf à Cuba, ce qui correspond à 73 % des interruptions de la région. L’Amérique du Sud, bien que souvent absente des discussions sur la répression numérique, a enregistré 45 cas depuis 2015, avec 60 % de la population du continent touchée. L’Océanie reste la seule région sans coupure recensée.
Cette répartition géographique confirme une tendance plus large : les coupures d’Internet sont rarement des mesures isolées—ce sont des actes délibérés et ciblés de répression politique. Malgré leur fréquence croissante, ces coupures attirent peu l’attention des médias. Trop souvent, elles sont perçues comme des problèmes techniques ou des mesures de sécurité temporaires, alors qu’elles relèvent en réalité d’une stratégie de gouvernance autoritaire à l’ère numérique.
Coupures d’Internet : Une méthode de contrôle, pas une réponse au chaos
Les coupures d’Internet sont généralement présentées par les gouvernements comme des mesures temporaires destinées à garantir la « sécurité publique », à empêcher la diffusion de fausses informations ou à « endiguer la violence ». En pratique, elles servent pourtant d’outils de censure et de contrôle social. En bloquant l’accès aux réseaux sociaux, aux plateformes de messagerie ou même à l’ensemble des réseaux mobiles, les autorités empêchent les citoyen·nes d’organiser des manifestations, de documenter des abus ou de communiquer avec le reste du monde.

Cette stratégie est particulièrement efficace en période de troubles politiques. Les coupures d’Internet ne sont pas seulement perturbatrices : ce sont des outils stratégiques qui permettent aux régimes d’interrompre la coordination, de briser la solidarité et de contrôler les récits. En coupant la communication numérique, les régimes isolent les dissidents, fragmentent l’action collective et réduisent la visibilité internationale des violences étatiques. Dans ce sens, la coupure n’est pas une réponse au désordre—c’est une manœuvre calculée pour échapper à la reddition de comptes.
De Téhéran à Cuba : études de cas sur la répression numérique
Les exemples les plus marquants de ces dernières années illustrent l’ampleur et la diversité croissantes de ces tactiques.
- Iran : Lors des manifestations de 2022–2023 après la mort de Mahsa Amini en garde à vue, le gouvernement iranien a imposé de vastes coupures d’Internet et de réseaux mobiles. Ces mesures ne se sont pas limitées aux périodes de plus forte agitation, mais se sont poursuivies par intermittence pendant plusieurs mois. Les coupures ont coïncidé avec des répressions violentes contre les manifestants, restreignant l’accès à des plateformes comme WhatsApp et Instagram, et rendant presque impossible le partage de vidéos des manifestations ou des violences policières.
- Myanmar : Après le coup d’État militaire de février 2021, la junte a imposé des coupures d’Internet à l’échelle nationale dans le cadre de sa campagne visant à faire taire l’opposition. Au départ, les réseaux mobiles étaient coupés pendant plusieurs heures ; peu après, des régions entières ont été déconnectées pour une durée indéterminée. Ces coupures ont coïncidé avec des arrestations massives, des assassinats de manifestants et des efforts systématiques pour effacer les preuves numériques de la répression.
- Inde : Le gouvernement indien a fréquemment eu recours à des coupures d’Internet localisées, en particulier au Jammu-et-Cachemire, qui a connu près de 400 coupures entre 2012 et 2022. En 2019, après la révocation du statut spécial de la région, celle-ci a subi une coupure totale des communications qui a duré 213 jours—la plus longue jamais enregistrée dans une démocratie. Ces mesures ont bloqué non seulement la dissidence, mais aussi les communications quotidiennes, l’éducation et les services de santé.
- Cuba : En juillet 2021, alors que des manifestations spontanées contre le gouvernement éclataient dans tout le pays, les autorités ont réagi en coupant l’accès à Internet mobile. Des plateformes de messagerie comme WhatsApp, Telegram et Signal sont devenues inaccessibles, et l’opérateur public ETECSA a bloqué les services de données pendant des heures. Le gouvernement cherchait aussi à empêcher la diffusion d’images et de vidéos de sa répression brutale. Alors que des journalistes indépendants et des citoyens tentaient de documenter les manifestations, la coupure a fait en sorte que peu de témoignages et d’images atteignent le public international en temps réel.
Au-delà de la coupure : impacts à long terme sur la société civile
Les conséquences des coupures d’Internet dépassent largement la perturbation immédiate. Elles sapent la confiance dans les institutions, paralysent l’activité économique et freinent le développement d’une culture démocratique. Dans les régions où ces coupures sont fréquentes, les militants doivent constamment s’adapter à des canaux de communication instables, tandis que les journalistes rencontrent de plus en plus de difficultés à vérifier et relater les événements.
De plus, ces coupures affectent de manière disproportionnée les populations marginalisées. Ceux qui n’ont pas accès aux VPN, aux outils satellites ou au soutien des médias étrangers sont réduits au silence. L’éducation, les petites entreprises et les services d’urgence subissent également des dommages collatéraux. Une coupure n’est jamais « chirurgicale »—ses effets sont structurels.
Une zone grise juridique qui favorise les abus
L’un des aspects les plus inquiétants des coupures d’Internet est leur ambiguïté juridique. De nombreux gouvernements invoquent des lois vagues sur la sécurité nationale ou des règlements hérités de l’époque coloniale pour justifier les coupures. Le contrôle judiciaire est rare, et les mécanismes internationaux de reddition de comptes restent limités. Même lorsque les coupures sont contestées en justice—comme dans l’arrêt de 2020 de la Cour suprême indienne déclarant inconstitutionnelles les coupures illimitées—les États trouvent souvent des moyens de contourner ou d’ignorer ces décisions en pratique.
Ce vide juridique encourage les gouvernements autoritaires et renforce l’audace des démocraties semi-autoritaires à adopter des tactiques similaires. Sans pression internationale forte ni sanctions coordonnées, le coût de la répression numérique reste faible.
Le rôle des entreprises technologiques et des acteurs internationaux
Les grandes entreprises technologiques exploitent souvent des infrastructures dans des pays à haut risque de coupures d’Internet. Pourtant, leurs réactions sont inégales. Dans certains cas, les fournisseurs se conforment discrètement aux ordres de coupure ; dans d’autres, ils résistent ou en retardent l’application.
En savoir plus
Les organisations de la société civile réclament une plus grande transparence de la part des opérateurs télécoms et des plateformes, en exigeant la publication de toutes les demandes gouvernementales ainsi que des explications sur le moment et les raisons des interruptions de service.
Les organisations internationales, quant à elles, disposent de peu d’outils pour contrer cette tendance. Malgré les condamnations répétées, y compris celles des Nations Unies, les mécanismes d’application concrets demeurent faibles. Les coupures d’Internet continuent de se multiplier, en partie parce que leur coût politique reste très faible.
Coupures d’Internet et avenir des droits numériques
Les coupures d’Internet ne sont plus l’exception—elles sont devenues une caractéristique centrale de l’autoritarisme contemporain. L’expansion rapide de ces coupures reflète une convergence croissante entre le contrôle technologique et la répression politique. À mesure que l’infrastructure numérique devient essentielle à la participation civique et à la circulation de l’information, les régimes disposent de nouveaux moyens pour surveiller, isoler et faire taire la dissidence.
La vulnérabilité de la société civile augmente à mesure que les réseaux numériques occupent une place centrale dans la vie publique. Il est essentiel de reconnaître ces coupures comme des actes délibérés de répression—et non comme de simples « mesures de sécurité » neutres.
Le temps de l’indignation isolée est révolu. Ce qu’il faut, c’est un effort coordonné pour documenter, dénoncer et sanctionner ces coupures, afin que la connectivité soit considérée non comme un luxe, mais comme un droit.