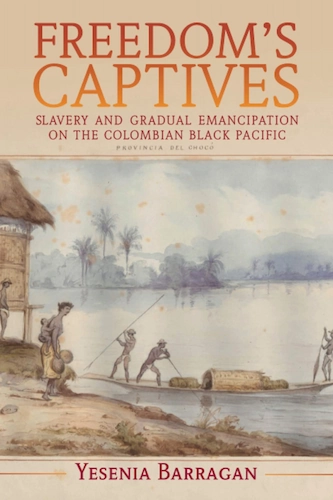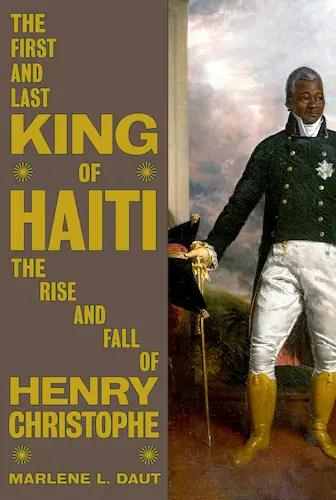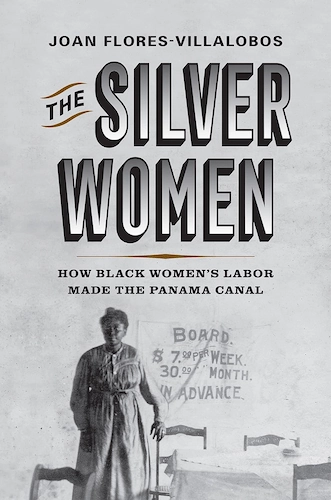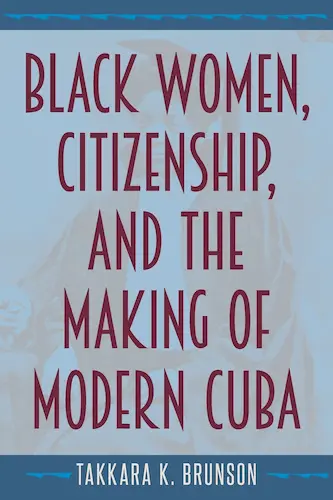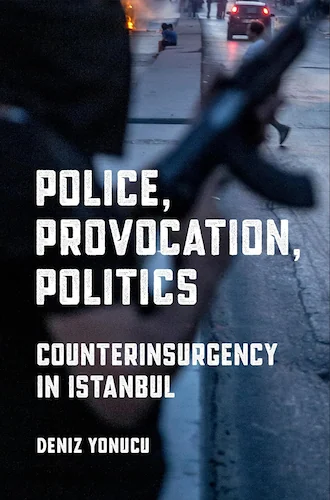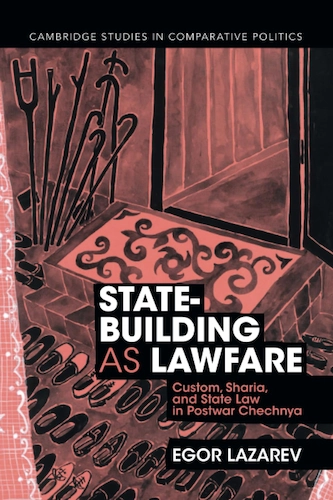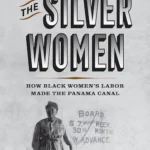L’ouvrage de Yesenia Barragan, Freedom’s Captives: Slavery and Gradual Emancipation on the Colombian Black Pacific (Cambridge University Press, 2021), lauréat du Prix Wesley-Logan 2022 en histoire de la diaspora africaine, constitue une contribution essentielle à l’historiographie de l’abolition en Amérique latine. Barragan examine avec précision la loi colombienne sur les ventres libres de 1821, en l’inscrivant dans le contexte plus large du mouvement abolitionniste atlantique. Son étude met en lumière comment cette loi, censée éliminer progressivement l’esclavage, a paradoxalement consolidé de nouvelles formes de gouvernance raciale, perpétuant une servitude de facto sous couvert de liberté légale.
Barragan affirme que le modèle d’émancipation graduelle constituait un mécanisme moderne de contrôle racial, dans lequel les enfants « libres » nés de mères réduites en esclavage restaient attachés aux maîtres de leur mère jusqu’à l’âge adulte. Ce cadre juridique a favorisé ce qu’elle appelle la « gouvernance raciale », enracinant des inégalités systémiques qui ont perduré bien après l’abolition formelle en 1852. Grâce à une recherche archivistique minutieuse, elle met en évidence les contradictions de la liberté libérale : comment elle promettait l’émancipation tout en institutionnalisant la captivité.
Le livre est structuré en trois parties interconnectées. La première section explore le tissu socio-économique du Pacifique noir colombien, en se concentrant sur des régions comme le Chocó, où les communautés noires, esclavisées et libres, cherchaient à naviguer vers une autonomie au sein de structures oppressives. À travers une approche ethnographique, Barragan met en évidence comment la géographie et les économies locales ont façonné les stratégies de résistance et de survie. La deuxième partie examine les cadres juridiques et politiques qui ont conduit à l’adoption de la loi sur les ventres libres, en soulignant l’influence du discours révolutionnaire antiesclavagiste face aux intérêts profondément enracinés des propriétaires d’esclaves. La dernière section analyse les conséquences de l’abolition, en détaillant comment les anciens esclaves ont dû faire face à des barrières systémiques limitant leur autonomie réelle.
L’une des grandes forces du livre réside dans son approche interdisciplinaire, qui mêle histoire du droit, théorie politique et études culturelles. L’engagement de Barragan avec les concepts de chercheuses comme Saidiya Hartman enrichit son analyse des silences archivistiques entourant les expériences vécues des personnes réduites en esclavage. Son récit reconstitue ces vies, offrant une critique approfondie des promesses libérales de liberté qui, bien souvent, dissimulaient une exploitation persistante.
Freedom’s Captives remet en question les récits conventionnels sur l’abolition en révélant les complexités et contradictions des politiques d’émancipation graduelle. Il s’agit d’une lecture incontournable pour les chercheurs en histoire latino-américaine, en études sur la diaspora africaine et en droits humains, car il offre une analyse critique des héritages persistants de l’esclavage dans la structuration des hiérarchies raciales et sociales contemporaines.
For those interested in understanding the nuanced history of abolition and its afterlives, Barragan’s work is not just an academic milestone but a compelling call to reassess how we define and recognize freedom. The book is available here.