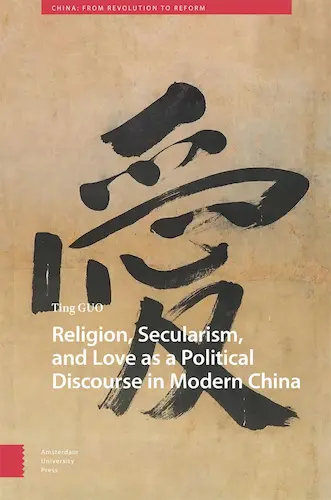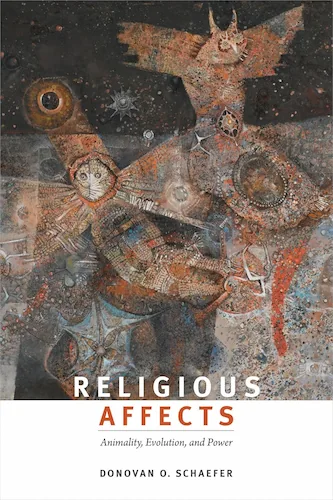L’amour comme discours politique
Quel est le sens de l’amour dans la politique chinoise contemporaine ? Ce livre soutient que le discours de l’amour (ai 愛) marque la modernité politique de la Chine, car il est introduit, adapté et façonné comme un élément central dans la construction et la reconstruction d’une nation moderne.
- L’amour comme discours politique
- Racines religieuses du nationalisme séculier sous des régimes athées
- Du christianisme au socialisme
- L’amour comme salut spirituel
- Traditionalisme autoritaire
- Gouvernance parentale et Hong Kong comme enfant filial
- Transformer le discours politique de l’amour dans l’activisme transnational
- Approches critiques et décoloniales de la religion
- Religion politique
- Langage des affects religieux et nationalisme
Le sens moderne de ai comme expression de l’affection interpersonnelle et des sentiments — plutôt qu’un indicateur du caractère moral dans les classiques confucéens — a été introduit au XIXe siècle par des missionnaires qui ont utilisé le caractère ai pour traduire le concept d’amour dans des versets bibliques tels que « car Dieu a tant aimé le monde ».
Cette nouvelle conception de l’amour a gagné en importance durant les mouvements du 4 mai et de la Nouvelle Culture, devenant un symbole central de la subjectivité moderne et de la liberté individuelle, adoptées par les réformateurs et les intellectuels.
Racines religieuses du nationalisme séculier sous des régimes athées
Quelles sont les influences religieuses qui sous-tendent le discours de l’amour comme moyen central d’action politique dans un État athée ? Et quelles sont les stratégies spécifiques de son déploiement sous différents dirigeants politiques, notamment des femmes dont les idées ont été jusqu’ici négligées ?
La Chine contemporaine a vu réapparaître l’autorité charismatique à l’ère de la culture numérique.
Connu pour avoir défendu l’idée de bo’ai 博愛 (amour universel) dans sa pensée, Sun Yat-sen 孫中山 (1866–1925), le « père de la Chine moderne », a laissé de nombreux exemples de cette expression en calligraphie.
Nombreux sont ceux qui affirment que bo’ai témoigne d’une influence marquée du mohisme et du christianisme, et que Sun était largement reconnu comme un réformateur chrétien.
Cependant, comme ce projet le démontrera, la pensée intellectuelle de Sun était plutôt éclectique : elle évolua de la fraternité jurée des sociétés secrètes à l’entraide de Kropotkine, en passant par l’évangile social de Henry George, pour finalement s’orienter vers le socialisme international ; il en fut de même pour son épouse Soong Ching-ling 宋慶齡 (1893–1981), connue pour être une chrétienne bourgeoise représentant les élites républicaines.
Du christianisme au socialisme
Bien qu’elle soit surtout connue comme l’épouse de Sun Yat-sen et la Mère de la Chine moderne, ainsi que comme la fille d’un missionnaire chinois formé aux États-Unis (Charlie Soong 宋耀如, 1864–1918), issu de milieux modestes et dont les rêves de carrière médicale furent brisés par ses supérieurs blancs américains, Soong possédait néanmoins une sensibilité cosmopolite, façonnée par son expérience transnationale variée et sa conscience des questions raciales et des luttes populaires.
Des preuves de plus en plus nombreuses montrent également les liens de Soong avec la Troisième Internationale, et ce livre démontre qu’elle adhérait émotionnellement aux idéaux socialistes, bien qu’elle soit généralement perçue comme une chrétienne bourgeoise issue du camp opposé au Parti communiste.
L’amour comme salut spirituel
Tout comme le gouvernement nationaliste républicain, le gouvernement communiste a lui aussi adopté le nationalisme séculier. Mais contrairement aux nationalistes, le Parti communiste chinois visait au-delà de la religion, cherchant à transformer totalement l’ancienne société en s’imposant comme une nouvelle religion politique et une souveraineté spirituelle, notamment sous Mao, et résumée dans ce projet comme la religion politique du re’ai 熱愛 (amour ardent).
Cette transformation visait à intégrer la religion populaire traditionnelle dans son propre système de croyances et de mythes, utilisant le langage de l’amour pour réinterpréter le socialisme, qui s’était subtilement approprié la morale et les symboles religieux traditionnels. Cet affect politique s’est manifesté à travers le discours maoïste de l’amour, qui est passé d’un discours de classe à une forme de salut spirituel.
Ce livre s’appuie sur une théorie de pointe en sciences des religions, à savoir celle des affects religieux, et la pousse plus loin.
Comme Mao l’a déclaré célèbrement lors du Forum de Yan’an sur la littérature et l’art en 1942 : « Il n’existe nulle part au monde d’amour ou de haine sans cause ni raison. Quant à ce qu’on appelle ‘l’amour de l’humanité’, un tel amour unificateur n’a jamais existé depuis que l’humanité s’est divisée en classes. »
Le Forum de Yan’an a conduit à la création des opéras révolutionnaires maoïstes, dont la célèbre La jeune fille aux cheveux blancs, adaptée d’un conte folklorique populaire, avec une phrase marquante : « La vieille société forçait les gens à devenir des fantômes, mais la nouvelle société transforme les fantômes en êtres humains. »
Cet opéra révolutionnaire a gagné en importance pendant la Révolution culturelle, lorsque le discours de l’amour devint non seulement un slogan, mais aussi une forme de salut spirituel dans laquelle le peuple s’impliquait activement. Cette dimension interactive et participative du culte de Mao, au-delà d’un exercice de pouvoir descendant, a permis son développement contemporain en expressions spontanées d’amour pour Mao et la Chine maoïste.
Traditionalisme autoritaire
La Chine contemporaine a vu réapparaître l’autorité charismatique à l’ère de la culture numérique. Mais contrairement aux idées reçues, tant dans les milieux savants que populaires, Xi se distingue de Mao en étant le premier dirigeant de la Chine socialiste à mobiliser explicitement les « cultures et religions traditionnelles », notamment la piété filiale, pour établir un parallèle avec la loyauté du peuple envers l’État.
Cela marque une rupture avec la rhétorique maoïste, où les éléments moraux et familiaux traditionnels étaient davantage implicites qu’explicites. La présentation de Xi comme un homme de famille attentionné, un mari dévoué et un dirigeant puissant ajoute également une dimension personnelle à sa figure politique, le distinguant du style de leadership divinisé et du zèle quasi religieux sous Mao. Par exemple, la narration autour de Xi met aussi en valeur sa relation avec Peng Liyuan, les présentant comme le couple modèle à la tête du pays, et la nation chinoise comme une famille unie et épanouie.
Bien que le culte personnel autour de Xi se soit apparemment atténué depuis 2018, la place centrale accordée au discours politique autour des cultures et religions « traditionnelles » qui sous-tend le discours de l’amour continue de légitimer la diplomatie des loups guerriers et d’alimenter un nationalisme populiste.
Gouvernance parentale et Hong Kong comme enfant filial
Longtemps marginalisé dans les études académiques, Hong Kong est récemment devenu un champ de recherche prometteur à part entière à la suite des affrontements politiques entre Hong Kong et le gouvernement central.

Cependant, le rôle de la religion dans l’évolution de la dynamique politique a été remarquablement sous-représenté, voire absent, dans l’analyse de la politique récente.
Lorsque la religion est abordée, l’attention se porte souvent sur le christianisme, en négligeant la diversité religieuse et culturelle diffuse à Hong Kong. En réponse au mouvement de 2019, par exemple, la cheffe de l’exécutif de l’époque, Carrie Lam, a mobilisé le discours de l’amour maternel pour justifier sa position politique, inscrivant les relations politiques dans un cadre familial confucéen et représentant les acteurs politiques comme des enfants filiaux ou des figures parentales bienveillantes mais fermes.
Ce livre montre comment le discours de l’amour maternel de Lam incarnait à la fois le nationalisme familial dans la Chine contemporaine et le « traditionalisme colonial » de Hong Kong, en tant que stratégie du pouvoir pour justifier une politique autoritaire, encadrant les relations politiques comme des relations familiales confucéennes et dissimulant la violence politique sous les traits d’un devoir familial.
Transformer le discours politique de l’amour dans l’activisme transnational
L’amour n’est évidemment pas qu’un outil de propagande descendante. La conclusion, intitulée « Transformer le discours politique de l’amour », examine comment les gens ordinaires réagissent aux discours officiels et les transforment, notamment lorsque des manifestants ont réapproprié l’amour pour Hong Kong dans leur propre langage avec des slogans comme “We fucking love Hong Kong” (ngo die zan hai hou len zung ji heung gong 我哋真係好撚鍾意香港), remettant en question le discours politique officiel de l’amour.
Des activistes ont également utilisé le langage de l’amour pour exprimer une solidarité politique et des liens affectifs allant au-delà des liens du sang et de la version étatique de l’unité comme aiguo 愛國 (patriotisme). Lors du mouvement du Papier blanc en 2023, l’un des slogans les plus diffusés déclarait : « N’aimons pas la nation, mais nous-mêmes, nos ami·e·s, notre famille choisie, la Grande Terre et la liberté ; Je ne suis pas ton patriote ; Je soutiens les musulmans ouïghours, les Tibétains, les Hongkongais, les Taïwanais, les Iraniens, les Ukrainiens. Je me tiens aux côtés des peuples du monde entier contre l’autocratie, l’oppression et la violence. »
Il s’agit d’un témoignage émouvant montrant que l’amour reste un discours politique puissant pour redéfinir et réenchanter la politique affective dans l’activisme transnational. Ainsi, ce livre prend également une portée comparative plus large dans une époque marquée par des nationalismes religieux explicites ou des affects politiques implicitement enchantés à travers le monde.
Approches critiques et décoloniales de la religion
Ce livre adopte une approche critique et décoloniale de la religion, en intégrant le confucianisme, la religion populaire, les récits de fantômes et les traditions orales dans leurs formes diffuses, implicites et dissimulées, à l’encontre de la définition occidentale et protestante de la religion, de la modernité et de la laïcité.
Découvrez les livres écrits par nos collaborateurs
Un nombre croissant de travaux en études chinoises soulignent le caractère enchanté des révolutions communistes, fournissant aux sciences des religions une référence intellectuelle précieuse pour repenser la distinction entre religion et politique séculière.
Cette méthode revêt une portée importante pour décoloniser les études religieuses. Les religions d’Asie de l’Est sont souvent perçues comme marginales dans les récits de la modernité, mais le cadre de la religion diffuse montre que « religion » et politique ont toujours été indissociables dans les processus de modernisation, voire de démocratisation, de nombreux pays — non pas par une implication institutionnelle, mais par l’imprégnation ou l’allusion religieuse dans les discours politiques et la gouvernance.
Religion politique
Le concept de religion politique dans cet ouvrage s’appuie sur les travaux de l’historien italien Emilio Gentile.
Ce livre montre que les affects religieux ne peuvent être dissociés du langage.
La religion politique met l’accent sur la sacralisation de la politique avec un caractère exclusif et intégraliste, qui rejette toute coexistence avec d’autres idéologies ou mouvements politiques, nie l’autonomie de l’individu face au collectif, prescrit l’observance obligatoire de ses commandements et la participation à son culte politique, et sanctifie la violence comme moyen légitime de lutte contre les ennemis et comme instrument de régénération.
Dans mon projet, la religion politique s’appuie sur le pouvoir — et le langage — de l’amour pour faire avancer son programme.
Langage des affects religieux et nationalisme
Comment ce livre nous aide-t-il à comprendre les émotions, la religion, le langage et le nationalisme dans le monde qui nous entoure ? Cet ouvrage s’appuie sur une théorie de pointe en sciences des religions : les affects religieux, qu’il développe davantage.
Donovan Schaefer a proposé de façon marquante dans Religious Affects (2015) que la religion n’est pas nécessairement liée au langage ni à la croyance, mais qu’elle est avant tout motivée par les affects.
Contrairement à des penseurs antérieurs comme William James (1902), qui mettait l’accent sur les sentiments personnels, ou Rudolf Otto (1923), qui les reliait à une existence supérieure, Schaefer souligne la manière dont les affects religieux croisent divers champs de pouvoir, rendant le personnel intrinsèquement politique.
Ce livre montre que les affects religieux ne peuvent être dissociés du langage. Aux États-Unis également, nombreux sont ceux qui soutiennent que l’expression “Make America Great Again” évoque les sentiments du Grand Réveil et hérite de la rhétorique de la religion civile américaine, en contextualisant diverses sources de ressentiment social comme faisant partie d’un récit plus large du déclin national, et en légitimant la défense des privilèges des hommes blancs comme élément central des efforts de restauration de la grandeur nationale.
Autrement dit, les affects religieux se déploient à travers certaines rhétoriques et discours. En s’appuyant sur le cas de la Chine moderne, ce livre montre comment les affects religieux sont générés, validés et animés par le langage, ainsi que par le pouvoir même de ces affects. Ce livre revêt donc une portée plus large pour comprendre les nationalismes religieux mondiaux contemporains, notamment dans des contextes que l’on suppose généralement séculiers.
En remettant en question les récits séculiers de la modernité (socialiste), en proposant une nouvelle perspective sur le rôle de la religion et des affects religieux dans la politique contemporaine, et en faisant progresser l’étude des affects religieux en montrant que l’efficacité politique circule non seulement à travers les corps et les émotions, mais aussi via des langages spécifiques des affects, ce livre s’avère pertinent pour l’étude de la gouvernance affective et des nationalismes religieux dans le monde d’aujourd’hui.