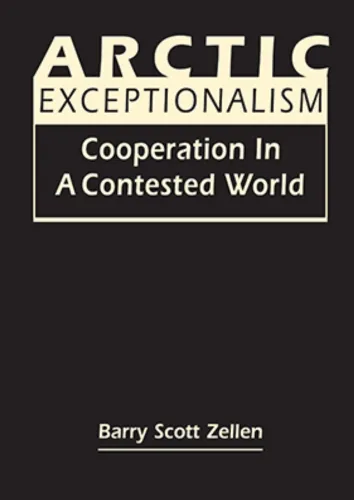Réveil géopolitique en Arctique
Le plan de Trump visant à étendre la souveraineté américaine au Groenland est présenté dans des termes géopolitiques classiques, encadrés par une lecture mackindérienne qui perçoit le Groenland comme un Rimland disputé, dont la possession et/ou le contrôle est essentiel à la sécurité du Heartland de l’Amérique du Nord continentale.
- Réveil géopolitique en Arctique
- Pouvoir autochtone en pratique : de l’Alaska au Groenland
- Souveraineté westphalienne vs. souveraineté autochtone : vers une convergence ?
- Indépendance comme identité : le projet de souveraineté groenlandaise
- Entre empires : la quête d’équilibre du Groenland
- Décolonisation par dessein : l’éveil diplomatique du Groenland
- Revendiquer la scène mondiale : Nuuk s’avance
- Libération ou absorption ? La deuxième approche de Trump envers le Groenland
- Trump libérera-t-il ou anéantira-t-il un Groenland indépendant ?
- Avenirs négociés : de la résistance au réajustement
Il est donc décrit comme une double frontière économique et militaire où l’expansion stratégique peut offrir à la fois des opportunités économiques et des avantages en matière de sécurité. Les États-Unis en ont une expérience considérable, avec une longue histoire d’expansion, dont l’achat négocié de l’Alaska à la Russie en 1867, présenté à la fois sous l’angle militaire stratégique et économique.
L’expérience d’un siècle et demi des États-Unis en tant que souverain de l’Alaska leur a permis d’acquérir un savoir considérable en matière de développement des frontières et de gestion collaborative des ressources avec les communautés locales et autochtones, favorisant l’émergence de systèmes de gouvernance multiniveaux innovants et de plus en plus coopératifs pour les peuples autochtones d’Alaska, dont la population totale dépasse 125 000 person
Pouvoir autochtone en pratique : de l’Alaska au Groenland
L’une des innovations centrales (et ce qui, après des révisions et amendements législatifs ultérieurs, est devenu une force durable malgré des débuts difficiles) de la loi pionnière de 1971 sur le règlement des revendications des Autochtones de l’Alaska (ANCSA) – et qui est ensuite devenue essentielle dans tous les traités arctiques de revendications territoriales au Canada – a été la création de sociétés appartenant aux Autochtones, tant au niveau communautaire que régional, afin de clari
L’exclusion de protections solides pour la subsistance par l’ANCSA a conduit en Alaska à un mouvement de retribalisation des terres (comme l’avait recommandé la Commission de révision des Autochtones de l’Alaska de Thomas Berger), ainsi qu’à une intervention fédérale visant à protéger les droits de chasse, de piégeage et de pêche de subsistance par le biais de l’Alaska National Interest Lands Conservation Act (ANILCA) de 1980.
Mais au Canada, cela a conduit à l’adoption d’un modèle de développement durable intégré dans la structure même des traités de revendications territoriales, qui a permis à la dialectique entre les factions pro-subsistance et pro-développement au sein de la communauté autochtone de s’exprimer démocratiquement, la subsistance étant protégée constitutionnellement en tant que droit autochtone et défendue par de nouveaux conseils de cogestion représentant les intérêts des associations de chasseurs et de trappeurs, tandis que le développement économique était encouragé et géré par les nouvelles sociétés autochtones créées.
Les résultats, bien que mitigés, ont été globalement positifs, même si le rythme du développement est resté lent et inégal (ce qui constitue un désavantage pour la communauté pro-développement, mais est célébré comme une victoire par la communauté pro-durabilité), avec des projets tels que l’oléoduc de la vallée du Mackenzie qui n’ont jamais vraiment décollé. La force et l’élan intergénérationnel de l’opposition populaire historique aux mégaprojets, comme on le constate également à Kvanefjeld au Groenland, peuvent s’avérer difficiles à inverser.
Souveraineté westphalienne vs. souveraineté autochtone : vers une convergence ?
Les progrès remarquables et les innovations en matière de gouvernance en Alaska et au Canada s’étendent au Groenland, où le transfert réussi de pouvoir de Copenhague à Nuuk a franchi des étapes importantes avec la gouvernance par le Home Rule en 1979, puis une gouvernance plus robuste par le Self-Rule en 2009. Mais l’objectif final a été plus ambitieux que la simple création d’un espace autonome pour renforcer l’autogouvernance autochtone au niveau infranational, en visant plutôt à obtenir l’indépendance du Danemark par une restauration de la souveraineté, le seul mouvement actif en faveur de l’indépendance dans l’Arctique nord-américain.
Le débat sur l’avenir constitutionnel du Groenland reste en cours, complexe et nuancé, avec une grande diversité de points de vue et de perspectives.
Il existe une convergence entre les mouvements transnationaux — tels que le Conseil circumpolaire inuit — et le mouvement national pour la restauration de la souveraineté. La plupart des partis politiques s’accordent sur l’objectif de l’indépendance, mais divergent fortement quant à son rythme et à son orientation.
Indépendance comme identité : le projet de souveraineté groenlandaise
Cette convergence ouvre deux voies distinctes — et pour certains, interconnectées — vers l’affirmation d’une identité souveraine autochtone : un modèle transnational et un modèle westphalien. Ces modèles ont été décrits et éclairés théoriquement par plusieurs spécialistes des relations internationales de l’Arctique, dont Hannes Gerhardt, Jessica Shadian, Rauna Kuokkanen et Ulrik Gad, en plus de mes propres modestes contributions.

Sa quête d’indépendance a depuis longtemps soutenu la politique intérieure au Groenland ; comme l’explique Gad : « Le Groenland se voit en transition de la soumission impériale vers une future indépendance. En ce sens, devenir indépendant fait partie de l’identité groenlandaise et, dans ce même sens, la plupart des politiques intérieures groenlandaises sont, presque par définition, des jeux de souveraineté post-impériaux : des jeux linguistiques permis par le concept de souveraineté, joués tout en laissant l’empire derrière. »
En effet, la majorité des Groenlandais souhaite l’indépendance, comme en témoigne le résultat décisif du référendum de 2008 sur l’autonomie du Groenland, avec 75,54 % de votes favorables, et comme cela a été réaffirmé par des sondages plus récents au cours des années suivantes.
Avec l’indépendance inscrite à l’agenda politique du Groenland, toutefois, à la différence d’autres régions de l’Arctique où l’autonomie a été recherchée principalement à travers des structures de gouvernance infranationales portées par des organisations autochtones transnationales comme l’ICC, elle s’est manifestée sous une forme souveraine plus westphalienne, centrée sur les réalités pratiques et économiques. Comme le décrit Kuokkanen : « Les défis pratiques… sont mis en avant par rapport aux questions plus abstraites des droits des peuples autochtones, qui revêtent moins d’importance dans un contexte où près de quatre-vingt-dix pour cent de la population est composée d’Inuits autochtones. »
Alors que certains chercheurs, dont Hannes Gerhardt (« westphalien » vs. « transnational ») et Jessica Shadian (« westphalien » vs. « post-westphalien »), opposent comme divergentes ces approches concurrentes de l’atteinte de la souveraineté autochtone, Kuokkanen voit au Groenland la possibilité d’une synthèse des deux (« souveraineté westphalienne autochtone »). Comme l’écrit Kuokkanen : « Je propose que les Inuits du Groenland développent ce que j’appelle la ‘souveraineté westphalienne autochtone’, une approche unique de l’autodétermination dans le monde autochtone. »
Entre empires : la quête d’équilibre du Groenland
Le Groenland se situe donc à la croisée de cette dialectique sur la souveraineté autochtone, et pourrait ainsi devenir un pont vers sa synthèse. Comme l’écrit Kuokkanen : « Dans le monde interconnecté d’aujourd’hui, la vision westphalienne d’un monde divisé en territoires mutuellement exclusifs apparaît déficiente. »
Elle méconnaît la réalité des autorités et des communautés multiples et qui se chevauchent, ainsi que l’interdépendance qui caractérise l’expérience humaine. Elle ignore également les conceptions autochtones de l’autodétermination et de la souveraineté, où la notion de territoires et de juridictions partagés et de souverainetés coexistantes est courante. »
Comme toute synthèse de thèses et d’antithèses opposées, la trajectoire du Groenland a été jalonnée de contradictions et de paradoxes, une situation encore aggravée par l’initiative de plus en plus affirmée du président Trump visant à assumer la souveraineté sur l’île.
En effet, tandis que de nombreux Groenlandais préfèrent préserver l’usage traditionnel de subsistance des terres et des eaux vierges du Groenland, d’autres souhaitent mettre en marché leurs abondantes ressources naturelles, donnant lieu à une dialectique politique saine qui s’exprime démocratiquement à travers des résultats électoraux changeants, comme l’illustrent les issues divergentes des élections nationales de 2021 et de 2025.
Avec l’intérêt actuel des États-Unis pour le Groenland, motivé en partie par leur quête de minéraux stratégiques — sous Trump 2.0, la politique étrangère et la sécurité nationale américaines sont de plus en plus envisagées à travers un prisme défini par les minéraux stratégiques et le développement économique —, il est encore trop tôt pour savoir si les positions pro-développement progresseront de concert avec l’intérêt américain.
Comme le formule Kuokkanen : « Le grand dilemme pour le Groenland, sur lequel la quasi-totalité des Groenlandais s’accorde, consiste à trouver l’équilibre entre le besoin pressant de nouvelles sources de revenus, la diversification de l’économie fragile du pays et l’exploitation des ressources, tout en respectant des normes environnementales et sociales élevées afin que la culture inuite de chasse et de pêche (dépendante de ressources naturelles saines) ne soit pas compromise. »
Décolonisation par dessein : l’éveil diplomatique du Groenland
La discussion entre le Groenland et le Danemark concernant son éventuelle indépendance s’est déroulée dans le cadre d’un modèle bilatéral de décolonisation, à dominante westphalienne, qui se distingue des approches sub- et transnationales ayant prévalu en Alaska et au Canada, où l’identité autochtone a été protégée grâce à la collaboration avec l’État, mais où, avec le temps, un équilibre accru entre les intérêts tribaux et nationaux a émergé, accompagné d’une plus grande représentation des voix autochtones aux plus hauts niveaux de la gouvernance intérieure.
Cette représentation et cet empowerment accrus des voix et des valeurs autochtones ont conduit à l’émergence de ce que Jessica Shadian décrit comme une « souveraineté post-westphalienne », une forme de souveraineté transcendante adoptée par des organisations autochtones transnationales telles que le Conseil circumpolaire inuit, ainsi que par d’autres organisations autochtones disposant du statut de Participant permanent au sein du Conseil de l’Arctique.
Au Canada, la création du Territoire du Nunavut en 1999 pour administrer la zone de revendication territoriale du Nunavut établie en 1993 a instauré une structure territoriale inédite, bien que subnationale, dans le pays (issue de la division des anciens Territoires du Nord-Ouest en un nouveau Territoire du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest réduits, après des plébiscites et référendums sur la sécession du Nunavut des TNO). En Alaska, les Inupiat du North Slope ont créé en 1972 leur propre gouvernement de borough, comme le permettait la constitution de l’État d’Alaska.
Ces structures sont régionales, mais leur taille varie d’un borough municipal à un vaste territoire. Elles reflètent une volonté d’articuler la souveraineté autochtone aussi bien par le biais d’organisations transnationales que par des structures locales, régionales et territoriales.
Revendiquer la scène mondiale : Nuuk s’avance
Cela contraste nettement avec le Groenland, où le débat reste axé sur la restauration d’une nation inuite pleinement autonome. Décrit par Gad comme un « État-nation souverain en devenir », ce projet s’inscrirait dans la fin de la domination coloniale du Danemark, couronnant des négociations menées sur plusieurs décennies.
At the same time, Greenland has been building a diplomatic presence that both parallels and augments Danish diplomacy. This includes the formation of its own representation offices around the world — in Washington, Reykjavik, Beijing, and at NATO headquarters in Brussels.
L’an dernier seulement, le Groenland a publié sa propre stratégie arctique — traditionnellement domaine réservé des États arctiques —, désormais formulée par un État-nation arctique émergent qui affirme de façon éloquente et convaincante tout au long du texte : « rien sur nous sans nous ».
Avec le retour du président Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025, le Groenland dispose désormais d’une seconde occasion de reconsidérer l’offre de 2019 de rejoindre la famille constitutionnelle américaine et, ce faisant, de contribuer à ramener la conversation vers un rôle plus équilibré et inclusif pour le Groenland dans l’avenir de la région, et de l’éloigner des récentes déclarations laissant entendre un recours à la coercition économique et à l’éventuelle utilisation de la force.
Libération ou absorption ? La deuxième approche de Trump envers le Groenland
Cette fois, Nuuk attendra — et à juste titre — une place à la table, comme l’a réclamé dans sa première stratégie arctique, Le Groenland dans le monde – Rien sur nous sans nous. Le président Trump a affirmé ne pas s’y opposer ; comme il l’a déclaré devant une session conjointe du Congrès des États-Unis le 4 mars 2025 :
«Nous soutenons fermement votre droit à déterminer votre propre avenir et, si tel est votre choix, nous vous accueillons aux États-Unis d’Amérique», ce qui «assurera votre sécurité, fera de vous un peuple prospère et, ensemble, nous porterons le Groenland à des sommets que vous n’auriez jamais cru possibles auparavant».
Le vice-président JD Vance, lors d’un déplacement controversé au Groenland quelques semaines plus tard, a réaffirmé ce soutien :
«Nous respectons, comme l’a dit le président dans son discours sur l’État de l’Union, nous respectons l’autodétermination du Groenland» et «nous croyons en l’autodétermination de la population du peuple groenlandais. Et notre argument est très simple. Il ne concerne pas le peuple du Groenland, que je considère comme remarquable et doté d’une opportunité extraordinaire ici. Notre véritable différend est avec la direction du Danemark, qui a sous-investi dans le Groenland et dans l’architecture de sécurité. Cela doit tout simplement changer. C’est la politique des États-Unis que cela changera.»
Comme l’a rapporté le New York Times, « le Premier ministre du Groenland a déclaré que le territoire souhaitait travailler plus étroitement avec les États-Unis sur la défense et les ressources naturelles », citant les propos de l’ancien Premier ministre Múte Egede lors d’une conférence de presse à Nuuk : « La réalité est que nous allons travailler avec les États-Unis – hier, aujourd’hui et demain. Nous devons être très intelligents dans la manière dont nous agissons… Les luttes de pouvoir entre les superpuissances s’intensifient et frappent désormais à notre porte. »
Trump libérera-t-il ou anéantira-t-il un Groenland indépendant ?
Comment une telle conversation entre le Groenland et les États-Unis pourrait-elle se dérouler ? Peut-être que le dialogue avec Trump commencera par sa vision initiale d’acquisition territoriale et évoluera ensuite vers un soutien véritable à l’indépendance du Groenland, à mesure que se renforce la relation renouvelée de l’Amérique avec les Groenlandais, ainsi que son désir d’offrir une protection américaine plus robuste au Groenland dans sa lutte pour la liberté. Cette conversation ne fait que commencer, et nous avons encore au moins trois années pour en observer le déroulement.
Découvrez les livres écrits par nos collaborateurs
Durant cette période, de nombreuses nouvelles opportunités s’offriront aux Groenlandais pour gagner la confiance du président Trump et, par une négociation énergique, le convaincre d’adopter leur vision de restauration de la souveraineté et de diplomatie collaborative avec les États-Unis et leurs autres partenaires de l’OTAN, telle qu’énoncée dans leur stratégie arctique innovante, collaborative et visionnaire de 2024.
De nouveaux et inattendus rapprochements d’intérêts peuvent émerger de discussions entre des parties initialement opposées sur des questions aussi controversées que la souveraineté et l’intérêt national.
Avenirs négociés : de la résistance au réajustement
En effet, nous avons observé un tel phénomène dans les récentes négociations entre l’Ukraine et les États-Unis au sujet des droits miniers. Ces discussions ont débuté comme ce que l’Ukraine considérait être une saisie autoritaire de ressources par une grande puissance.
Cependant, les discussions ont évolué vers un accord de cogestion et d’investissement conjoint plus collaboratif, équilibré et réciproque. Ce modèle rappelle les traités modernes de revendications territoriales qui ont contribué à transformer l’Arctique continental nord-américain en une région où les intérêts tribaux et étatiques ont trouvé un équilibre durable.
Cela pourrait se reproduire. En effet, avec le temps, une fois que cette cour inédite mais à bien des égards non désirée de l’Amérique envers le Groenland aura atteint son inévitable dénouement, nous pourrions assister non pas à l’annexion ouverte et brutale d’une nation insulaire majoritairement autochtone et autogouvernée, comme beaucoup le redoutent, mais plutôt à une restauration de la souveraineté du premier et unique État véritablement autochtone de l’Amérique du Nord arctique, affirmant — plutôt que sapant — l’alignement continu des intérêts autochtones et étatiques au sommet du monde.
Au lieu de la conquête tant redoutée du Groenland, nous pourrions ainsi être témoins de sa libération, un scénario largement inimaginé aujourd’hui.