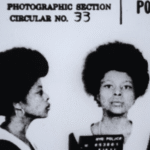La Chine progresse, l’Amérique improvise
Les gros titres se sont affolés et la respiration s’est suspendue à Washington lorsque la Chine a déployé sa flotte (présumée) menaçante de cinq brise-glaces – le Xue Long 2, Tan Suo San Hao, Zhongshandaxue Ji Di, Ji Di et Shen Hai Yi Hao – sur la plateforme continentale élargie (ECS) des États-Unis en août.
- La Chine progresse, l’Amérique improvise
- Les retards s’accumulent alors que les rivaux prennent de l’avance
- Oubliez la course aux brise-glaces — plongez plus profond avec des sous-marins
- Le fossé des brise-glaces est un mirage, pas une menace
- Des sous-marins plutôt que des brise-glaces : plus de présence, moins de coûts
- Le Canada remet en question les brise-glaces : les sous-marins sont plus logiques
- Moins de pompe, plus de puissance : repenser la stratégie arctique
- Il est temps de se libérer du fossé des brise-glaces
- Les États-Unis n’ont pas besoin de plus de brise-glaces. Ils ont besoin de vision
Toujours prêt pour l’action (Semper Paratus, latin pour « toujours prêt », c’est d’ailleurs sa devise), les garde-côtes des États-Unis ont fièrement déployé leur tout nouveau brise-glace – aux côtés de leur brise-glace polaire moyen Healy et d’un patrouilleur – le Storis remis à neuf, dont le nouveau nom vient du vieux norrois et signifie « grande glace », bien que ce dernier ajout à la flotte américaine soit surtout connu pour avoir été submergé lors de son voyage inaugural vers l’Alaska en 2012, alors qu’il s’agissait encore du navire privé Aiviq.
Avec un passé aussi peu glorieux, nos hauts responsables mal avisés du quartier général des garde-côtes américains ont pris une décision discutable. Après avoir investi 2 milliards de dollars dans le programme de brise-glaces de sécurité polaire (PSC) – gravement retardé et largement hors budget – lancé à partir de 2012 avec l’acquisition d’un brise-glace lourd, puis la création en 2016 d’un bureau de programme conjoint avec la Marine, l’objectif était de « reconstruire en mieux » avec une nouvelle flotte de brise-glaces fabriqués aux États-Unis.
Si Washington souhaite affirmer une présence maritime plus mobile et durable au large des côtes de l’Alaska, une flotte de mes sous-marins proposés de classe Hickel pourrait dissuader les Chinois.
Cet effort a fini par coûter plus cher qu’un sous-marin nucléaire de classe Ohio, sans (jusqu’à présent) aucun résultat concret de ce mini projet Manhattan de l’innovation américaine, hormis un océan de chiffres rouges de plus en plus profonds.
En réponse, les garde-côtes ont décidé d’acheter le controversé Aiviq et de le rénover, défauts de conception compris. Cette décision visait à répondre rapidement à un problème d’image croissant : celui d’une « présence arctique » jugée insuffisante pour les États-Unis, pourtant puissance souveraine de l’Alaska depuis près de 160 ans — au point d’accepter, pour redorer leur blason, un brise-glace mal conçu au passé douteux.
Le Aiviq n’est pas un simple brise-glace. C’est peut-être le pire navire pour cette mission. Une enquête de ProPublica révèle que le Aiviq, déjà en difficulté, s’est rendu célèbre pour son « passé chaotique » dès son « voyage inaugural vers l’Alaska », qui « s’est terminé par un sauvetage en mer et une enquête des garde-côtes ».
Le rapport mentionne également un « donateur influent » qui « a versé plus de 7 millions de dollars en contributions politiques depuis 2012 », période durant laquelle il « a tenté de vendre ou de louer le navire », aboutissant à « l’achat du Aiviq par les garde-côtes pour 125 millions de dollars, sous pression du Congrès », après « l’échec du service à faire construire le modèle préféré à un milliard de dollars ». ProPublica se demande : « Comment la Garde côtière américaine utiliserait-elle le Aiviq au-delà du simple affichage de drapeau et d’une présence symbolique dans l’Arctique proche ? » Selon [Lawson W.] Brigham, ancien capitaine de brise-glace et expert en navigation polaire, « Personne que je connaisse, aucune étude que j’aie lue, personne à qui j’ai parlé ne sait vraiment quoi en faire ».
Les retards s’accumulent alors que les rivaux prennent de l’avance
Comme l’a rapporté Malte Humpert l’an dernier dans High North News, « Le programme de brise-glace de sécurité polaire des États-Unis continue de rencontrer des obstacles. Cinq ans après la signature du contrat de construction, le navire n’existe toujours que sur les plans, et sa conception n’est pas encore finalisée. La livraison n’interviendra pas avant 2029. »
Les États-Unis sont le souverain incontesté de l’Alaska et n’ont pas besoin de répondre à la flotte de Pékin par une flotte équivalente.
Avec le déploiement soigneusement orchestré de cinq brise-glaces dans les eaux polaires que les États-Unis revendiquent comme faisant partie de leur ECS, il est à la fois ironique et potentiellement tragique que nos dirigeants aient misé sur le controversé Storis comme plan de salut collectif. Humpert a rapporté plus récemment dans les colonnes de gCaptain, en citant la chercheuse militaire australienne Elizabeth Buchanan, que :
« Les États-Unis peuvent être une nation arctique, mais des décennies de négligence leur reviennent en boomerang — et la prochaine décennie ne sera certainement pas un long fleuve tranquille dans ce domaine maritime disputé. Quel que soit l’engagement politique, Washington ne peut tout simplement pas faire apparaître des capacités du jour au lendemain. »
Plutôt que de jeter deux milliards de dollars dans le programme PSC, ou même 125 millions pour le Storis, il existe d’autres voies vers un Arctique plus sûr et une présence américaine plus robuste, significative et durable dans la région.
Oubliez la course aux brise-glaces — plongez plus profond avec des sous-marins
Depuis le début, j’ai proposé que les États-Unis abandonnent entièrement le gouffre financier qu’est le programme PSC, et qu’ils créent à la place une nouvelle classe de sous-marins diesel-électriques « bon marché et silencieux ». Ces sous-marins seraient basés sur le moteur Stirling suédois (un système de propulsion indépendante de l’air — AIP — silencieux et durable). Ils ont surpassé nos propres groupes aéronavals lors d’exercices conjoints et de simulations de guerre, où le petit sous-marin suédois diesel-électrique à 100 millions de dollars a facilement neutralisé notre porte-avions à 6 milliards.
Je baptise ces nouveaux navires agiles et économiques les sous-marins de « classe Hickel », en hommage à Wally Hickel, célèbre gouverneur de l’Alaska à deux reprises et ancien secrétaire à l’Intérieur sous la présidence de Nixon, qui a promu l’idée d’un Alaska riche en ressources comme faisant partie des biens communs mondiaux.
Pourquoi se contenter de suivre et surveiller les brise-glaces comme le fait aujourd’hui l’Amérique, tout comme l’ont fait les Russes lorsque les États-Unis ont envoyé le Healy il y a deux ans dans la mer de Laptev, juste au nord des voies côtières de la Route maritime du Nord, en direction de Tromsø, en Norvège, pour une mission scientifique que la Russie a suivie de près sans toutefois y faire obstacle ?
Pourquoi accepter la rivalité mal avisée de l’actuel « fossé des brise-glaces », qui rappelle sous bien des aspects le tristement célèbre « missile gap » de l’ère (John F.) Kennedy — fondé sur une perception erronée (voire une pure invention) selon laquelle les Russes avaient pris de l’avance sur les États-Unis en matière d’ICBM — et qui a conduit à une prolifération coûteuse et dangereuse d’armes nucléaires stratégiques et de leurs plateformes de lancement, plaçant le monde à une simple erreur de l’extinction humaine ?
Le fossé des brise-glaces est un mirage, pas une menace
Le « fossé des brise-glaces » et la course actuelle pour rééquilibrer la présence dans l’Arctique ne sont probablement pas aussi dangereux que cela, et ne seront vraisemblablement jamais aussi coûteux ou gaspilleurs. Les brise-glaces, tout le monde en convient, sont étonnamment polyvalents : ils servent non seulement à affirmer la souveraineté et à maintenir une présence polaire, mais aussi à de nombreuses missions utiles comme la recherche et le sauvetage, la collecte de renseignements et les expéditions scientifiques.

Mais étant donné l’énorme gouffre financier du programme PSC, dans lequel les contribuables américains ont déjà englouti 2 milliards de dollars sans aucun résultat tangible — une somme suffisante pour acheter un sous-marin nucléaire stratégique capable non seulement de dissuader toute agression contre les États-Unis, mais aussi d’anéantir l’existence souveraine de tout ennemi assez imprudent pour les défier militairement — la capacité du programme à gaspiller l’argent public est déjà tristement avérée.
Ce qui renforce encore les doutes quant à la pertinence d’investir davantage, c’est la nature même de la mission à laquelle le programme PSC était censé répondre : affirmer une présence dans l’Arctique. Or, les États-Unis possèdent l’Alaska, et le pays qui l’a vendu aux États-Unis, la Russie, reconnaît depuis longtemps cette souveraineté.
Ce n’est pas un hasard si le sommet pour la paix entre le président Trump et le président russe Poutine s’est tenu là-bas, sur une base militaire américaine, avec la supériorité aérienne des États-Unis pleinement affichée. Les États-Unis ne se contentent pas de posséder l’Alaska : la Russie reconnaît pleinement leur souveraineté sur cette ancienne colonie de la Compagnie russo-américaine. Point final.
Et oui, la Chine peut désormais déployer (comme elle l’a fait récemment) une flottille de cinq brise-glaces dans la ECS américaine, près de l’Alaska. Mais ce n’est pas la première fois que Pékin envoie une flottille dans les eaux de l’Alaska. Lors de la visite symbolique du président Obama au 49e État en 2015, la Chine avait déjà orchestré une autre flottille de cinq navires — cette fois-ci des navires de guerre — envoyés dans les îles Aléoutiennes juste à temps pour l’arrivée du président à Nome.
Cinq est sans aucun doute le chiffre fétiche de Pékin pour ses démonstrations maritimes. Et si cela peut impressionner, ce n’est pas si impressionnant. Cinq, parce que Pékin n’a pas dix unités à déployer en même temps. Cinq fait pâle figure face aux quarante unités bien plus robustes de la Russie. Il est utile de rappeler que la vaste région arctique de la Russie, avec ses 2 millions de milles carrés, dépasse de loin les 663 000 milles carrés américains — qui, eux-mêmes, surpassent infiniment les zéro mille carré de territoire arctique chinois.
Des sous-marins plutôt que des brise-glaces : plus de présence, moins de coûts
Si les États-Unis disposaient d’une flotte de sous-marins économiques de classe Hickel, parfaitement adaptés aux eaux glacées, bruyantes et encombrées de la région, ils pourraient facilement affirmer leur présence maritime souveraine dans l’Arctique — en surface ou en profondeur — et suivre chaque étape du trajet de la flottille chinoise.
Ses avantages à double usage s’étendraient également bien au-delà de la recherche en surface et des démonstrations diplomatiques de présence maritime dans l’Arctique, pour inclure la recherche en profondeur ainsi qu’un large éventail de missions de recherche et sauvetage (SAR) et de lutte anti-sous-marine (ASW).
Et si une guerre venait à éclater, ces petits sous-marins robustes pourraient facilement couler une flottille de brise-glaces rivale (ainsi qu’un groupe aéronaval hautement protégé) depuis les profondeurs, sans laisser d’empreintes compromettantes — le type de « double usage » dont l’Amérique pourrait vraiment avoir besoin un jour.
Avec la même somme gaspillée dans le programme PSC — largement hors budget et gravement en retard (et qui n’a toujours pas livré un seul brise-glace) — les États-Unis pourraient posséder 20 sous-marins de classe Hickel à seulement 100 millions chacun. Plutôt qu’une promesse incertaine d’un futur brise-glace lourd vanté par des brochures ambitieuses, l’Amérique disposerait d’une flotte utile de sous-marins polaires à double usage, capables de remplir des missions variées et dotés d’une puissance dissuasive bien plus crédible. Voilà un investissement plus judicieux.
Le Canada remet en question les brise-glaces : les sous-marins sont plus logiques
Depuis le nord, de l’autre côté du 49e parallèle, nous parvient une dose bienvenue et nécessaire de bon sens — une sagesse utile qui pourrait aider à ralentir, voire stopper, la frénésie américaine actuelle autour des brise-glaces. Comme l’a rapporté Murray Brewster, journaliste principal en défense pour CBC, « un ancien haut commandant naval et plusieurs experts en défense restent perplexes face à la récente volonté d’équiper la Marine royale canadienne de brise-glaces lourds et armés pour défendre l’Arctique ».
Découvrez les livres écrits par nos collaborateurs
Brewster added: “Retired vice-admiral Mark Norman told CBC News the decision to build more icebreakers seems more political than practical. … ‘I’m puzzled, because I don’t know what it is we’re trying to achieve other than the political objective of demonstrating a commitment to Arctic sovereignty.”
Brewster cite également l’expert canadien en sécurité arctique Rob Huebert, de l’Université de Calgary, qui a suggéré que « le Canada serait mieux servi en investissant dans des sous-marins capables d’opérer sous la glace. ‘Si vous êtes réellement dans un conflit armé, vous saurez tout de suite où se trouve le brise-glace’, a déclaré Huebert. ‘Si vous allez investir de l’argent quelque part, investissez-le dans un sous-marin et donnez-lui une certaine capacité antimissile.’ »
Moins de pompe, plus de puissance : repenser la stratégie arctique
Comme l’a observé Craig Hooper, un autre critique du programme PSC, dans Forbes : « Au cours des derniers mois, l’approche de l’Amérique en matière de sécurité polaire a été un mélange déroutant d’engagements futurs assortis de reculs immédiats » et, « [m]algré toute l’attention de la Maison-Blanche, la flotte américaine de brise-glaces reste en ruine. »
Unfortunately, “No quick fixes are in sight. Right now, America’s icebreaker shipbuilding effort is offering more pomp than product.” What America really needs to dominate our warmer, faster paced world is not $2 billion of taxpayer funded “pomp.”
Ce qu’il faut plutôt, c’est une nouvelle flotte de sous-marins bon marché (comparés aux coûteux et toujours non livrés cutters de sécurité polaire), silencieux et d’une remarquable discrétion. Il faut aussi des essaims de drones longue portée, bien moins coûteux et facilement déployables à grande échelle, ainsi qu’un collier de bases de drones réparties sur les vastes territoires côtiers et insulaires de l’Alaska, et des patrouilleurs littoraux à faible coût pour sécuriser l’interface mouvante entre haute mer et bordure glaciaire.
Il est temps de se libérer du fossé des brise-glaces
Arctic security expert Jeremy McKenzie has also shed an unflattering light on the troubled PSC program: “I have long felt the USCG is focused on icebreakers at the cost of other much needed Federal investments in the Arctic … Instead we have focused on a large and vulnerable shiny new command that has absorbed an incredible amount of the available resources and attention.” (McKenzie further refines his refreshing critique of the misguided PSC program in this thoughtful analysis on West Point’s Modern War Institute blog.)
Je crois qu’il est temps pour les États-Unis de véritablement « reconstruire en mieux » (comme l’a justement formulé l’ancien président Biden, s’appuyant sur les bases posées lors de la première administration Trump), et l’on pourrait ajouter : « avec sagesse budgétaire » — sans continuer à s’enfoncer dans le terrier médiatique et hystérique d’un « fossé des brise-glaces » illogique et largement imaginaire.
Les États-Unis n’ont pas besoin de plus de brise-glaces. Ils ont besoin de vision
La Russie a peut-être besoin de 40 brise-glaces pour maintenir sa Route maritime du Nord ouverte au commerce. Le Canada pourrait un jour en avoir besoin aussi — si Ottawa décide enfin d’ouvrir son Passage du Nord-Ouest, sinueux, peu profond et encore largement inexploré (ce qui reste un grand « si »).

Et bien que la Chine ait accompli des merveilles diplomatiques avec sa flottille de cinq brise-glaces dans les eaux polaires américaines, cela relève en grande partie de l’illusion : la Chine ne possède aucun territoire arctique, donc sa flottille combative constitue la présence arctique de Pékin. Et comme je l’ai expliqué plus haut : les États-Unis sont le souverain incontesté de l’Alaska et n’ont pas besoin de répondre à la flottille de Pékin par la leur.
De l’archipel du sud-est de l’Alaska à la chaîne des îles Aléoutiennes qui franchit la ligne de changement de date, en passant par la région du North Slope riche en infrastructures (et avec un port en eaux profondes en projet dans la communauté de Nome, au sud de la péninsule de Seward), les États-Unis disposent déjà d’une forte présence arctique. Si Washington souhaite affirmer une présence maritime plus mobile et durable au large des côtes de l’Alaska, une flotte de mes sous-marins de classe Hickel pourrait facilement contenir la Chine — ou tout autre intrus polaire.
Qu’il s’agisse d’un affrontement futur contre la Chine et/ou la Russie, comme beaucoup le redoutent, ou contre le Groenland et/ou le Canada, comme je le juge actuellement plus probable, ou tout simplement contre la fonte de la glace polaire et la montée des mers — ce qui est en réalité le scénario le plus probable — il est impératif que les États-Unis concrétisent la vision de William H. Seward. Il a formulé cette vision le 14 septembre 1853 dans son discours Destiny of America, appelant les États-Unis à devenir une puissance polaire et, ce faisant, une véritable puissance mondiale (il y a exactement 172 ans, jour pour jour, à la date de rédaction de cet article !).
Dans ce cheminement polaire essentiel et toujours en cours, les États-Unis peuvent — et doivent — faire un bien meilleur travail pour comprendre l’Arctique et la place qu’il occupe dans un monde en réchauffement et de plus en plus dynamique — et défendre plus intelligemment leur part du territoire.