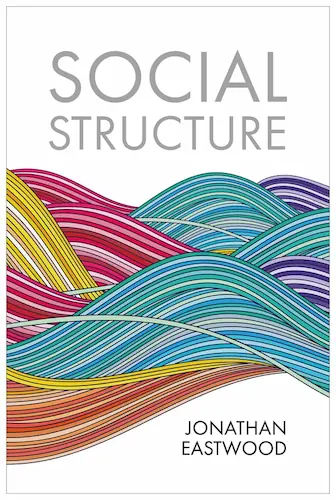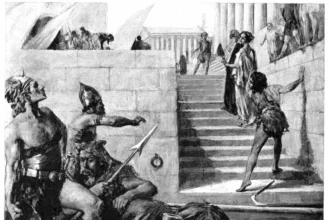Pourquoi une pensée claire sur les structures sociales est essentielle pour les politiques publiques
Combien de fois vous êtes-vous surpris à attribuer quelque chose à la « structure sociale », ou à entendre d’autres le faire ? Saviez-vous exactement ce que vous ou eux vouliez dire ? Ou bien cette expression reflétait-elle plutôt une intuition, une impression que des forces plus profondes agissaient sous la surface ? Nous utilisons souvent de telles formules avec assurance, mais le devrions-nous ? Et existe-t-il des moyens d’améliorer notre capacité à savoir précisément ce que nous voulons dire lorsque nous évoquons les structures sociales ?
- Pourquoi une pensée claire sur les structures sociales est essentielle pour les politiques publiques
- Clarifier un concept sociologique fondamental
- L’enseignement comme source de réflexion théorique
- Le problème du flou conceptuel et pourquoi il est important
- Un cadre pour les structures sociales : relations, représentations et règles
- Des actes de base aux structures sociales complexes : une approche en strates
- De la théorie à l’application : repenser les modèles et les politiques à travers les structures sociales
- Relier sociologie et économie : une complémentarité structurelle
- Approche sociologique de l’analyse des politiques publiques : un cadre pragmatique
Ces questions ne relèvent pas seulement du domaine académique, car la réflexion sur les politiques et la vie publique implique fréquemment des affirmations à propos des structures sociales. Comment pourrions-nous comprendre les inégalités en matière de santé, les écarts dans la réussite éducative, les différences d’accès aux services publics ou les divers niveaux de participation civique (ainsi que tant d’autres résultats d’importance morale) sans une pensée claire sur les structures sociales ?
Clarifier un concept sociologique fondamental
Social Structures: Relationships, Representations, and Rules examine ce que nous pourrions vouloir dire lorsque nous invoquons ce concept et soutient qu’il nous faut faire des choix réfléchis sur la manière de le faire.
Puisque l’analyse des structures sociales constitue l’objectif central de la sociologie, cela implique que, malgré la qualité et la pertinence du travail souvent accompli par les sociologues, il y a fréquemment un manque de clarté concernant notre concept le plus fondamental.
Je ne promets pas une solution universelle, mais je propose plutôt un ensemble de stratégies pragmatiques pour parvenir à une plus grande clarté. J’invite les étudiants et les collègues à essayer un ensemble particulier de démarches conceptuelles et à explorer si celles-ci leur conviennent.
Les démarches elles-mêmes sont le fruit de ma propre sélection, distillation, organisation et synthèse d’un certain nombre de contributions partielles formulées par des sociologues classiques et contemporains (voir les références dans l’ouvrage lui-même).
Les excellents étudiants avec lesquels j’ai travaillé — ceux qui ont contribué au développement de ces idées et ceux qui les ont ensuite lues et mises en pratique — me donnent l’espoir que d’autres les trouveront également utiles.
L’enseignement comme source de réflexion théorique
En réalité, ce livre est né de l’enseignement. Je travaille dans un petit établissement d’arts libéraux avec des étudiants remarquables. Pendant la pandémie, nous nous réunissions en présentiel — en plein air, sous une tente ! — deux fois par semaine, et j’enregistrais chaque semaine une vidéo de cours pour aborder du contenu complémentaire.
Nous devons identifier les types fondamentaux de structure sociale, les éléments constitutifs de structures plus complexes, afin de saisir conceptuellement ces ensembles plus vastes.
Le fait d’enregistrer ces cours en vidéo sans retour interactif a focalisé mon attention sur les idées que j’exprimais, d’une manière qui m’a permis de réaliser que, dans ma propre réflexion, j’avais négligé certaines ambiguïtés et contradictions que je n’avais pas remarquées auparavant. Fait intéressant, certains étudiants avec lesquels j’ai discuté de ces questions ont remarqué la même chose à propos de leur propre engagement avec la théorie en sciences sociales.
Ce livre est né des graines semées lors de ces premières conversations. Avant tout, je voulais clarifier ma propre pensée, car si l’on ne pense pas clairement, comment pourrait-on bien enseigner ou faire de la recherche ? Ensuite, je voulais devenir un meilleur enseignant, capable d’expliquer les idées centrales de mon domaine de manière plus satisfaisante, et produire un texte que d’autres pourraient trouver utile, que ce soit pour l’enseignement ou pour leur propre réflexion.
Le problème du flou conceptuel et pourquoi il est important
Peut-être que le lecteur pensera que c’était simplement mon problème : je ne savais pas comment expliquer le concept de manière claire et cohérente, mais que d’autres l’ont fait et le font encore. C’est possible. Mais dans le deuxième chapitre du livre, je passe en revue plusieurs choses que les chercheurs entendent parfois lorsqu’ils invoquent la structure sociale.
Les structures sociales qui nous entourent dans le monde semblent d’une complexité écrasante.
Il est facile de montrer que le terme est souvent utilisé de manière à la fois floue et incohérente. Est-ce un problème ? Certains pourraient être tentés de dire que, si ce flou ne dérange personne, s’il ne provoque pas de dissonance cognitive, alors peut-être que non.
Mais cela dérange au moins certains d’entre nous, et j’ai constaté que cela dérange de nombreux étudiants — des étudiants sérieux, qui veulent comprendre ce dont ils parlent — et l’on peut se demander combien d’autres ont abandonné la théorie sociologique en découvrant un tel flou autour d’un concept central (sans parler de l’indifférence apparente à son sujet).
De plus, l’usage incohérent du terme devrait clairement nous préoccuper, car il engendre sans aucun doute des malentendus et réduit vraisemblablement notre capacité collective à produire des connaissances.
Enfin, et c’est peut-être le plus important, si les structures sociales sont réelles et ont des conséquences (ce que la plupart des sociologues croient — moi y compris), alors la sociologie a la responsabilité de fournir des explications cohérentes et accessibles sur leur fonctionnement. Les gestes vagues peuvent donner l’illusion de comprendre, mais ils ne remplacent pas une pensée claire et rigoureuse, à la fois exigeante et accessible. J’espère que certaines de ces idées, bien qu’abstraites — ou peut-être utilement abstraites — pourront s’avérer utiles non seulement pour les chercheurs, mais aussi pour les décideurs publics, les militants et les membres du grand public qui souhaitent réfléchir à la manière dont les structures sociales façonnent nos possibilités.
Un cadre pour les structures sociales : relations, représentations et règles
Alors, quelles sont les stratégies que j’ai rassemblées ? Je propose que nous envisagions les structures comme des choses que l’on construit, et que le mot “social” qualifie la structure en indiquant de quoi un certain type de structure est composé. Les structures sociales sont faites d’actes interdépendants (c’est ce que signifie le fait d’être social). Les structures sociales qui nous entourent dans le monde semblent d’une complexité écrasante. Il existe tant de types d’actes, liés entre eux de manière si complexe.
Les structures complexes sont constituées de structures de base entrelacées, à la fois entre elles et en leur sein.
Nous devons identifier les types fondamentaux de structure sociale, les éléments constitutifs de structures plus complexes, afin de saisir conceptuellement ces ensembles plus vastes.
Idéalement, tout schéma conceptuel de ce type devrait être aussi simple que possible et classer les structures sociales de base de manière exhaustive et mutuellement exclusive. Les concepts de ce schéma devraient aussi regrouper les structures de base en catégories que (a) la plupart d’entre nous reconnaissent comme réelles (d’une certaine manière) et, si possible, (b) que la plupart trouvent compréhensibles.
Pour penser les sociétés complexes, il est extrêmement difficile d’atteindre tous ces objectifs. Mon approche ne prétend pas y parvenir parfaitement, mais je n’ai rien rencontré qui, à mes yeux, s’en rapproche davantage. Je propose de commencer par considérer que les types fondamentaux de structure sont les relations, les représentations et les règles : les trois R. Les relations sont toute forme d’interaction récurrente (amitié, liens affectifs, échanges économiques, etc.) entre deux personnes ou plus. Les représentations sont toute forme de catégorisation partagée entre deux personnes ou plus. Les règles sont toute forme de prescription ou de proscription partagée concernant les comportements, qu’elle soit formelle ou informelle.
Des actes de base aux structures sociales complexes : une approche en strates
Nous pouvons rendre chacune de ces catégories plus concrète en précisant les actes de base dont elles sont constituées. Les relations sont construites — et ne sont rien d’autre que cela — par des actes interdépendants et continus d’affiliation et de désaffiliation (qui prennent bien sûr différentes formes selon le type de relation).
Les représentations sont des actes partagés ou superposés et interdépendants de catégorisation (l’identification, c’est-à-dire le fait de se placer soi-même dans une catégorie, et l’attribution, le fait de placer autrui ou une chose dans une catégorie). Mon point de vue est que les catégories établies sont des “équilibres” dans les nombreux actes d’identification et d’attribution auxquels elles sont associées.
Au “sommet”, on trouve des structures complexes, comme le schéma de ségrégation résidentielle raciale dans un quartier, les structures organisationnelles formelles et informelles d’une entreprise ou d’une entité gouvernementale, ou les réseaux collaboratifs de personnes et d’idées dans un domaine de travail créatif. Les structures complexes sont composées de structures de base entrelacées entre elles et en leur sein. L’intraliaison désigne l’entrelacement de structures d’un même type (par exemple, plusieurs types de relations se chevauchant dans un réseau multiplexe ; de nombreuses représentations partagées liées en un ordre symbolique ; des ensembles de règles imbriqués qui forment des codes).
L’interliaison est l’entrelacement de structures complexes de types différents. Par exemple, les réseaux relationnels véhiculent des ensembles de représentations partagées. Les règles d’association façonnent les schémas relationnels d’une manière susceptible de générer des boucles de rétroaction. Dans le livre, je propose une typologie initiale des formes d’interliaison, mais il s’agit d’un domaine immense dans lequel la théorie pourrait facilement se développer.
De la théorie à l’application : repenser les modèles et les politiques à travers les structures sociales
Remarquez comment les stratégies proposées ici favorisent une théorisation ouverte. Il n’y a rien de cette mentalité du “j’ai découvert la logique interne cachée du système” des anciens grands théoriciens. Mais je refuse également la fragmentation conceptuelle qui a suivi le déclin de la grande théorie.
Les stratégies proposées pourraient aider à coordonner autour d’un ensemble simple de concepts facilitant la communication, la mise à jour et l’apprentissage partagé. En d’autres termes, ce n’est pas une théorie, mais un cadre pour théoriser. Dans le livre, je propose des lectures de plusieurs excellentes ethnographies contemporaines pour montrer comment on peut extraire et mutualiser certaines de leurs idées en utilisant les trois R.
En effet, la seconde moitié du livre se concentre sur les implications et les applications. Le quatrième chapitre traite de ce que ces stratégies conceptuelles suggèrent pour penser l’explication en sciences sociales, en dialoguant avec des philosophes de renom ayant écrit sur les explications structurelles et en montrant comment les meilleurs travaux sociologiques élaborent déjà des théories novatrices sur les interliaisons, ce qui peut être révélé si l’on lit ces travaux à travers les trois R.
Découvrez les livres écrits par nos collaborateurs
Le cinquième chapitre porte sur l’analyse quantitative en sciences sociales, en distinguant la “structure” du “contexte” et en explorant comment différents types de modèles conventionnels permettent — ou non — d’étudier ou de prendre en compte les variables structurelles. Certains types de modèles neutralisent les structures par le biais de contrôles. D’autres les modélisent directement. Mais les sciences sociales statistiques accordent relativement peu d’attention à la manière dont nos modèles représentent — ou non — les structures sociales (à l’exception de l’analyse des réseaux sociologiques, où ce type de réflexion est plus avancé, mais souvent limité aux structures relationnelles).
Le dernier chapitre porte sur l’analyse des politiques publiques et l’évaluation des programmes. Son idée directrice est que de nombreuses analyses conventionnelles des politiques s’appuient sur un cadre théorique très limité issu de la microéconomie. Ce cadre est très utile dans une certaine mesure, mais il présente de grandes lacunes concernant les structures sociales.
Relier sociologie et économie : une complémentarité structurelle
Les stratégies proposées dans ce livre pour penser les structures sociales ne constituent pas une alternative concurrente, mais une approche complémentaire.
Elles sont compatibles avec la microéconomie contemporaine et viennent la compléter, car les deux perspectives partagent un intérêt pour l’individualisme méthodologique. Toutes deux considèrent les actes intentionnels des individus comme la véritable base de tout contexte complexe, qu’il s’agisse d’un marché ou d’un autre environnement. Toutes deux expliquent les phénomènes en identifiant les mécanismes par lesquels les actes de base se transforment en schémas plus complexes. La perspective sociologique met l’accent sur la façon dont les schémas résultants prennent une forme structurelle qui façonne les incitations aux actes suivants.
Par conséquent, j’espère que les spécialistes des politiques publiques orientés vers l’économie (qui prédominent dans l’analyse des politiques) ainsi que leurs étudiants trouveront certaines de ces idées utiles. En effet, certains économistes reconnaissent de plus en plus l’importance de la structure en réseau de la vie économique, et les “institutions” étudiées depuis des décennies par les économistes institutionnalistes sont clairement des structures sociales au sens utilisé dans ce livre (elles sont, en effet, des ensembles de règles intraliées).
Approche sociologique de l’analyse des politiques publiques : un cadre pragmatique
L’approche sociologique de l’analyse des politiques publiques proposée ici n’est pas une alternative, mais un ensemble d’idées complémentaires pouvant être intégrées à l’analyse causale des interventions, en se concentrant particulièrement sur la manière dont une réflexion rigoureuse sur les structures sociales peut nous aider à raisonner sur, et donc à évaluer, la variabilité contextuelle des effets des politiques. Cela a des implications tant pour la mise en œuvre que pour l’évaluation des politiques.
Le fait que cette perspective soit complémentaire ne la rend pas moins importante. Je soutiens que l’analyse des politiques publiques a besoin de la sociologie — y compris d’une théorie sociologique claire et accessible — précisément parce que les politiques sont mises en œuvre dans des contextes structurels sociaux, et notre capacité à les prendre en compte dépend de notre aptitude à raisonner clairement à leur sujet.
Comme j’espère que le livre le montre clairement, la justification que je propose est pragmatique et provisoire. L’approche n’est pas présentée comme une solution figée à un problème durable, ni comme la seule, mais comme une série d’étapes de réflexion que d’autres pourraient envisager. Essayez-les ! Si elles vous sont utiles, j’espère que vous les adopterez et les développerez. Sinon, j’espère que vous passerez à autre chose. Et si elles cessent un jour de m’être utiles, je passerai à autre chose moi aussi.