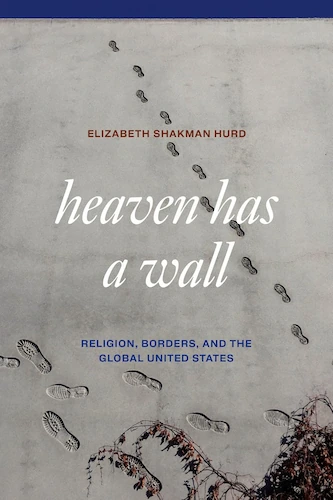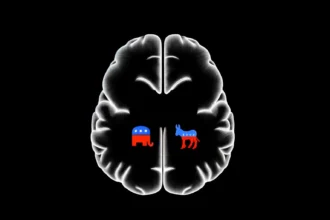Empreintes à la frontière
Il y a quelques années, lors d’un voyage dans la région frontalière du sud-ouest, un ami et moi avons visité le poste frontière de Mariposa, près de Nogales, en Arizona. En flânant dans les jardins autour de l’installation, j’ai été frappée par l’œuvre artistique.
- Empreintes à la frontière
- Concevoir la frontière comme une connexion
- Une frontière ouverte aux marchandises, fermée aux personnes
- Le paradoxe de borner une puissance sans frontières
- Frontières comme enlacement politique et religieux
- Passage, coercition et imagination de l’absence
- Tracer la ligne : dépossession et fabrication de la frontière
- Souveraineté cooptée et asymétries de pouvoir
- La personnalité morale des entreprises et la disparition de la frontière
- Posséder la ligne : capital, bétail et externalisation de la souveraineté
J’ai pris la photo qui figure sur la couverture de Heaven Has a Wall, montrant des empreintes de pas d’adulte et d’enfant incrustées dans des murs en béton pare-balles. Ces traces évoquent un parent et un enfant marchant ensemble sur les murs, montant et quittant l’installation, les empreintes plus petites s’élevant vers le ciel. Étaient-ils morts ? Sortis du bâtiment ou du pays ? Avaient-ils été séparés ? Les murs étaient inquiétants et, étrangement, porteurs d’humanité.
Concevoir la frontière comme une connexion
Entre 2009 et 2014, le point d’entrée terrestre de Mariposa a fait l’objet d’une rénovation de 250 millions de dollars, menée par le cabinet d’ingénierie Stantec. Par un heureux hasard, un ami de lycée qui travaillait chez Stantec m’a mise en relation avec l’ingénieur principal du projet, qui m’a ensuite présenté le designer en chef, Eddie Jones, de Jones Studio.
Jones a décrit sa vision de Mariposa comme un lieu de connexion entre les deux pays, plutôt qu’un point de division. Il a trouvé son inspiration dans le poème « Border Lines » du poète lauréat de l’Arizona, Alberto Ríos, et a fièrement souligné que ce poème est aujourd’hui gravé sur une cloison vitrée dans les files d’attente du hall du point d’entrée rénové :
« Tournons la carte jusqu’à voir clairement :
La frontière est ce qui nous unit,
Pas ce qui nous sépare. »
Lorsque j’ai interrogé Jones au sujet des empreintes, il m’a répondu que les murs froids en béton pare-balles réclamaient qu’on leur « donne une histoire ». Un artiste public de son équipe a eu l’idée de recouvrir le béton incliné d’empreintes.
Le béton a été coulé sur place à l’horizontale selon une technique de dalles inclinées. De vraies baskets ont été utilisées pour laisser les empreintes sur les murs. Quand je lui ai demandé où allaient ces empreintes, il m’a simplement répondu : « elles sont en voyage ».
Une frontière ouverte aux marchandises, fermée aux personnes
En réalité, bien plus de tomates que de personnes passent par Mariposa. Ce poste-frontière est le principal point d’entrée de soixante pour cent des produits agricoles d’hiver consommés aux États-Unis. La valeur totale des exportations et importations qui y transitent chaque année avoisine les 35 milliards de dollars. Pour les tomates, la frontière est ouverte.

Voici Mariposa : lieu d’art public, poste de contrôle, plateforme commerciale, exposition artistique, point d’entrée des tomates, oasis accueillante et structure de sécurité pare-balles. Frontières et absence de frontières. Poésie et prison. Jardins et gardes. Accueil et murs. Selon les mots des auteurs du Rapport sur le 11 septembre : « le territoire national américain, c’est la planète ». Fontaines et peur. Cela révélait quelque chose sur les frontières américaines qui méritait d’être observé : le désir des États-Unis d’avoir des frontières tout en les dépassant, d’imposer la loi tout en la suspendant. Être le premier parmi les égaux.
Élaborer les règles sans y être soumis. Les Américains peuvent construire le canal de Panama, apporter la démocratie au Moyen-Orient, conquérir l’espace, innover pour sortir d’une catastrophe climatique, réécrire les règles de l’ordre international, et faire du passage des frontières une expérience aussi agréable qu’une visite de musée avec fontaine et jardin.
Selon les mots des auteurs du Rapport sur le 11 septembre : « le territoire national américain, c’est la planète ».
Le paradoxe de borner une puissance sans frontières
Étudier les frontières américaines a renforcé ce sentiment paradoxal d’enfermement sans limites. Les frontières sont insaisissables. Elles sont plus complexes qu’elles n’y paraissent au premier abord. Ce sont des zones liminales, des lieux d’extrêmes, d’exceptions et de règles particulières. Il est tentant de regarder par-dessus son épaule après avoir traversé.
La frontière est un lieu de retranchement et de transcendance ; d'oppression et d'effacement. C’est là que la loi est à la fois suspendue et appliquée. Les États-Unis défendent farouchement leurs frontières, alors même que l'idéal américain se veut sans frontières.
Cette impulsion persiste à travers l’histoire jusqu’à aujourd’hui : l’achat de la Louisiane ; l’annexion du Texas et l’expansion vers la Californie ; les débats sur l’annexion de Cuba, et aujourd’hui, du Groenland, du canal de Panama, du Venezuela. Qu’est‑ce qui lie tout cela ?
Les frontières des États‑Unis ont toujours été présentes et absentes, proclamées et différées. Heaven Has a Wall s’aventure au cœur de ce paradoxe et en explore les contours et contradictions. Chaque chapitre aborde un aspect différent du bornage américain : créer, appliquer, suspendre et refuser.
Ceux‑ci alternent avec une série d’interludes qui plongent le lecteur dans des énigmes liées à la frontière : Où se trouve la base américaine de Guantanamo ? Aux États‑Unis, à Cuba, aux deux ou ailleurs ? Que ressent‑on à être un pèlerin à qui l’on interdit de traverser une frontière d’État alors que le pèlerinage est plus ancien que la frontière elle‑même ? Que se passe‑t‑il lorsque des États tentent de transformer des rivières qui serpentent naturellement en frontières nationales fixes ?
Frontières comme enlacement politique et religieux
Les frontières attirent aussi une personne vers quelque chose de plus grand. Comme la politique. Et la religion. Dans son livre Consuming Religion, la spécialiste des religions Katie Lofton observe que « la religion n’est pas seulement quelque chose que l’on rejoint, cœur ouvert et confiant. Ce n’est pas seulement quelque chose que l’on hérite… [C’est] aussi ce dans quoi on se retrouve pris malgré soi. » Elle « consacre certains engagements plus forts que presque tous les autres actes de participation sociale ».
Les frontières sont aussi des lieux d’enchantement et de mystère.
Les frontières sont comme ça. Ce sont des modes de participation sociale qui consacrent des engagements forts. Elles vous obligent à participer. Elles vous enserrent. Vous ne pouvez pas choisir de quel côté vous êtes né. L’agent détient votre passeport.
Parfois, ils retiennent littéralement votre passeport. L’un des interludes raconte ma propre expérience lors du passage de la frontière à O’Hare, le principal aéroport de Chicago, avec ma famille. J’étais interrogée par un agent qui revenait tout juste de la frontière américano-mexicaine, au Texas.
Après quelques échanges, il m’a demandé ce que je faisais dans la vie, et je lui ai dit que j’étudiais les frontières américaines. Son attitude est devenue agressive. Il a affirmé que les reportages sur les enfants détenus dans des cages « étaient tous des mensonges ». Cette conversation a eu lieu quelques jours après que le Département de la Sécurité intérieure a publié un rapport accablant documentant les conditions horribles dans lesquelles étaient détenus des enfants dans des cages près de la frontière, notamment au Texas. Je suis restée sans voix.
Passage, coercition et imagination de l’absence
Cet interlude, et le livre dans son ensemble, invitent les lecteurs à réfléchir au fait de traverser—leurs propres passages, ceux de leurs proches, et ceux des autres.
Qui passe par l’interrogatoire, la prison ou la détention, et qui n’a pas besoin de présenter de passeport ? Comment ces expériences changent‑elles avec les données biométriques et la reconnaissance faciale ? J’invite les lecteurs à réfléchir à quel point les frontières sont concrètes, incarnées et souvent effrayantes. Il y a quelque chose de l’Inquisition dans le fait de les franchir. L’agent frontalier et l’inquisiteur médiéval ne sont pas si éloignés l’un de l’autre.
Les tactiques frontalières des États-Unis se sont mondialisées.
Les frontières sont aussi des lieux d’enchantement et de mystère. Elles attirent des contre-souverainetés et des mouvements de protestation. Elles ouvrent à d’autres expériences de la temporalité. Elles nous incitent à envisager d’autres manières d’organiser le temps, l’espace et l’autorité. Ironiquement, la forte présence de la frontière nous pousse à imaginer sa possible absence. Ou tout du moins sa reconfiguration.
L’un des interludes du livre montre comment la frontière peut être à la fois présente et absente. C’est une histoire de l’« Âge doré » faite de possession et de dépossession, d’accaparements de terres qui réunissent les troupeaux de bétail mais séparent les familles, de pouvoir économique et politique. Des éleveurs et des chemins de fer d’un côté, et du déracinement et de la dépossession de l’autre.
Tracer la ligne : dépossession et fabrication de la frontière
Le contrôle américain des actuelles terres frontalières entre les États-Unis et le Mexique a commencé au milieu du XIXe siècle, avec le traité de Guadalupe Hidalgo de 1848 et l’achat Gadsden de 1853.

La frontière a tranché les terres des O’odham en deux, laissant des familles de part et d’autre. Les auteurs du tracé n’ont pas consulté les tribus, et la plupart ignoraient qu’une frontière avait été dessinée, et cela a duré des décennies. Plus tard, au XIXe siècle, le contrôle frontalier américain s’est intensifié, les États-Unis cherchant à s’étendre dans des zones jusque-là autogérées de manière informelle. C’est l’époque des chemins de fer, des mines et de la destinée manifeste. En 1916, le président Wilson a créé une réserve permanente pour les O’odham et érigé la première clôture à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.
Pour le peuple O’odham, la fin du XIXe siècle et le début du XXe ont été une période de dépossession. L’historienne Rachel St. John note que, bien que “certains (Tohono O’odham) aient travaillé comme cow-boys pour des ranchs mexicains et américains, s’intégrant comme salariés aux échelons inférieurs de l’économie transfrontalière, le tableau d’ensemble est celui d’une perte de terres”. Réduite à un dixième de sa taille d’origine, leur réserve couvre aujourd’hui 2,7 millions d’acres—soit environ la taille du Connecticut—et constitue la deuxième plus grande réserve des États-Unis.
Souveraineté cooptée et asymétries de pouvoir
Aujourd’hui, les O’odham exercent, avec le gouvernement des États-Unis, une souveraineté largement réduite et en partie cooptée. En 1974, le Congrès a créé une patrouille frontalière entièrement autochtone, les Shadow Wolves, affectée à l’unité de patrouille tactique des Enquêtes de sécurité intérieure dans la Nation O’odham.
Les peuples autochtones, notamment les Yaquis et les O’odham, ont été les plus durement touchés lorsque des “entreprises” mexicaines détenues par des intérêts américains sont devenues les pierres angulaires d’une économie capitaliste transfrontalière florissante.
Célèbres pour être l’une des unités les plus efficaces de la Patrouille frontalière, les Shadow Wolves ont formé des gardes-frontières, des douaniers et des policiers dans des pays éloignés d’Asie centrale et d’Europe de l’Est, notamment en Lettonie, Lituanie, Estonie, Kazakhstan et Ouzbékistan. Les tactiques frontalières américaines se sont mondialisées. Les O’odham ont des sentiments partagés quant à leur coopération avec les autorités américaines. Nombreux sont ceux qui continuent à protester contre les coûts environnementaux, sociaux et spirituels de la militarisation de leurs communautés.
De l’autre côté de l’équation, également entre le milieu et la fin du XIXe siècle, des éleveurs américains achetaient d’immenses étendues de terre des deux côtés de la frontière américano-mexicaine. Leur expérience fut bien différente de celle des communautés autochtones. Tandis que la frontière s’imposait aux dépens des O’odham et d’autres nations indigènes, elle était contournée par de riches capitalistes cherchant à investir du côté mexicain d’une économie capitaliste transfrontalière en plein essor. Les Américains avaient longtemps été interdits de posséder des terres près de la frontière en vertu d’une loi mexicaine sur les zones restreintes. Mais les investisseurs ont contourné cette loi pour faire disparaître la frontière, comme par magie.
La personnalité morale des entreprises et la disparition de la frontière
L’astuce consistait à invoquer la nationalité d’entreprise et à devenir une société légale en vertu du droit mexicain. Cela permettait aux investisseurs “d’accéder à tous les avantages économiques de la citoyenneté mexicaine sans renoncer à leur identité et à leur statut de citoyens américains”. Comme l’explique St. John, “selon le droit mexicain, toute entreprise constituée selon les lois du Mexique bénéficiait de tous les droits de citoyenneté, sauf le droit de vote. En créant une société mexicaine, les capitalistes américains transcendaient légalement les limitations de la citoyenneté des États-Unis”.
Découvrez les livres écrits par nos collaborateurs
Ils contournaient la souveraineté des États-Unis, tout en instituant leurs propres formes de “mini-souveraineté” sur leurs ranchs. Pour ces investisseurs, les intérêts économiques transfrontaliers rendaient les États-Unis sans frontières. Les entités corporatives détenues par des Américains et enregistrées selon le droit mexicain devenaient des nationaux corporatifs mexicains. La fiction juridique de la personnalité morale s’alliait à l’expansionnisme américain et à la liberté offerte par le capital transnational pour effacer les affirmations de souveraineté territoriale, tant de l’État mexicain que de la Nation O’odham.
Parmi ceux qui ont profité de la nationalité d’entreprise mexicaine figurait “Texas John” Slaughter, un éleveur et shérif du “Far West” arrivé en Arizona à la fin des années 1870. Slaughter a exercé deux mandats comme shérif du comté de Cochise, période durant laquelle il a contribué à traquer et capturer le célèbre chef militaire et homme-médecine du groupe Bedonkohe des Apaches Ndendahe, connu sous le nom de Geronimo.
Posséder la ligne : capital, bétail et externalisation de la souveraineté
En 1884, Slaughter acheta le ranch de San Bernardino, une propriété de 65 000 acres traversant la frontière entre l’Arizona et le Sonora. Le traité de Gadsden de 1853 avait tracé la frontière internationale à travers ce ranch, laissant un tiers en Arizona et deux tiers au Sonora. Slaughter établit son quartier général sur la ligne. Son bétail ne faisait pas que paître de part et d’autre : le ranch servait aussi de point de passage pour le bétail acheté aux éleveurs sonoriens et vendu aux consommateurs américains.
Les gouvernements des États-Unis et du Mexique ont facilité la transition vers la propriété privée des terres par des colons fortunés comme Slaughter. En pratique, ils ont externalisé leur souveraineté. Cela a entraîné l’appropriation de millions d’acres de terres habitées, utilisées ou revendiquées par des peuples autochtones et d’autres communautés frontalières. Les peuples autochtones, notamment les Yaquis et les O’odham, ont été les plus durement touchés, car les “entreprises” mexicaines appartenant à des Américains sont devenues les piliers d’une économie capitaliste transfrontalière florissante. En 1910, les investisseurs américains dominaient l’exploitation minière, l’élevage, l’irrigation et la spéculation immobilière. De manière incroyable, à cette époque, les Américains possédaient la majorité des terres des deux côtés de la frontière entre les États-Unis et le Mexique.
Pendant ce temps, les O’odham faisaient face à une Patrouille frontalière nouvellement créée et renforcée, dirigée par nul autre que Jim Milton, ancien employé du bureau du shérif du comté de Cochise sous Texas John Slaughter. Conformément à la politique officielle américaine, Milton refusa catégoriquement de reconnaître les droits des tribus à franchir la frontière. Son ancien patron, lui, pouvait non seulement la franchir, mais aussi la posséder.
J’ai récemment appris qu’à la fin des années 1950, Disney avait adapté l’histoire de Texas John en série télévisée, avec Tom Tryon dans le rôle de Texas John. La chanson du générique disait : “Texas John Slaughter les faisait agir comme il fallait, sinon ils mouraient.” Le narrateur du premier épisode observe : “ce Far West dont nous parlons n’est finalement pas si ancien. C’était hier, dans notre jeune pays.”