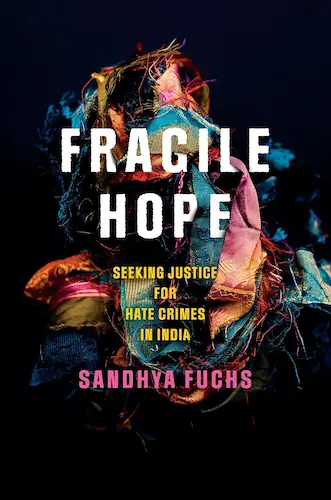Il semble que nous ne vivions pas actuellement dans une époque d’espoir. Plus précisément, il semble que nous n’habitions pas un monde qui inspire une grande confiance dans la capacité des systèmes juridiques à rendre justice, en particulier pour les communautés qui ont historiquement subi oppression et violence systémique.
- Une nouvelle orientation dans la recherche sur les crimes haineux
- Contextualisation de la loi sur la prévention des atrocités
- Échecs inévitables ?
- Loi sur les crimes haineux et le complexe d’espoir mélioriste
- La loi sur les crimes haineux peut-elle avoir un avenir porteur d’espoir ? Peut-être
- Repenser la loi sur les crimes haineux : nouvelles questions pour la recherche sociojuridique
En effet, universitaires et législateurs ont de plus en plus attiré l’attention sur l’échec des régimes de droits humains et des politiques antidiscriminatoires à protéger et à valoriser socialement les groupes historiquement marginalisés, au milieu de l’intensification mondiale des conflits ethniques et religieux et de l’érosion croissante de la démocratie. Un type de législation qui a souvent été au centre de ces débats, et qui est devenu une cible particulière de critiques, est la loi sur les crimes haineux.
Des critiques issus de divers contextes géographiques, culturels et politiques ont à plusieurs reprises averti que les lois sur les crimes haineux représentent une fausse promesse, car il existe peu de preuves qu’elles préviennent les attaques motivées par des préjugés. Certains ont souligné que la mise en œuvre de ces lois repose sur les mêmes acteurs et institutions de justice pénale—comme la police—qui ont historiquement renforcé l’oppression des minorités et des groupes marginalisés. En conséquence, un nombre croissant de chercheurs conclut que le concept même de lois sur les crimes haineux est contre-productif à la promotion de l’égalité sociale et que ces lois devraient être abolies complètement.
Les lois sur les crimes haineux semblent avoir une double fonction : punir les actes passés de violence fondée sur l’identité et prévenir les futurs.
Je ne suis pas ici pour contester ces critiques. En fait, je les considère pleinement justifiées, car la législation sur les crimes haineux à travers le monde a eu, au mieux, un bilan mitigé, et au pire, a aggravé les inégalités institutionnelles et sociales.
Cependant, dans mon nouveau livre Fragile Hope: Seeking Justice for Hate Crimes in India (Stanford University Press 2024), je suggère que les études mettant en lumière les limites et les échecs des lois sur les crimes haineux ne racontent pas toujours toute l’histoire. Jusqu’à présent, les universitaires, commentateurs juridiques et décideurs politiques ont largement négligé d’explorer ce que signifie le succès juridique pour les survivants eux-mêmes, et comment ils mobilisent de manière créative la législation sur les crimes haineux pour leurs propres efforts de réparation et de justice sociale.
Une nouvelle orientation dans la recherche sur les crimes haineux
Fragile Hope est un exercice d’anthropologie juridique qui vise à combler cette lacune.
Elle explore la relation entre la loi sur les crimes haineux, l’inégalité structurelle et l’espoir en retraçant la vie sociale de la seule loi en Inde qui présente les caractéristiques d’une législation sur les crimes haineux : la loi de 1989 sur la prévention des atrocités contre les castes/tribus répertoriées (PoA). La PoA vise à protéger les Dalits (groupes de castes encore traités comme « intouchables » par beaucoup au sein de la hiérarchie des castes hindoue, bien que la constitution indienne ait aboli la pratique de l’intouchabilité en 1950) et les Adivasi (communautés indigènes) contre la violence ciblée des castes supérieures.
S’appuyant sur près de deux ans de travail de terrain ethnographique avec des survivants d’atrocités de caste issus des Dalits, des militants des droits humains, la police et les tribunaux de l’État du Rajasthan, dans le nord de l’Inde, entre 2016 et 2018, le livre vise à répondre à trois questions urgentes, mais souvent négligées :
Que signifie réellement le succès des lois sur les crimes haineux ? À quelle vision du succès rendent-elles compte ? Et comment les survivants de crimes haineux, leurs familles et leurs communautés tentent-ils de trouver du succès dans un paysage juridique fondamentalement défavorable ?
En regardant derrière le rideau des statistiques officielles sur la criminalité et les taux de condamnation, et en explorant la vie quotidienne des lois sur les crimes haineux à travers le prisme de récits intimes, Fragile Hope fait une observation inattendue : les analyses qui soulignent principalement le caractère inefficace de ces lois risquent de donner une image incomplète et d’ignorer les voies créatives d’engagement porteur d’espoir que ce type de législation peut inspirer.
Mon travail de terrain a révélé qu’au Rajasthan, la PoA réécrit progressivement et de manière invisible les systèmes de hiérarchie des castes et de pouvoir sociopolitique depuis la base, bien que les biais explicites et implicites des acteurs juridiques sapent souvent les plaintes individuelles pour atrocités. La clé de cette transformation est le projet de ce que j’appelle le méliorisme légal, qui s’est développé en dialogue avec la PoA : la tentative d’utiliser la loi sur les crimes haineux pour améliorer progressivement les conditions sociales oppressives à travers la construction de nouvelles communautés juridiques stratégiques, de nouvelles épistémologies de la justice et des habitudes quotidiennes d’espoir.
Contextualisation de la loi sur la prévention des atrocités
Pour comprendre les dynamiques uniques d’espoir et de désespoir que la loi sur les crimes haineux peut inspirer, il est important de noter où se situe la PoA, à la fois dans le cadre juridique de l’Inde et dans le paysage juridique mondial. En Inde, la PoA est souvent considérée comme une loi pénale spéciale, visant à infuser le droit pénal avec les idéaux constitutionnels d’égalité substantielle en créant une catégorie spécifique d’infractions pour un groupe ou un sujet donné. Cependant, dans un contexte législatif mondial, des juristes et anthropologues ont souvent qualifié la PoA de loi sur les crimes haineux.
Fragile Hope invite finalement les anthropologues et juristes à explorer un ensemble nouveau et différent de questions.
Les lois sur les crimes haineux, qui ont été de plus en plus adoptées dans le monde depuis les années 1980, punissent les expressions violentes de préjugés. Elles cherchent généralement à combattre la violence motivée par des préjugés de deux manières : d’abord en renforçant les peines pour les infractions pénales existantes lorsqu’elles sont commises contre des membres de groupes protégés. Ensuite, en introduisant parfois de nouvelles infractions spéciales substantielles pour interdire le langage préjudiciable ainsi que les comportements physiques ou matériels fondés sur des préjugés.
La PoA a suivi un schéma similaire. C’est la seule loi en Inde à criminaliser explicitement toute violence verbale, physique et symbolique contre les Dalits et les Adivasis. La loi a créé une nouvelle catégorie d’infractions appelée « atrocités », qui, pour être poursuivies en vertu de la loi sur les atrocités, doivent être commises contre des membres des communautés dalit ou adivasi par une personne n’appartenant pas à ces groupes. Elle a également renforcé les peines pour certains crimes prévus par le Code pénal indien de 1860 (IPC)[1] tels que les agressions physiques ou le harcèlement sexuel.
Cependant, une vision socialement transformatrice plus radicale, enracinée dans l’histoire unique des libertés civiles en Inde, a également soutenu la PoA. Lorsque j’ai interviewé P.S. Krishnan, ancien commissaire spécial pour les castes et tribus répertoriées et l’un des auteurs originaux de la loi sur les atrocités, en 2018, il a souligné que la PoA avait pour but de faire plus que punir. Il s’agissait de transformer progressivement une société violemment divisée selon les lignes de caste et d’identités autochtones en une société définie par l’égalité, la liberté et la non-discrimination—principes que le Dr Ambedkar, père de la Constitution indienne et lui-même membre de la communauté dalit, avait inscrits dans le cadre juridique fondamental du pays.
Échecs inévitables ?
Pourtant, malgré ou peut-être à cause de sa rigueur et de son ambition punitives, la PoA a toujours été une loi profondément polarisante, et beaucoup ont remis en question sa capacité à engendrer un changement social fondamental.

Les chercheurs anti-castes ont proposé que les préjugés de caste profondément enracinés au sein de la police et du pouvoir judiciaire ont systématiquement démantelé la PoA par deux mécanismes centraux : d’abord, la dépendance disproportionnée des enquêtes sur les atrocités envers la police, qui rejette souvent les plaintes des Dalits et des Adivasis, remettant en question la crédibilité de leurs récits. Ensuite, un refus systématique au niveau judiciaire de reconnaître les motifs casteistes et préjudiciables derrière les attaques contre les communautés protégées par la PoA.
Alors, qu’y a-t-il exactement d’espoir dans cette situation ?
Au début, j’ai moi aussi pensé qu’il n’y avait peut-être pas beaucoup de raisons d’espérer, alors que j’observais que les plaignants issus des Dalits rencontraient les mêmes obstacles à l’accès à la justice formelle, comme l’avaient décrit de nombreux autres chercheurs. J’ai vu des survivants désillusionnés d’atrocités de caste se détourner des commissariats et j’ai observé comment les véritables histoires de haine et d’oppression échappaient aux mailles d’un système de justice pénale dont les régimes de preuve sont souvent incapables de saisir l’expérience vécue de la discrimination.
Loi sur les crimes haineux et le complexe d’espoir mélioriste
Cependant, au fur et à mesure de mon travail de terrain, j’ai appris quelque chose d’inattendu : au Rajasthan, les échecs institutionnels du système juridique ne semblaient pas marquer la fin de l’engagement des Dalits avec la PoA. Au contraire, ils représentaient le point de départ d’un agenda multifacette et multi-échelle d’engagement juridique parmi les survivants d’atrocités, les militants anti-castes et les avocats.
Cet agenda visait à produire des changements plus larges dans la culture juridique et les régimes de vérité juridique, en ouvrant de nouveaux espaces d’action créative qui permettraient aux communautés historiquement marginalisées de réécrire progressivement les structures de hiérarchie sociopolitique et de pouvoir juridique depuis la base.
Le succès ou l’échec de la législation sur les crimes haineux ne peut pas être simplement mesuré par les taux de condamnation.
Par conséquent, je soutiens dans Fragile Hope que la PoA est devenue un lieu pour ce que j’appelle un projet de méliorisme légal. Terme inventé par le philosophe pragmatiste John Dewey, dont les enseignements ont profondément influencé le projet intellectuel du Dr Ambedkar, le méliorisme se réfère à la croyance que les conditions sociales peuvent être améliorées par une action persistante et ciblée.
À travers sept chapitres, j’explore comment les survivants d’atrocités créent ce qu’ils appellent umid ki aadatein (habitudes d’espoir), autour de la PoA. Je retrace l’histoire d’Aunty-ji, une femme d’âge moyen dont le fils s’est suicidé après avoir été torturé par un groupe d’hommes de caste supérieure. Je raconte comment elle s’efforce activement de créer de nouvelles communautés de résistance grâce à la PoA. En collectant des données sur les atrocités de caste, en créant des communautés thérapeutiques et des plateformes de partage de connaissances en ligne, elle tente d’amener davantage de corps et de voix dalits dans les espaces juridiques dont ils ont été historiquement exclus.
Découvrez les livres écrits par nos collaborateurs
Je suis également un groupe de militants des droits humains alors qu’ils organisent des manifestations publiques devant les tribunaux et les commissariats pour alerter les médias sur les problèmes de négligence dans les enquêtes sur les plaintes déposées en vertu de la PoA. Et j’accompagne Roop Singh, un ouvrier agricole et père de trois enfants, alors qu’il négocie un règlement à la suite de tentatives d’expropriation de terres et d’une agression physique par son voisin de caste supérieure, et qu’il utilise la PoA pour atténuer les menaces futures de violence de la part des castes supérieures.
À mesure que ces nouvelles pratiques ont évolué de manière symbiotique autour du tronc bureaucratique de la PoA, elles ont progressivement commencé à éroder l’allégeance structurelle du système juridique pénal indien aux visions du monde des castes supérieures : un système dont les cadres temporels et les structures de preuves ont à plusieurs reprises réduit au silence les voix marginalisées.
Ainsi, Fragile Hope soutient finalement que le succès ou l’échec de la législation sur les crimes haineux ne peut être simplement mesuré par les taux de condamnation.
Au contraire, le « succès » initial de ce type de législation pourrait bien résider dans le écran de projection qu’elle représente pour de nouvelles visions de l’égalité juridique, de l’agence et de l’espoir, ainsi que dans les nouveaux « mondains juridiques » de résistance qu’elle génère.
La loi sur les crimes haineux peut-elle avoir un avenir porteur d’espoir ? Peut-être
Dans Fragile Hope, je propose que la loi indienne sur la prévention des atrocités remet radicalement en question les hypothèses juridiques et politiques concernant le type de transformation que les lois sur les crimes haineux peuvent et doivent créer. D’une part, la loi expose des dilemmes familiers vécus et des contradictions probatoires qui hantent les tentatives juridiques de légiférer contre les préjugés et la haine à l’échelle mondiale. D’autre part, sa vie sociale révèle que, dans les interstices de la vie quotidienne, les lois sur les crimes haineux ne sont pas la somme de leurs obstacles procéduraux et juridiques, de leurs taux de condamnation ou des résultats individuels des affaires.

Au contraire, elles deviennent des champs de bataille ouverts où différents acteurs se battent pour le droit d’imprimer leur vision de l’égalité, de la justice et de la vérité dans les épistémologies, temporalités et procédures du droit officiel. Au Rajasthan, la PoA est devenue une toile sur laquelle les familles et communautés dalits peignent leurs propres idées d’agence et de réparation. Ce faisant, elles tentent activement de réduire l’empreinte historique des castes dominantes—pas seulement sur la PoA—mais aussi sur la structure du droit pénal général pour y insuffler la leur.
Cependant, cette agenda de transformation institutionnelle n’est pas conceptualisée, vécue ou appliquée de manière uniforme. La PoA et la recherche de justice après des incidents violents de discrimination et de haine affectent individus et groupes de façons hétérogènes et discordantes. Lorsque la loi sur les atrocités est intégrée dans la vie quotidienne des familles, des communautés, de la politique et des missions militantes, elle devient genrée, fracturée selon des lignes socio-économiques, et peut générer de nouvelles formes de hiérarchie intra-communautaire et même de violence.
Repenser la loi sur les crimes haineux : nouvelles questions pour la recherche sociojuridique
Fragile Hope invite finalement les anthropologues et juristes à explorer un ensemble nouveau et différent de questions. Les lois sur les crimes haineux semblent avoir une double fonction : punir les actes passés de violence fondée sur l’identité et prévenir les futurs.
Ainsi, les débats sociojuridiques autour de la législation sur les crimes haineux se sont souvent concentrés sur des questions de “comment” : Comment prouver un état d’esprit préjudiciable devant un tribunal ? Comment prévoir la probabilité de crimes motivés par des préjugés dans certains contextes ? Pourtant, ils ont négligé d’explorer ce que les lois sur les crimes haineux accomplissent socialement et politiquement, quelles nouvelles interprétations du droit, de la politique et de l’égalité sociale elles génèrent, et qui a le dernier mot dans l’interprétation de leurs objectifs sociétaux.
Je souhaite proposer que les échecs mondiaux des lois sur les crimes haineux à obtenir des condamnations pour les auteurs de violences discriminatoires, ainsi que les projets de méliorisme légal qu’elles inspirent, peuvent nous apprendre beaucoup sur les incompatibilités structurelles entre les systèmes formels de droit pénal et les expériences vécues de discrimination.
Mon espoir personnel est que Fragile Hope marque un point de départ d’une exploration académique globale plus large sur les vies sociales inattendues de la loi sur les crimes haineux, afin que nous puissions comprendre comment les systèmes juridiques pénaux peuvent et doivent être transformés pour intégrer les voix et les vérités des communautés historiquement marginalisées.
[1] Le Code pénal indien (IPC) a été remplacé par le Bharatyia Nyaya Sanhita en 2024.