Les philosophes les plus influents aujourd’hui sont des philosophes de droite. Si cela semble incorrect, c’est sans doute parce que nous opérons avec une conception particulière de « l’influence ». Je ne veux pas dire que les philosophes de droite sont les plus souvent cités dans les articles académiques, ni que leurs œuvres sont fréquemment enseignées dans les séminaires universitaires.
Margaret Thatcher transportait dans son attaché-case The Constitution of Liberty de F.A. Hayek. Paul Ryan préférait The Road to Serfdom et distribuait des copies de ce texte réactionnaire fondamental — ainsi que Atlas Shrugged d’Ayn Rand — à tout son personnel du Congrès. La deuxième administration de George Bush comptait parmi ses rangs de nombreux élèves directs et indirects de Leo Strauss. Le coup de grâce, cependant, est Alan Greenspan, converti précoce à l’« objectivisme » randien, qui a présidé la Réserve fédérale des États-Unis — probablement la position la plus influente mentionnée jusqu’à présent — pendant près de deux décennies.
La catastrophe climatique en cours et la menace d’un effondrement écologique rendent encore plus pressante la nécessité de réhabiliter le projet de construction d’une société rationnelle.
Je n’ai jamais étudié Hayek, Strauss ou Rand lors de mes études de philosophie, bien que je me sois spécialisé dans la pensée politique du XXᵉ siècle. À la place, on m’a assigné des auteurs comme Jürgen Habermas, Michel Foucault et Hannah Arendt. Ainsi, alors que le monde dans lequel nous vivons a été façonné selon des visions de droite, je me suis plongé dans des théories ayant peu d’impact ou de pertinence dans la politique réelle.
Il est presque impensable d’imaginer un Premier ministre britannique ou un président de la Chambre des représentants des États-Unis se revendiquant foucaldien. Pouvons-nous imaginer des discussions au Fonds monétaire international invoquant Habermas, Arendt ou même John Rawls ?
Ce décalage curieux entre le monde réel et le monde de la théorie politique perdure encore aujourd’hui : notre vice-président nouvellement nommé est fortement influencé par le théoricien politique "postlibéral" Patrick Deneen, mais combien d’étudiants en master ont seulement entendu parler de Deneen ?
Combler cette lacune fut l’une des principales motivations derrière l’écriture de The Right-Wing Mirror of Critical Theory. En lisant véritablement des penseurs comme Hayek et Strauss —ainsi que d’autres figures marquantes de la droite comme Carl Schmitt et Michael Oakeshott—, j’ai été frappé par quelque chose d’encore plus remarquable et troublant : les arguments résonnaient de façon étrangement familière.
A Critique of “Intelligent Design” in Politics
Dans les conversations qui dominent les sphères « critiques » et « radicales » de la théorie politique, « Les Lumières » et « La Modernité » sont souvent présentées comme des antagonistes. De la généalogie et de la déconstruction aux développements plus récents de la pensée « décoloniale » et « démocratique radicale », l’idée que les sociétés humaines pourraient ou devraient être conçues intelligemment en accord avec la « raison » est considérée comme naïve, problématique, voire génocidaire.
D’un point de vue différent, Arendt rejetait également l’idée que la politique consistait à construire une société « bonne » ou « rationnelle ». Cela réduit l’action politique à un simple moyen pour atteindre une fin définie et prédéterminée, plutôt qu’à une fin performative en soi, fondée sur l’échange d’opinions.
Même Habermas et Axel Honneth, défenseurs apparents des Lumières et de la Modernité, réinterprètent ces catégories au point de les rendre méconnaissables. Il ne s’agit plus d’émancipation universelle ni d’organisation économique de la société (que Habermas rejette comme étant le « paradigme de la production »), mais uniquement de « rationalisation » entendue comme communication, compréhension mutuelle ou reconnaissance.
Implicitement ou explicitement, toutes ces approches placent au centre la figure de la différence. Le monde politique est composé de peuples différents, d’histoires différentes, d’intérêts différents, d’opinions différentes, de visions du monde différentes, de paradigmes ontologiques différents. Les ambitions de la « volonté générale » de Jean-Jacques Rousseau, de la classe universelle de Karl Marx ou encore les appels de Julius Nyerere à un « design délibéré » apparaissent alors comme, au mieux, présomptueux et, au pire, dangereux. Mieux vaut embrasser une forme ou une autre de « pluralisme » plutôt que de s’accrocher à l’idée dépassée selon laquelle nous pourrions créer une « société rationnelle ».
Alors que je m’attendais à trouver dans les classiques de la pensée de droite des dogmatiques, des fanatiques religieux ou des partisans intransigeants du droit naturel, j’ai été surpris de découvrir des arguments remarquablement similaires — parfois presque indiscernables — à la posture décrite précédemment, celle qui était censée être progressiste, libératrice et résistante à l’autorité.
Qui a peur de la société rationnelle ?
Comme votre philosophe « postmoderno » o « postestructuralista » favorito, Schmitt rechazó el fundacionalismo en el pensamiento político. Argumentaba que el humanismo universalista del proyecto ilustrado despojaría a lo político de su significado: la demarcación entre “amigo” y “enemigo”. Asimismo, se negó a proporcionar cualquier justificación normativa sobre quién debía ser considerado amigo o enemigo.
Pour Schmitt, il ne s’agit pas de découvrir la politique « correcte » ou « vraie », mais uniquement de savoir laquelle est la plus efficace pour garantir l’ordre et la stabilité. Les mythes de « la nation » ou du Volk possèdent une résonance émotionnelle plus forte — et donc un pouvoir d’organisation supérieur — à celle du « prolétariat mondial » ou de « l’humanité ». Il était particulièrement préoccupé par la manière dont la pensée universaliste effaçait les différences, insistant sur le fait que la théorie politique devait être enracinée dans la relation entre des peuples spécifiques et des lieux spécifiques.
Hayek ne défend pas les marchés libres sur la base d’une croyance forte en l’inviolabilité métaphysique des droits de propriété privée.
Oakeshott a consacré sa vie théorique à critiquer ce qu’il appelait alternativement le « rationalisme » et la « politique de la foi ». Dans son œuvre tardive, On Human Conduct, il résume sa critique en établissant une distinction entre l’« association d’entreprise » et l’« association civile ». Une association d’entreprise a une finalité concrète et convenue : l’objectif d’une brigade de pompiers est d’éteindre les incendies. Ainsi, il est logique de débattre des moyens les plus rationnels pour atteindre cet objectif.
Une association civile, en revanche, est seulement un groupe de personnes vivant sous le même cadre juridictionnel. Il n’existe aucun objectif commun convenu. Par conséquent, théoriser sur la manière la plus « rationnelle » d’organiser la société dans son ensemble est vain. Une association civile ne peut être gérée qu’en minimisant le conflit autant que possible.
L’erreur du « rationaliste », selon Oakeshott, réside dans la confusion entre la logique de l’association civile (des foyers indépendants coexistant côte à côte) et celle de l’association d’entreprise (une initiative élective poursuivant un objectif déterminé). Les terreurs totalitaires du XXᵉ siècle sont nées lorsque des « rationalistes » ont tenté d’imposer leurs projets particuliers à l’ensemble de l’association civile.
L’adhésion de Schmitt au fascisme n’est pas un hasard, mais un choix linéaire et cohérent.
Hayek est bien connu pour sa défense des marchés libres face à la supervision étatique, mais ses arguments en faveur de cette position sont davantage épistémologiques que moraux. Sa critique de la planification économique repose sur une compréhension des limites humaines : même le planificateur central le mieux informé et le plus bienveillant ne pourrait jamais anticiper et s’adapter aux désirs changeants de millions de personnes. Le marché concurrentiel décentralisé, en revanche, engendre un « ordre spontané ». Reprenant une formule d’Adam Ferguson, Hayek décrit cela comme le résultat de « l’action humaine », mais pas du « dessein humain ».
Sur un plan plus philosophique, il est frappant de constater que Hayek ne défend pas les marchés libres en s’appuyant sur une croyance forte en l’inviolabilité métaphysique des droits de propriété privée. Comme Schmitt et Oakeshott, il ne croit pas que les engagements normatifs puissent être justifiés rationnellement de cette manière.
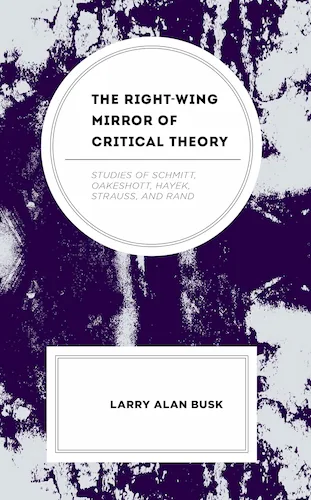
Il adopte plutôt une métrique « évolutive » pour l’analyse politique comparative. Les nations dotées d’une économie capitaliste et de mœurs culturelles chrétiennes sont devenues riches et puissantes, tandis que d’autres ne l’ont pas été. Elles ont donc dû faire quelque chose de juste. Plutôt que de demander des justifications ou des explications, nous devrions accepter sans réserve les formes économiques et les règles morales qui ont permis à l’Occident de prospérer.
Les ordres politiques, comme les langues, se sont développés au fil des siècles à travers d’innombrables modifications et adaptations. Il s’agissait d’un processus largement inconscient, opaque même pour ses propres participants : il n’existe pas de raison expliquant pourquoi « will not » est devenu « won’t » — cela s’est simplement produit. Il est absurde de penser que nous pourrions adopter une perspective omnisciente et « concevoir rationnellement » une société, tout comme les langues artificielles (comme l’espéranto) ne parviennent jamais vraiment à s’imposer.
Le cœur du travail de Hayek n’est donc pas l’anthropologie philosophique de l’homo economicus (un concept de la tradition classique qu’il rejette catégoriquement). Bien au contraire, c’est un témoignage des limites de la raison et de la compréhension humaines.
Contrairement aux autres penseurs, Strauss estime qu’un modèle d’ordre politique véritablement juste peut être discerné par la réflexion rationnelle. Il nie cependant que ce modèle puisse jamais être réalisé en pratique, car les masses ne sont pas capables de réflexion rationnelle. Les philosophes et intellectuels peuvent théoriser sur « le bien », mais ils ne devraient jamais espérer voir leurs visions se concrétiser. La multitude des gens ordinaires ne comprendrait ni n’accepterait ce qui est bon pour elle, il vaut donc mieux la laisser s’accrocher à ses illusions, à condition qu’elle laisse les penseurs mener leur travail contemplatif. La position de Strauss est élitiste, mais non avant-gardiste.
Un miroir inversé
En parcourant les grandes œuvres de la droite du XXᵉ siècle, plusieurs thèmes de la théorie critique et radicale contemporaine devraient sembler familiers :
- l’accent mis sur les aspects formels du « politique » et la pensée ancrée dans un territoire
- le rejet du fondationnalisme et de l’universalisme
- l’évitement du cognitif au profit de l’affectif ou de l’esthétique
- les critiques incessantes du vanguardisme
- la dépolitisation de l’économie de marché
- l’insistance sur le pluralisme, la différence, les limites épistémologiques et l’opacité autoréflexive
Pris isolément, cette ressemblance frappante est intéressante, mais peut-être pas totalement alarmante. Toutefois, l’argument central du livre est que, si nous acceptons cette disposition théorique, alors il existe en réalité des raisons convaincantes d’adopter des positions politiques de droite.
L’adhésion de Schmitt au fascisme n’est pas arbitraire, mais linéaire et cohérente. Puisqu’il n’existe pas de politique “correcte” accessible à la raison, nous ne pouvons maintenir la stabilité qu’en rassemblant les individus autour des mythes qui résonnent le plus : “le peuple authentique” et “la nation”. Pour que le mythe soit efficace, il est essentiel de préserver et de souligner les différences entre les peuples et les nations, plutôt que de dissoudre les identités particularistes dans une humanité universelle abstraite.
Oakeshott remet en question le droit de vote des femmes. Cette position, choquante de conservatisme à nos oreilles contemporaines, découle logiquement de ses prémisses philosophiques. Doubler la taille de l’électorat est une mesure radicale et sans précédent, allant à l’encontre de siècles de tradition. Les suffragettes ont imposé le projet particulier de leur « association d’entreprise », fondé uniquement sur une idée contrefactuelle de l’égalité des sexes que l’« association civile » n’avait jamais été conçue pour réaliser.
Des conclusions similaires découlent des prémisses de Hayek et Strauss. Toutefois, les théoriciens du spectre progressiste de gauche ne parviennent pas à établir un lien solide et cohérent entre l’architecture formelle de leur théorie et le contenu de leurs engagements politiques. Ils rejettent la notion d’une politique « correcte » tout en adhérant avec véhémence à ce que les critiques de droite appellent la “rectitude politique.”
Pourquoi un “pluralisme” des visions du monde ne devrait-il pas inclure les sceptiques des vaccins ou les négationnistes de l’Holocauste ? Pourquoi ne devrions-nous pas célébrer les foules scandant “expulsion massive, maintenant !” comme le retour du “politique” ? Qu’est-ce qui nous donne le droit de décider, contrairement à des siècles de tradition et d’usage établi, que les individus peuvent changer leurs pronoms personnels ? Lorsqu’un député défend sa position sur l’avortement en affirmant que l’agression sexuelle ne peut pas entraîner de grossesse, devrions-nous admettre que nos propres certitudes sont limitées et que notre compréhension de “la vérité” est aussi fragmentaire et partielle que la sienne ? Nous considérons-nous comme une avant-garde éclairée ?
Je soutiens que nous ne pouvons pas apporter de réponses significatives à ces questions sans réintroduire implicitement ces catégories “des Lumières” et “modernistes” qui auraient été bannies de la pensée critique et radicale. C’est à ce niveau que les théoriciens de gauche peuvent se distinguer de figures comme Schmitt et Hayek, plutôt que de partager avec eux l’essentiel philosophique et de ne s’en différencier que pour des raisons idiosyncratiques et arbitraires.
L’exception ici est Rand, qui affirme le fondationnalisme rationaliste et l’humanisme universaliste en net contraste avec les autres. Toutefois, loin d’indiquer les limites de la raison en politique, l’œuvre de Rand ne fait que confirmer l’importance des catégories “rationalistes.” Nous n’avons pas besoin de confronter sa position avec des critiques du fondationnalisme ou de l’universalisme. Comme je le détaille dans le dernier chapitre du livre, ses écrits sont absurdes même selon ses propres critères. Ce ne sont pas les critères eux-mêmes qui posent problème, mais son échec manifeste à les appliquer de manière cohérente.
Théorie critique sur une planète en réchauffement
Le déroulement catastrophique de la crise climatique et le spectre de l’effondrement écologique rendent la réhabilitation du projet de construction d’une société rationnelle plus urgente que jamais. Face à cette catastrophe sans précédent, des concepts comme l’avant-gardisme, l’émancipation universelle et l’organisation consciente de la production ne paraissent plus si désuets.
Si Mike Davis souligne à juste titre que la décarbonisation rapide et la transition vers une économie durable nécessiteraient “une révolution d’une ampleur quasi mythique,” Foucault nous invite à “nous détourner de tous les projets qui prétendent être globaux ou radicaux.” Peut-être est-il plutôt temps de nous détourner de tous les projets qui partagent les engagements fondamentaux de la droite.









