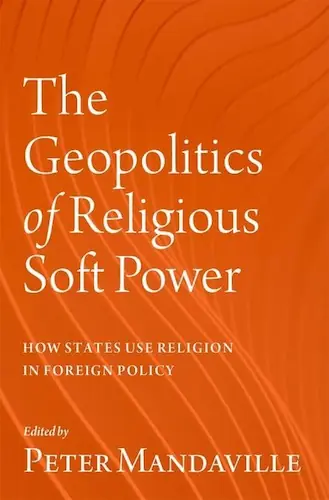La religion est revenue sur la scène mondiale—non seulement comme source d'identité ou de mobilisation, mais de plus en plus comme un outil de gouvernance étatique. Tandis que les puissances émergentes et les États établis cherchent de nouveaux moyens de faire progresser leurs agendas géopolitiques, le soft power religieux devient un élément essentiel, bien que peu étudié, des relations internationales.
- La religion comme source de légitimité et d’identité
- Exporter la foi : institutions, réseaux et centres culturels
- Autorité contestée : récits religieux concurrents
- Facteurs internes de la diplomatie religieuse
- Quand le soft power devient tranchant
- Religion et ordre mondial en transition
- Découvrez les livres écrits par nos collaborateurs
- Conclusion : prendre la religion au sérieux dans les affaires mondiales
Dans notre ouvrage collectif, La géopolitique du soft power religieux : comment les États utilisent la religion dans leur politique étrangère (Oxford University Press, 2023), les contributeurs examinent comment les gouvernements mobilisent des symboles, des institutions et des récits religieux pour légitimer leur autorité, façonner la perception à l'étranger et rivaliser pour l'influence. Cet article met en lumière les principaux thèmes abordés dans l’ouvrage, en montrant comment la religion est utilisée à travers différentes régions du monde—des stratégies de communication en Russie et en Inde à la construction d’image nationale en Jordanie et en Indonésie.
Les contributeurs de La géopolitique du soft power religieux soutiennent collectivement qu’il est temps de prendre la religion au sérieux en tant qu’outil de gouvernance étatique.
Le recours stratégique à la religion ou au discours religieux par les États dans les affaires internationales n’a rien de nouveau. Par exemple, pendant la guerre froide, le gouvernement des États-Unis a trouvé une utilité géopolitique dans le soutien à des causes religieuses et dans ses partenariats avec des institutions religieuses (telles que l’Église catholique) pour contrebalancer l’influence soviétique dans différentes régions du monde. Ainsi, bien que cette tendance ne soit pas totalement nouvelle, ce que l’on observe aujourd’hui constitue un changement majeur dans la diversité des puissances mondiales impliquées dans la géopolitique religieuse. Plusieurs schémas émergents permettent désormais de mieux comprendre les dimensions clés du soft power religieux.
La religion comme source de légitimité et d’identité
Dans de nombreux cas, la religion s’avère être un puissant vecteur de légitimation et de construction identitaire. En Russie, le président Vladimir Poutine a développé une relation étroite avec l’Église orthodoxe russe, exploitant son symbolisme et ses messages pour présenter la Russie comme défenseure des valeurs traditionnelles et comme une alternative civilisationnelle à l’Occident.
Cet effort peut être interprété comme une extension du projet du “Monde Russe” (Russkiy Mir) de Poutine, au-delà des frontières ethnolinguistiques et culturelles de la Russie, de la société slave ou du christianisme orthodoxe. Le soft power religieux offre au Kremlin une plateforme pour bâtir une solidarité fondée sur des valeurs conservatrices et “familiales” prétendument partagées, et pour positionner la Russie comme leur championne sur le plan géopolitique. De la même manière, le gouvernement Modi en Inde a intégré des récits nationalistes hindous dans sa politique étrangère, promouvant une vision de l’Inde comme acteur global culturellement distinct et spirituellement riche.
Même des démocraties laïques comme le Brésil ont vu une instrumentalisation de la religion. Sous Jair Bolsonaro, la rhétorique nationaliste chrétienne est devenue centrale dans l’articulation de l’identité nationale du Brésil et dans son engagement avec des réseaux conservateurs à l’étranger—en particulier avec les communautés évangéliques et pentecôtistes en Afrique lusophone. Ces exemples montrent que la religion n’est pas simplement un élément résiduel ou réactif de l’identité étatique, mais bien une dimension de plus en plus proactive de la construction nationale et du positionnement géopolitique.
Exporter la foi : institutions, réseaux et centres culturels
Le soft power religieux s’opérationnalise souvent par l’exportation d’institutions et de réseaux. La Direction des affaires religieuses de la Turquie, ou Diyanet, est par exemple devenue l’une des bureaucraties religieuses étatiques les plus actives au monde, construisant des mosquées, formant des imams et diffusant l’enseignement religieux à travers l’Europe, l’Afrique et l’Asie centrale. Le Maroc a adopté un modèle similaire, en établissant des centres de formation religieuse pour les clercs ouest-africains à Rabat et à Fès, dans le cadre de sa stratégie africaine.
La diplomatie religieuse est souvent une extension de la gouvernance intérieure.
Étant donné l’antipathie historique du Parti communiste chinois à l’égard de la religion, la promotion du bouddhisme par Pékin—en particulier sous l’ère Xi Jinping—semble profondément contre-intuitive.
Cet effort s’est traduit non seulement par un investissement dans une renaissance religieuse interne, mais aussi par une démarche ciblée auprès des communautés bouddhistes au Sri Lanka, au Népal et en Asie du Sud-Est, dans le cadre de l’Initiative des Nouvelles Routes de la Soie. Ces initiatives reflètent une prise de conscience croissante chez les décideurs quant au fait que les institutions religieuses peuvent servir de vecteurs d’affinité culturelle, d’influence idéologique et d’alignement politique.
Autorité contestée : récits religieux concurrents
Le soft power religieux est souvent conflictuel, les États cherchant à imposer leurs interprétations préférées et à marginaliser leurs rivaux. L’utilisation de la théologie chiite par l’Iran dans sa politique étrangère le place en concurrence directe avec les récits sunnites provenant d’Arabie saoudite et d’Égypte, ainsi qu’avec des autorités chiites alternatives en Irak.
Mais il est important de noter que Téhéran parvient également à s’appuyer sur l’expérience historique chiite et sur des symboles d’oppression pour tisser des liens avec des mouvements sociaux non musulmans (et même non religieux) engagés contre l’hégémonie néolibérale dans des pays aussi divers que le Venezuela et la Thaïlande. La Jordanie, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite se positionnent comme défenseurs de « l’islam modéré », mais leurs interprétations respectives diffèrent dans leur contenu et leurs objectifs.
Dans la sphère bouddhiste, l’appropriation du patrimoine religieux par l’État chinois entre souvent en conflit avec l’image que projette l’Inde en tant que berceau historique du Bouddha. Il en résulte une compétition mondiale non seulement autour des symboles religieux, mais aussi autour de la définition de l’authenticité et de l’orthodoxie dans un paysage religieux pluraliste.
En suivant le politologue Gregorio Bettiza, on peut considérer cela comme une compétition pour ce qu’il appelle le “capital sacré”, soit la capacité de certains pays à mobiliser leurs liens historiques avec des traditions religieuses spécifiques pour soutenir leurs objectifs géopolitiques.
Facteurs internes de la diplomatie religieuse
De nombreux cas présentés dans l’ouvrage montrent que le soft power religieux commence sur le plan national. La politique religieuse interne—qu’elle vise à consolider le régime, à générer un consensus parmi les élites ou à exercer un contrôle social—façonne souvent la nature et la portée de l’engagement religieux international.
La promotion de « l’islam modéré » par l’Indonésie sur la scène mondiale reflète les tensions persistantes entre ses réseaux islamiques traditionalistes et les mouvements plus conservateurs. De même, l’exportation de l’islam sunnite malikite par le Maroc est étroitement liée aux efforts de la monarchie pour préserver l’autorité religieuse du roi.
Ces exemples montrent que la diplomatie religieuse est souvent une extension de la gouvernance nationale, où les hiérarchies religieuses internes sont projetées à l’étranger comme un moyen de stabiliser l’ordre politique interne.
Quand le soft power devient tranchant
Bien que le soft power religieux soit souvent présenté comme une forme de diplomatie culturelle et d’engagement constructif, plusieurs contributions mettent en garde contre une dimension plus sombre.

Ce que certains qualifient de ‘pouvoir tranchant’ religieux fait référence à l’usage de récits et de réseaux religieux pour attiser les divisions, affaiblir le pluralisme ou diffuser de la désinformation. Le soutien de la Russie aux groupes orthodoxes en Europe de l’Est, ses liens avec des acteurs chrétiens de droite aux États-Unis et sa rhétorique sur les « valeurs traditionnelles » en sont autant d’exemples.
De manière similaire, les tentatives d’instrumentalisation de la religion au Myanmar, au Sri Lanka et dans certaines régions d’Asie du Sud ont été impliquées dans des violences communautaires. Ces cas montrent que la religion peut devenir un outil puissant non seulement d’attraction, mais aussi de coercition et de contrôle—en particulier lorsqu’elle est mobilisée à des fins nationalistes ou autoritaires.
Religion et ordre mondial en transition
Dans un monde de plus en plus marqué par la multipolarité, le pluralisme normatif et les mutations idéologiques, la religion est appelée à jouer un rôle encore plus important dans la configuration des alignements internationaux. Les Accords d’Abraham, bien que formulés en termes diplomatiques séculiers, véhiculent un message religieux implicite sur la coopération interconfessionnelle.
Découvrez les livres écrits par nos collaborateurs
Dans d’autres contextes, des valeurs religieuses communes ont facilité des alliances transnationales entre régions—par exemple, entre des groupes évangéliques conservateurs aux États-Unis et en Amérique latine, et des acteurs orthodoxes en Europe de l’Est.
Ces alliances émergentes remettent en question les anciens modèles de conflit civilisationnel en montrant que l’affinité religieuse pourrait désormais s’exercer à travers, plutôt qu’à l’intérieur des blocs traditionnels. Cette évolution suggère que les analyses futures de l’ordre mondial devront accorder une plus grande attention à la dimension religieuse—non seulement comme marqueur identitaire, mais aussi comme un axe actif de pouvoir.
Conclusion : prendre la religion au sérieux dans les affaires mondiales
Les contributeurs de La géopolitique du soft power religieux affirment collectivement qu’il est temps de considérer sérieusement la religion comme un outil de gouvernance étatique. Qu’elle soit envisagée sous l’angle de la légitimité, de la diplomatie, de la concurrence ou de la perturbation, la religion devient de plus en plus centrale dans la manière dont les États définissent leurs intérêts et poursuivent leurs objectifs.
Alors que nous avançons dans une ère où l’identité et les valeurs rivalisent avec l’économie et la sécurité en tant que piliers de la politique étrangère, comprendre le soft power religieux sera essentiel pour les chercheurs, les praticiens et le grand public. Cet ouvrage est une invitation à intégrer pleinement la religion dans nos outils d’analyse—avec nuance et rigueur.