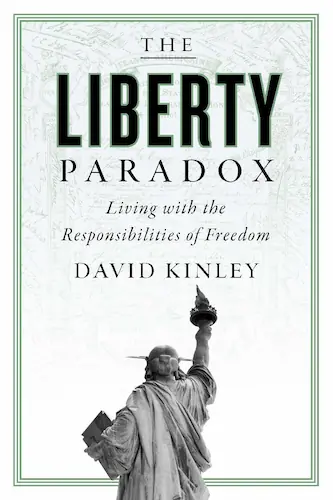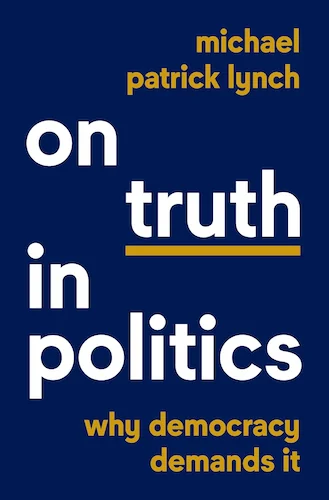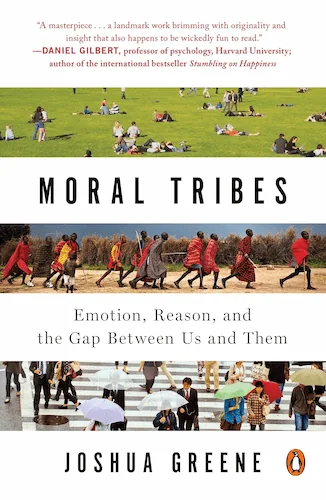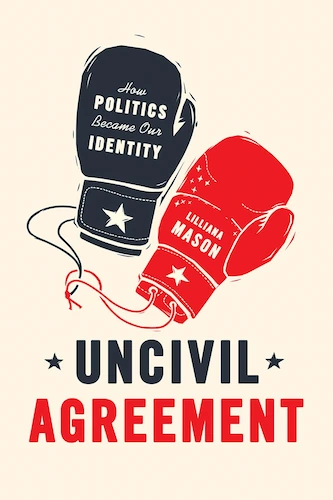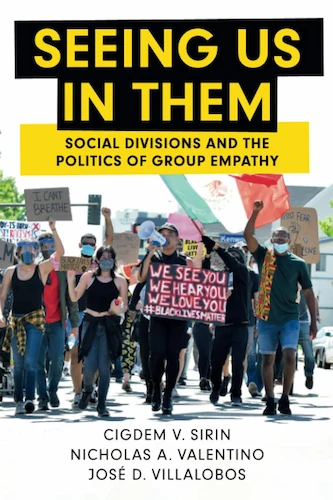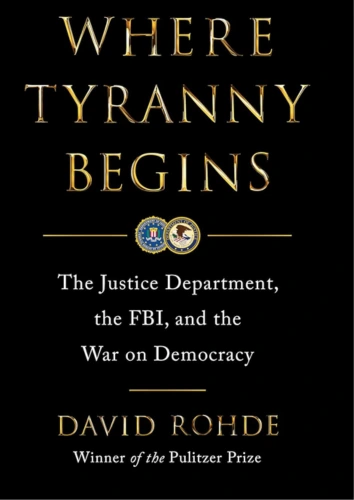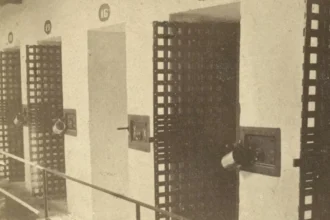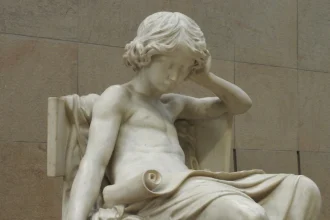Le paradoxe de la liberté : liberté versus responsabilité ?
Lorsque j’ai commencé à écrire The Liberty Paradox, je cherchais des réponses à deux questions : Sommes-nous libres de faire tout ce que nous voulons ? Et si ce n’est pas le cas, pourquoi pas ? Ces questions anciennes me semblaient nécessiter de nouvelles réponses. Ou plutôt, comme je l’ai constaté, d’anciennes réponses adaptées à notre époque.
- Le paradoxe de la liberté : liberté versus responsabilité ?
- Une pandémie révèle les limites de la liberté
- Une liberté poussée à l’extrême : du choix au chaos
- L’instrumentalisation de la liberté d’expression : hypocrisie et pouvoir
- La tyrannie au nom de la liberté
- Ayn Rand et l’éthique de l’égoïsme
- Forces privées et publiques dans la structuration de la liberté
- La liberté assiégée : leçons de l’histoire et d’aujourd’hui
Mon argument principal est que la compréhension conventionnelle de la « liberté » — englobant à la fois la liberté et la responsabilité — s'effondre aujourd’hui sous le poids des revendications fondées uniquement sur la « liberté ». C’est le composant inhérent de responsabilité dans la notion de liberté qui crée ce paradoxe apparent.
Une pandémie révèle les limites de la liberté
J’ai commencé le projet sérieusement alors que les premières rumeurs d’un nouveau virus grippal émergeaient de Chine et que quelques alertes de voyage internationales étaient émises. C’était en janvier 2020 et j’étais au Népal pour un voyage d’études de deux semaines avec 30 étudiants en droit, dont certains ont vu leurs
Ces petites restrictions à leur liberté de mouvement étaient, bien sûr, les signes avant-coureurs des extraordinaires incursions mondiales dans la liberté individuelle qui allaient suivre au cours des années suivantes, me fournissant une étude de cas monumentale en temps réel sur la manière dont nous gérons les libertés personnelles face aux responsabilités publiques.
Les questions concernant notre degré de liberté, et celui que nous devrions avoir, ont été particulièrement mises en lumière pendant les années de la COVID-19, mais en réalité elles nous confrontent chaque jour à travers la multitude d’activités, d’interactions et de pensées qui occupent nos heures d’éveil. Certaines sont encadrées par des règles formelles — activités criminelles interdites, lois fiscales et règles de circulation.
D’autres sont négociées de manière informelle à travers des normes et attentes socialisées — loisirs choisis, partenaires amoureux ou modes vestimentaires, ainsi que les standards de comportement public en s’amusant avec des amis ou en interagissant avec des inconnus. Et dans bien d’autres cas, le format est une combinaison des deux : protéger sa vie privée et familiale ou exercer les libertés d’expression ou de religion.
Une liberté poussée à l’extrême : du choix au chaos
Les proclamations extrêmes de liberté — ce que j’appelle dans le livre liberté « absolue » ou « extrême » — offrent les exemples les plus parlants des conséquences désastreuses pour les sociétés dans leur ensemble et pour tous les individus, y compris ceux qui revendiquent cette liberté extrême. Platon qualifiait une telle situation d’« excès de liberté », où « l’amour exclusif de la liberté et l’indifférence à tout le reste provoquent le passage de la démocratie à la tyrannie. »
C’est l’égoïsme érigé en principe qui nous mène vers la tyrannie, où le message de la liberté se transforme en un décret affirmant non seulement qu’il est acceptable d’être égoïste, mais qu’il est juste et légitime que nous le soyons tous. Vous pouvez dire ou faire ce que vous voulez, vous êtes et devez être libre de le faire. De même, vous devriez être libre de ne pas être contraint ou poussé à faire ce que vous ne voulez pas faire. Vous êtes libre — selon cette logique — de choisir de porter un masque ou de vous faire vacciner pendant une pandémie, et comme chacun est libre de choisir, alors personne n’est lésé.
C’est une logique perverse qui ne dépasse guère les prémices, ignorant — ou plus souvent, méprisant — ce qui se passe lorsque les revendications de liberté s’opposent. Autrement dit, lorsque les droits individuels entrent en contradiction avec ceux d’autrui ou avec l’intérêt public plus large (les deux notions étant étroitement liées, car résoudre équitablement les différends entre individus relève aussi de l’intérêt général). Mais cette rhétorique n’a pas pour but d’aller plus loin.
L’instrumentalisation de la liberté d’expression : hypocrisie et pouvoir
Les slogans de l’extrême droite, soi-disant libertaire, sont conçus pour accorder des privilèges sans contrepartie. C’est un permis d’être égoïste — de faire ce que vous voulez — tout en refusant ce même droit à ceux avec qui vous êtes en désaccord ou que vous n’aimez pas. Elon Musk en a donné un parfait exemple lorsqu’il a déclaré, lors d’un rassemblement de Trump en Pennsylvanie début octobre 2024, que les démocrates “veulent vous retirer votre liberté d’expression”, ajoutant que “vous devez avoir la liberté d’expression pour qu’il y ait démocratie.”

L’hypocrisie d’un tel avertissement, face à la campagne menée depuis des décennies par Donald Trump pour faire taire quiconque est en désaccord avec lui à coups de menaces de violence, d’intimidations, de procès et d’insultes, est tellement grossière qu’elle en devient risible. “Trump dit que la liberté d’expression n’est valable que pour les gens qu’il aime”, résumait The New Republic à propos d’un discours prononcé deux semaines plus tard lors d’une réunion de dirigeants religieux en Caroline du Nord. Ou, comme l’a lancé un Jon Stewart typiquement excédé dans son Daily Show : “ce n’est pas de la liberté d’expression si seuls les admirateurs de Trump peuvent en bénéficier sans conséquences ; ce n’est pas comme ça que ça marche !”
La clé est de reconnaître le subterfuge du futur tyran et sa propre cécité avant qu’il ne soit trop tard et que le potentiel ne devienne une tyrannie réelle.
Il est bien sûr possible que les protagonistes eux-mêmes perçoivent ce partisanship pour la mascarade qu’il est, l’objectif n’étant pas de mener un débat rationnel, mais plutôt de “noyer la zone sous la merde”, comme le reconnaît ouvertement Steve Bannon. Et en Elon Musk, Trump a trouvé un complice exubérant, plus qu’heureux d’utiliser sa propriété de X comme “une machine”, selon les mots de Charlie Warzel, “réaménagée pour empoisonner l’environnement informationnel en le saturant de rumeurs dangereuses, fausses et non fondées sur des fraudes électorales, capables d’atteindre un large public.”
Quoi qu’il en soit, l’impact d’une telle rhétorique est à la fois ouvertement et insidieusement malveillant. Elle évoque le vieux mensonge des tyrans promettant la liberté sans responsabilité, où la liberté est exercée par le despote et les responsabilités assumées par tous les autres. En somme, c’est “fasciste jusqu’au cœur”, comme Mark Milley, ancien chef d’état-major interarmées sous Trump, l’a caractérisé en parlant de son ancien patron.
La tyrannie au nom de la liberté
Comme je l’illustre dans le livre, les sociétés humaines ont une longue histoire d’autocrates s’appropriant les termes de liberté et d’émancipation à des fins qui ne profitent qu’à eux-mêmes, et non à leurs peuples. De Caligula et Alexandre le Grand à Hitler et Staline, l’attrait de la liberté a été impitoyablement exploité.
Je ne considère pas la supervision privée (ou du moins non publique) de la liberté comme étant sans importance.
Staline, par exemple, déclara avec insouciance à un journaliste américain en 1936 : “nous n’avons pas construit cette société pour restreindre la liberté personnelle, mais afin que l’individu humain puisse se sentir réellement libre” (p.24), soulignant ainsi l’avertissement sévère de Platon selon lequel aimer trop la liberté nous aveugle face aux motivations cachées des tyrans qui promettent de la protéger (p.18).
La clé est de reconnaître le subterfuge du futur tyran et sa propre cécité avant qu’il ne soit trop tard et que le potentiel ne devienne une tyrannie réelle.
Ayn Rand et l’éthique de l’égoïsme
Mais pour ceux qui nourrissent des griefs (et qui parmi nous en est exempt ?) et qui ont un sain respect d’eux-mêmes, la tâche n’est ni facile ni, pour beaucoup, bienvenue. Recevoir la permission d’être égoïste sous la noble bannière de la liberté semble être une option à la fois beaucoup plus simple et séduisante.

La philosophe américaine d’origine russe Ayn Rand a promu et popularisé cette notion dans ses travaux des années 1960, élevant ce qu’elle appelait “l’égoïsme rationnel” au rang de caractéristique essentielle de la civilisation humaine. Penser autrement, soutenait-elle, revenait à dégrader son propre sens du respect de soi.
Toute “attaque contre l’‘égoïsme’ est une attaque contre l’estime de soi de l’homme ; abandonner l’un, c’est abandonner l’autre”, déclara-t-elle (p.7).
C’était — ou cela peut du moins être — une idée puissante et enivrante, comme le raisonnement de Rand, qui tente clairement de couvrir tous les angles. Pourtant, au final, il ne parvient pas à convaincre.
Son recours à un ensemble d’« éthiques objectivistes » comme outil pour garantir que nos quêtes d’intérêt personnel soient « rationnelles » peut sembler correspondre en partie à mon binôme liberté/responsabilité.
Mais la réponse de Rand à la question fondamentale de savoir qui construit, organise et arbitre ces responsabilités éthiques est fondamentalement déficiente. Elle écarte effectivement le gouvernement (son antipathie envers le totalitarisme régnant dans sa patrie l’a inspirée à rejeter toute intervention étatique, sauf la plus minimale), préférant, comme on le sait, les mécanismes d’interactions entre individus dans une économie de libre marché pour déterminer ce qui est rationnel.
Forces privées et publiques dans la structuration de la liberté
Dans le livre, j’explore à la fois les moyens privés et publics de superviser la liberté à travers un enchevêtrement d’interactions méta et interpersonnelles plus fines. La possession et l’usage des armes à feu, par exemple, sont régis davantage par des obligations légales que par des normes sociales (bien que ces dernières jouent également un rôle).
En revanche, les expressions des préférences sexuelles ou religieuses sont davantage encadrées par les attentes sociales que par la loi (même si cette dernière joue également un rôle). La liberté de choisir le moment et le mode de sa propre mort se situe quelque part entre les deux, étant à la fois presque totalement libre (suicide) ou strictement réglementée (interdiction de l’euthanasie), selon les circonstances. Il est donc clair que je ne considère pas la supervision privée (ou du moins non publique) de la liberté comme étant sans importance.
Néanmoins, je soutiens que, quelles que soient l’ampleur et l’inévitabilité de ces médiations privées sur les limites de la liberté et de la responsabilité, l’État doit être l’arbitre ultime ou décisif. C’est en l’État que nous devons placer notre confiance pour définir les limites extérieures et régler les différends les plus longs ou les plus disputés. Toutefois — et c’est fondamental — cette confiance collective ne doit être accordée aux organismes de l’État que lorsqu’elle est justifiée. En démocratie, cela signifie, au strict minimum, accepter le “principe cardinal… selon lequel les citoyens se font mutuellement confiance et confient ensemble leur volonté collective à des représentants qui gouvernent en leur nom” (p.273).
Plus fondamentalement, elle “présuppose un large consensus sur les notions morales du bien et du mal, un soutien aux considérations utilitaristes d’équité et de justice, ainsi qu’une foi dans l’argumentation rationnelle comme moyen de débat et de résolution des différends. Chacune de ces caractéristiques est nécessaire pour une société bien ordonnée, fondée sur la confiance et soutenue par la liberté.” Car “la confiance est la colle qui nous lie les uns aux autres. Elle est le fondement des amitiés, des familles et des histoires d’amour, ainsi que des communautés, des constitutions et des églises” (p.273).
La liberté assiégée : leçons de l’histoire et d’aujourd’hui
Ces principes fondamentaux du gouvernement fondé sur le contrat social ont, depuis des siècles, été continuellement mis à l’épreuve, déformés et détruits. Ces défis persistent aujourd’hui, la liberté étant, comme toujours, la principale victime. Dans cette mesure, on pourrait être tenté d’entonner un plus ça change et de continuer.
Mais le démantèlement des institutions de gouvernance démocratique aux États-Unis par la seconde administration Trump, sa corruption de l’État de droit et son assaut façon Alice au pays des merveilles contre la vérité et la rationalité, sont des catastrophes pour la liberté dont on ne peut détourner le regard.
L’histoire, de manière fiable, nous offre des leçons. Aucune n’est plus prophétique que les observations empreintes de tristesse de Bertrand Russell sur les origines du fascisme, formulées en 1942 :
« La première étape d’un mouvement fasciste consiste à réunir, sous un chef énergique, un groupe d’hommes possédant plus que la moyenne de loisirs, de brutalité et de stupidité. L’étape suivante est de fasciner les sots et de museler les intelligents, par l’excitation émotionnelle d’un côté et par la terreur de l’autre. »
Russell savait déjà à l’époque qu’il ne s’agissait pas d’une hyperbole. Nous ne devrions pas penser autrement aujourd’hui simplement parce que nous avons affaire au chef présumé du monde libre. Car “la dernière ombre de la liberté quitte l’horizon”, comme nous l’avait averti Thomas Paine il y a exactement 250 ans, “lorsque les hommes abandonnent le privilège de penser.” Cette citation sert également d’épigraphe à The Liberty Paradox .